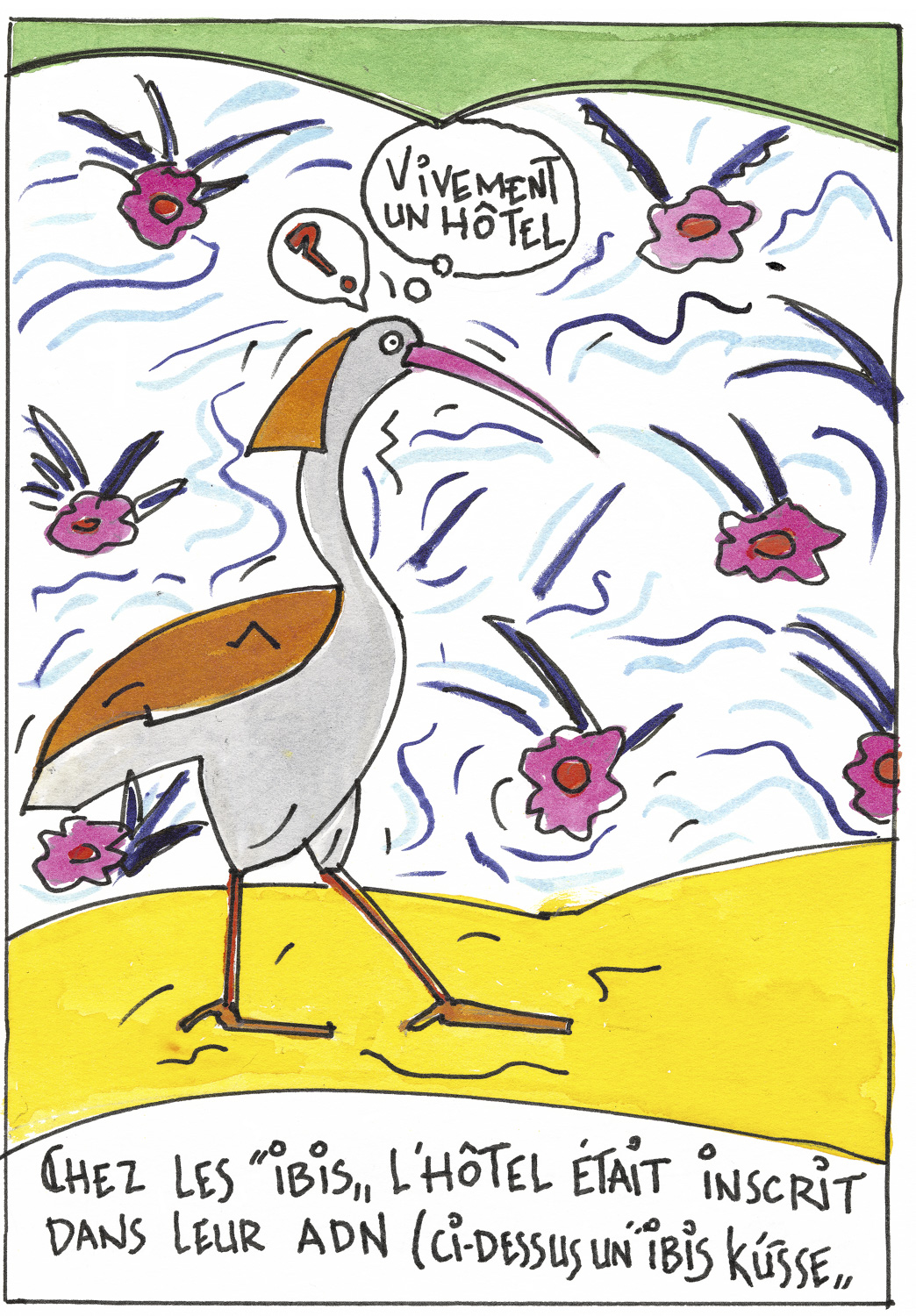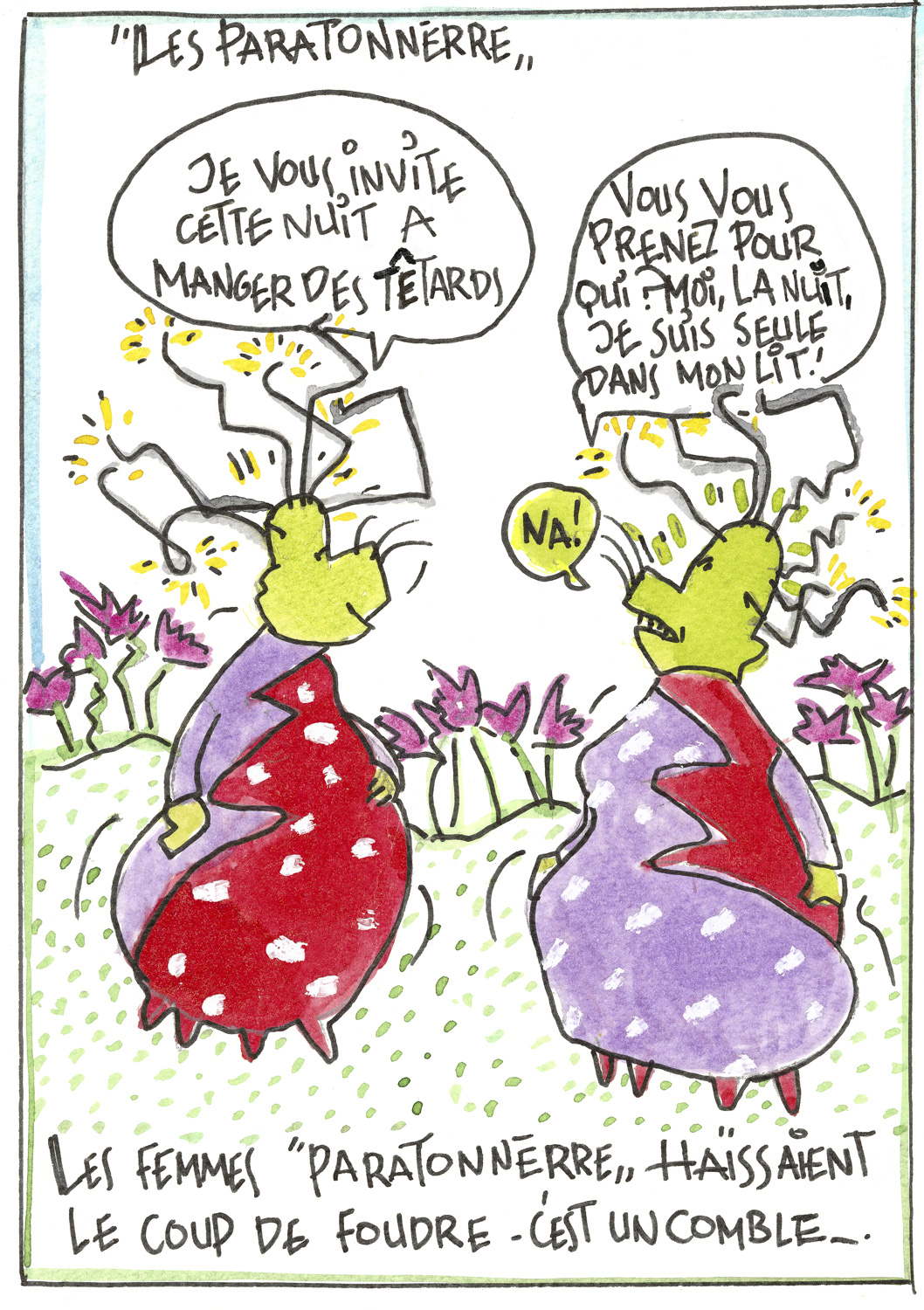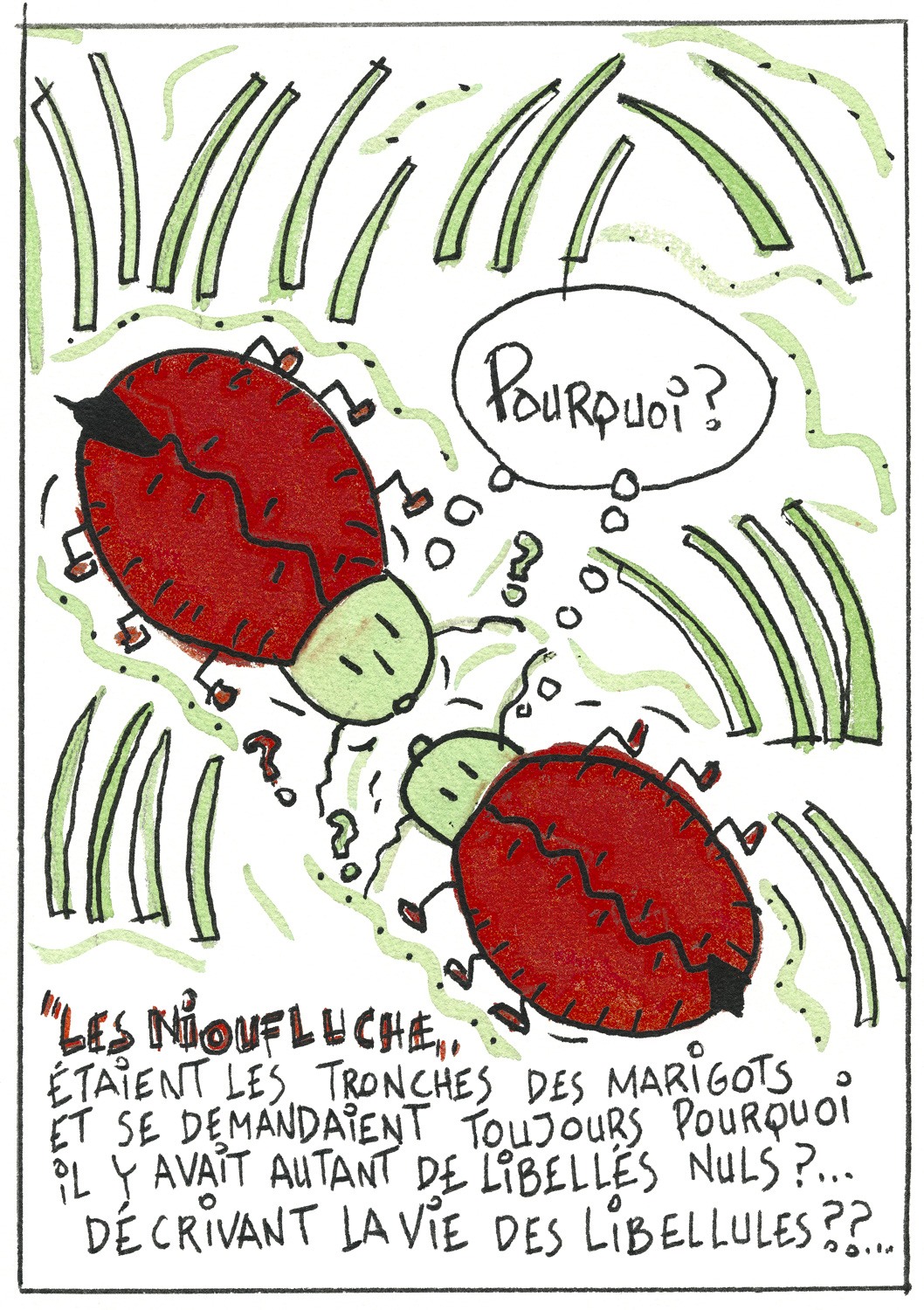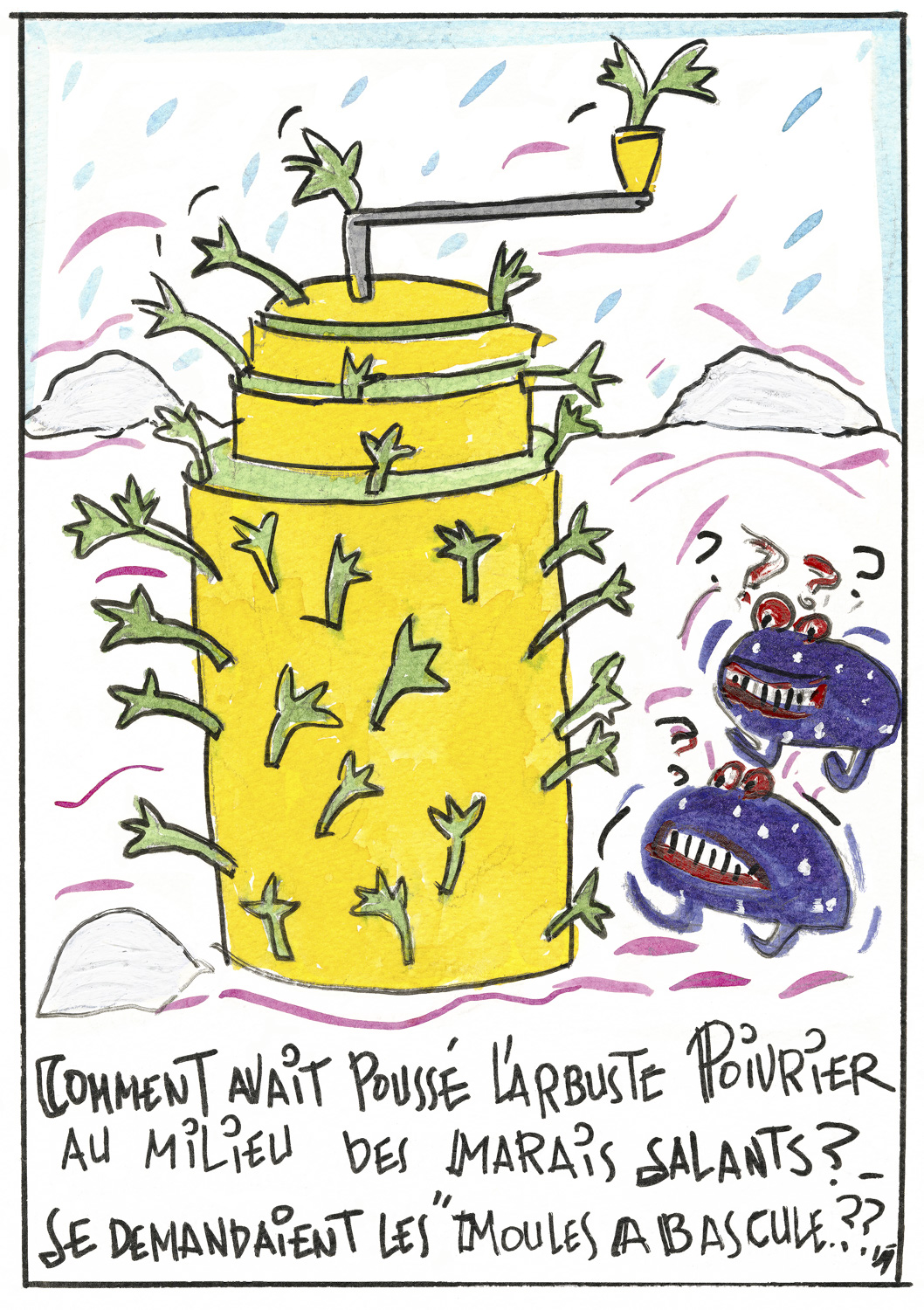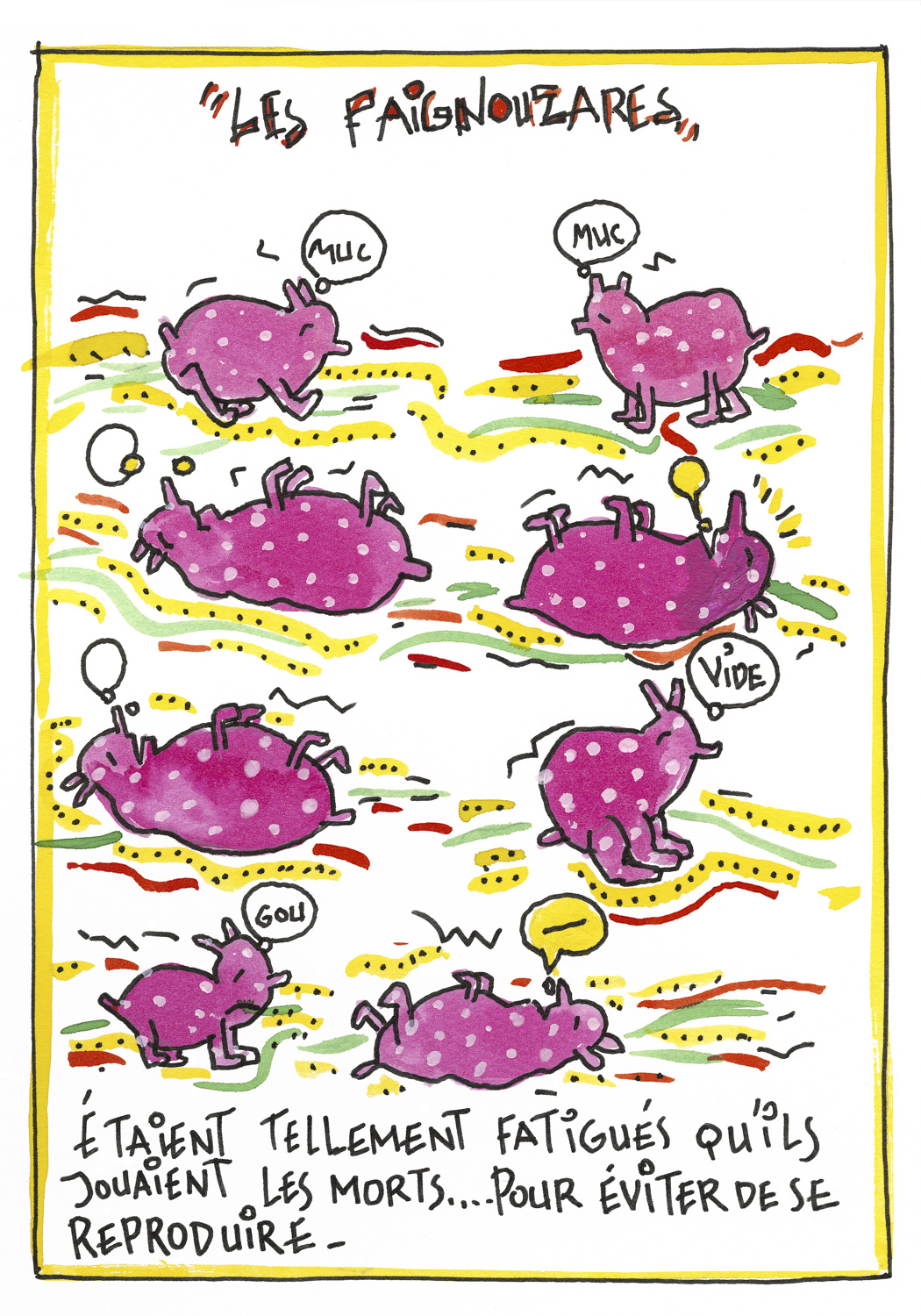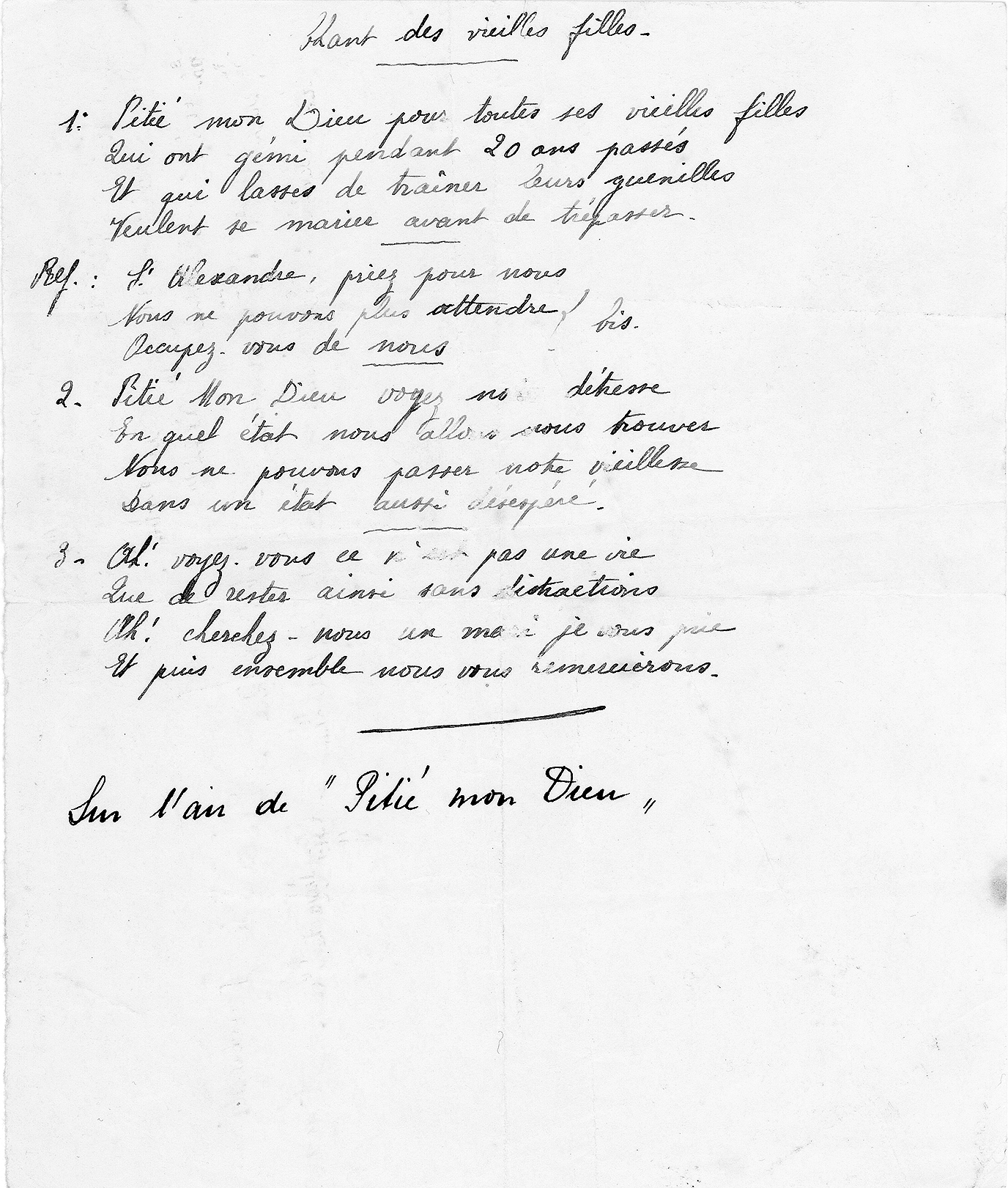Le peintre K. Vasili a rejoint l’Idée
Samedi matin, 4 avril 2015, à l’Hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine, un peintre majeur a quitté le monde de la matière pour rejoindre celui de l’Idée, qu’il n’a cessé de chercher tout au long de son œuvre. K. Vasili était aimé, apprécié, admiré par tous ceux qui servent l’art et refusent de s’en servir.
[dropcap]S[/dropcap]amedi matin, 4 avril 2015, à l’Hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine, un peintre majeur a quitté le monde de la matière pour rejoindre celui de l’Idée, qu’il n’a cessé de chercher tout au long de son œuvre. K. Vasili était aimé, apprécié, admiré par tous ceux qui servent l’art et refusent de s’en servir. C’est dire si la société médiamercantile – qui exerce actuellement ses ravages – l’a ignoré… Un signe de haute qualité qui ne trompe pas. La société médiamercantile a un mauvais goût très sûr. Vasili est né en 1942 à Lakotama en Grèce; son enfance a été marquée par la guerre civile qui, dès la fin du second conflit mondial, a opposé les communistes grecs aux nationalistes. Avec son frère aîné, Vasili avait trouvé refuge en Yougoslavie où il a accompli toute sa formation scolaire et artistique, notamment aux écoles des beaux-arts de Pec, Skopje et Belgrade. Dès 1964, il s’installe à Paris avant d’être naturalisé français. Rien n’était plus étranger à K. Vasili que le bruit.
En ascète de la peinture, il le tenait à l’écart, préférant l’ombre qui protège la vraie lumière aux projecteurs qui n’éclairent rien mais aveuglent la foule. D’ailleurs, même son patronyme est source d’interrogation, tantôt écrit à la grecque, tantôt rédigé à la serbe. Comme si l’important n’était pas dans une identité bureaucratique et forcément vague. Or, K. Vasili – c’est ainsi qu’il signait ses tableaux – n’aimait pas le vague, le flou, l’à-peu-près près trompeur.
C’est la vérité qu’il cherchait à atteindre. Ou plutôt l’idée de vérité. Parti de la représentation figurative d’un monde bouleversé et souvent conflictuel, l’artiste a épuré son geste et pris progressivement le parti de l’abstraction afin de tendre vers l’essentiel, l’essence-ciel où vibre le monde des Idées platoniciennes. Cette ligne qui figure dans nombre de ses tableaux est un chemin vers la lumière. Mais il en va ainsi de tous les chemins de crêtes, il faut dominer son vertige pour tendre vers le but.
S’il fallait lui coller une étiquette – un acte toujours douteux – celle de peintre platonicien serait la moins fâcheuse. Cette phrase tirée du Phèdre de Platon illustre parfaitement sa démarche artistique:
Une intelligence d’homme doit s’exercer, selon ce qu’on appelle «Idée», en allant d’une multiplicité de sensations vers une unité, dont l’assemblage est acte de réflexion.
Parti du multiple, l’artiste est parvenu à l’Un. Dans ce monde qui turbule à la folie, l’œuvre de K. Vasili n’est pas seulement nécessaire, elle est devenue vitale.
[su_service title="La Cité a consacré un hommage à K. Vasili dans son édition de mai." icon="icon: arrow-circle-right" size="30"][/su_service]
Ventes d’art mondiales: plongée dans un marché en plein boom
En 2014, 51 milliards d’euros se sont échangés en œuvres d’art dans le monde, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Dopé par la multiplication des musées et des intermédiaires, le marché accentue son profil spéculatif.
En 2014, 51 milliards d’euros se sont échangés en œuvres d’art dans le monde, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Dopé par la multiplication des musées et des intermédiaires, le marché accentue son profil spéculatif.
Mis en ligne le 1 avril 2015 à 21h45
[dropcap]L[/dropcap]a progression est de 300% en une décennie. Depuis 2004, le marché de l’art affole tous les indicateurs. Cette ascension est liée au segment de l’art contemporain, qui affiche une croissance vertigineuse de plus de 1000% sur dix ans. Le rapport d’Artprice sur les ventes d’art contemporain réalisées entre juillet 2013 et juillet 2014 enregistre un chiffre d’affaires de 15,2 milliards de dollars, contre 12,5 milliards en 2013, soit un bond de près de 30%. Un sommet inégalé sur ce segment, marqué par un fort nombre de ventes supérieures à un million. Tombées en automne 2014, les statistiques d’Artprice concernent uniquement les ventes Fine Art (1).
Mi-mars, le TEFAF Art Market Report, le plus complet existant à ce jour (2.), fait état d’un pourcentage global de croissance bien moins marqué que les 12% enregistrés par Artprice, au niveau global mais sur une année différemment considérée. De janvier à décembre 2014, quelque 51 milliards d’euros se sont échangés en œuvres d’art, soit 7% de plus qu’en 2013. C’est tout de même le niveau le plus élevé jamais enregistré. Avec 48% des recettes, l’art contemporain se taille la part du lion, l’art moderne représentant 28%.
Le marché est dopé par la multiplication des musées dans le monde, analyse Thierry Ehrmann, fondateur et président d’Artprice. «Il s’est créé plus de musées entre 2000 et 2005 que durant tout le XIXe et le XXe siècle et il s’ouvre dans la Grande Asie un musée par jour», lit-on dans son rapport. «Et un musée a besoin d’un minimum de 3000 à 4000 œuvres de qualité pour être crédible.»
VOCATION PREMIÈRE
Spécialiste du marché de l’art contemporain, Hayat Jmammou, directrice de la galerie genevoise Hayat Fine Arts Selection, considère pour sa part que «ce boom est aussi en grande partie lié à la spéculation réalisée par des acteurs puissants, qu’ils soient marchands d’art, collectionneurs, puissantes institutions ou les artistes eux-mêmes». Elle cite l’exemple du marchand d’art Larry Gagosian: «Il joue avec le système, il spécule, il exerce un marketing agressif et augmente ainsi la valeur de ses artistes.» Parmi ses «protégés», on dénombre Damien Hirst ou un certain Jeff Koons, le créateur du Balloon Dog, sculpture de trois mètres sur quatre adjugée par Christie’s pour 58,4 millions de dollars en novembre 2013. C’est le coup de marteau le plus fort qui a retenti à ce jour pour une œuvre d’art contemporaine.
«Nous sommes aux antipodes de la manière et du style d’un Paul Durand-Ruel, qui a vécu un siècle avant Larry Gagosian. Lui s’endettait pour acquérir les toiles des artistes qu’il affectionnait, comme Renoir ou Monnet», assène Hayat Jmammou. «L’art a été détourné de sa vocation première», déplore Frédéric Elkaïm, expert en marché de l’art contemporain, actif entre Genève et Paris. «De vecteur de valeurs culturelles et esthétiques, il est devenu un véhicule de placement financier.» Un changement de paradigme intervenu sous l’impulsion des nouvelles générations d’acheteurs:
[su_quote cite="Hayat Jmammou"]Aujourd’hui, nous comptons 450 millions de consommateurs d’art dans le monde, alors que, dans les années 1945, nous en comptions 500 000. Parmi ces consommateurs, beaucoup de jeunes trentenaires s’offrant le luxe d’une belle œuvre d’art au-dessus d’un meuble au nom suédois imprononçable qu’ils ont dû monter eux-mêmes.[/su_quote]
«Pour nombre d’acheteurs et de collectionneurs, l’art est une façon de acquérir un statut social. Parfois, cela va très loin. Certains n’hésitent pas à définir François Pinault comme le Lorenzo de Medici du XXIe siècle... Ce n’est pas mon point de vue, mais il est de plus en plus courant de l’entendre dans le milieu», ajoute Frédéric Elkaïm.
DOMINATION DES VENTES PRIVÉES
«À noter que Pablo Picasso reste l’artiste avec les transactions les plus importantes en 2014 avec 345,8 millions de dollars. Mais Andy Warhol le talonne avec 299,2 millions. Jusqu’à quand Picasso tiendra-t-il le flambeau?» se demande Hayat Jmammou. Aux yeux de l’amateur d’art, il serait impensable qu’un Wahrol puisse détrôner un Picasso. Ainsi va le marché de l’art, où les intermédiaires font la pluie et le beau temps. «Ce sont eux qui régulent le marché, analyse Hayat Jmammou. Contournant les enchères publiques, où ils sont évalués avec les critères du marché, les prix peuvent flamber.» Le rapport TEFAF confirme en 2014 la domination des ventes privées — réalisées par l’intermédiaire d’une galerie, d’un marchand d’art, ou même à travers les services «ventes privées» d’une maison de ventes aux enchères — sur les ventes publiques.
«On achète aussi beaucoup dans les foires, ajoute Hayat Jmammou, les volumes les plus importants se faisant dans les couloirs des vingt-deux plus grands salons internationaux sur les 180 grandes foires d’art comportant un élément international, couvrant fine et art décoratif, recensées en 2014.» Avec 9,8 milliards d’euros, les ventes réalisées dans les foires d’art représentent le deuxième canal de vente en importance après les transactions en galerie. Mais on achète également sur internet. L’an dernier, selon le rapport TEFAF, il s’est vendu en ligne pour 3,3 milliards d’euros en œuvres d’art, soit environ 6% des ventes globales.
Les géants des enchères d’art, Christie’s et Sotheby’s, ne semblent en rien perturbés par la montée en puissance des intermédiaires et des «ventes privées». Début mars, Sotheby’s annonçait un nouveau record historique de ventes en 2014, à 6,1 milliards de dollars, en hausse de 19% sur 2013. L’entreprise américaine occupe le deuxième rang mondial derrière la maison britannique Christie’s. Fin janvier, le numéro un mondial affichait une année 2014 historique, avec des ventes pour un montant de 8,4 milliards de dollars en 2014, en hausse de 12% sur un an.
Le marché de l’art en 2014 était composé de quelque 309 000 entreprises dans le monde entier, pour la plupart des petites entreprises, employant environ 2,8 millions de personnes, lit-on dans les pages du rapport TEFAF. Les États-Unis se font la part belle, avec 39% des transactions mondiales. C’est ensuite en Chine et au Royaume-Uni que les ventes ont été les meilleures, les deux pays arrivant deuxième ex-aequo avec chacun 22% de parts de marché. Face à la fulgurante progression de la Chine dans les statistiques mondiales, les géants anglo-saxons, États-Unis et Royaume-Uni, détiennent (encore) 61 à 62% des parts de marché. «En perte de vitesse, la France arrive en quatrième position, alors qu’elle détenait plus de 50% du marché de l’art dans les années 1960», ajoute Hayat Jmammou.
Le marché de l’art serait-il devenu une gigantesque bulle spéculative? Selon le président d’Artprice, Thierry Ehrmann, «le nombre d’œuvres vendues dans le monde reste relativement stable par rapport à 2013: 505 000 adjudications. Ce qui démontre l’absence de spéculation». Pour Frédéric Elkaïm, «le marché tient le choc car les fortunes des principaux investisseurs sont solides et le taux de transactions qui pourraient paraître spéculatives reste encore bas».
ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MARCHÉS
Cet expert du marché de l’art se souvient des chutes à répétition dans les années 1990, «du fait d’un vrai contexte spéculatif». Un phénomène qui a touché de plein fouet les années 2009-2010, «avec un effondrement sensationnel de 48% de la valeur du marché», rappelle Hayat Jmammou. La galeriste genevoise observe l’émergence de nouveaux segments de marché qui diversifient l’offre, satisfont la demande et atténuent le risque spéculatif. Le 24 mars dernier, le Salon du dessin ouvrait ses portes à Paris, avec des œuvres sur papier de Tiepolo, d’Ingres et de Gauguin. «Les dessins sont la colonne vertébrale de toute œuvre d’art, analyse Hayat Jmammou. Ils ont l’avantage d’avoir une valeur artistique et d’être exposés à des prix abordables dans des salons pointus.» Où on y sent moins fort l’argent que dans les foires d’art traditionnelles.
[su_service title=" Article paru dans l'édition d'avril." icon="icon: sign-out" size="30"][/su_service]
1. Les ventes Fine Art, c’est-à-dire les peintures, sculptures, volumes-installations, dessins, photographies, estampes, aquarelles, à l’exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier.
2. Le TEFAF est le seul à couvrir aussi bien les ventes d’antiquités que d’œuvres d’art de toutes époques confondues à travers le monde.
Avec de Rougement, voyage en zig-zag dans une crise pas si ancienne que cela
Le Journal d’un intellectuel en chômage tenu par le grand penseur suisse Denis de Rougemont évoque la période qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Un ouvrage à lire et relire pour prendre conscience que la déprime actuelle n’est qu’un cycle parmi d’autres, à inscrire dans une vision historique à long terme.
Le Journal d’un intellectuel en chômage tenu par le grand penseur suisse Denis de Rougemont évoque la période qui précède la Deuxième Guerre mondiale. La catastrophe économique de 1929 fait encore ressentir ses effets. Les faillites se succèdent. Les haines se lèvent. Privé de travail à Paris, l’écrivain et sa femme tentent de s’implanter en province pour retourner à Paris temporairement. Durant ce voyage en zigzag, ils rencontrent une «apathie générale» qui sonne comme un écho à l’ambiance régnant sur cette France d’aujourd’hui, de mauvais poils et de traits tirés, celle qui souffre des effets de la mondialisation avec une acuité plus vive qu’ailleurs. À lire et relire cet ouvrage, pour prendre conscience que la déprime actuelle n’est qu’un cycle parmi d’autres, à inscrire dans une vision historique à long terme. Catherine Willi retrace les grandes étapes de ce Journal. [dropcap]R[/dropcap]éédité en 2012 par les Éditions la Baconnière, le Journal d’un intellectuel en chômage a paru la première fois en 1937 chez Albin Michel. Ce Journal, qui se veut non-intime, enthousiasme à l’époque la quasi unanimité de la critique, dépassant largement les frontières des pays francophones. Ramuz et Mauriac, pour ne citer qu’eux, prennent la plume. Denis de Rougemont dit avoir rédigé ce Journal à temps perdu. Parallèlement, il travaillait à la rédaction de l’ouvrage Penser avec les mains.
Pourquoi ce Journal a-t-il remporté un tel succès? L’écriture, qui n’a pas laissé Ramuz insensible, y est d’une grande clarté. Les descriptions de la nature se transforment en évocations poétiques. Quant au contenu d’une grande richesse, qu’il s’agisse de réflexions sur la condition de chômeur, de pensées sur des lectures personnelles, d’observations sur le travail, le comportement et la mentalité des gens, il permet au lecteur d’établir des liens avec sa propre vie. Mauriac parle du sentiment qui a inspiré ce livre et qu’il ressent. Le Journal d’un intellectuel en chômage tient en 267 pages; il a été rédigé de 1933 à 1935 et il se compose d’un préambule suivi de trois parties.
1. N’HABITEZ PAS LES VILLES (NOVEMBRE 1933 – JUILLET 1934)
Nous sommes en septembre 1933. De Rougemont perd son emploi à la direction littéraire des Éditions «Je sers», suite à une mise en faillite de l’entreprise. Il vit à Paris depuis le début des années 1930. Il est reconnu dans les milieux intellectuels et littéraires pour avoir signé de nombreux articles dans différentes revues. Toutefois, il n’a pas encore publié de livre en France et n’a pas d’entrée dans la grande presse.
Il décide alors de se rendre avec sa jeune épouse sur l’île de Ré pour y passer l’hiver. Au sixième jour de son séjour, de Rougemont baigne dans le bonheur de la nouveauté et de la découverte et il écrit: «De l’île, du village, de la mer, je ne veux rien dire encore: je laisse tout cela se mêler à ma vie, dans l’heureux étourdissement de la lumière maritime.» (p. 13) Sa situation financière ne le préoccupe pas encore; d’après ses calculs, il peut vivre pendant six semaines. Il énonce alors trois aspects de sa vie qu’il va vérifier et noter jour après jour. Il s’agit premièrement du problème matériel: peut-on séjourner loin d’une ville, sans gain assuré, en vivant d’articles et de traductions? Deuxièmement, il étudiera le problème psychologique: ce choix de vie favorise- t-il l’acte d’écrire et rend-il heureux? Finalement, il se penchera sur la troisième question: le problème social, à savoir le rapport avec les indigènes.
Le 13 décembre, il reste 2 francs 50 au couple de Rougemont. Un ami, auquel l’écrivain avait auparavant prêté de l’argent, lui envoie à ce jour et par courrier 100 francs. Dix jours plus tard, de Rougemont décrit comme un échec son choix de l’indépendance financière: il accepte l’invitation de trois semaines de la part d’un ami. De janvier à mi-juin, il vit dans l’économie la plus stricte d’un travail payé d’avance.
Le 14 juin, il reçoit par courrier le chèque d’un prix récompensant un petit ouvrage écrit il y a dix-huit mois et qui lui permettra «de passer l’été ici sans inquiétude. Ou encore de le passer ailleurs sans ennui». (p. 132) Le lendemain, par lettre toujours, une amie lui propose une maison dans le Gard. Le couple fixe le départ définitif de l’île au 10 juillet 1934.
De Rougemont ne semble pas souffrir de l’instabilité due à l’incertitude financière. Tout au plus, note-t-il: «C’est lassant, le manque d’argent, à la longue.» (p. 128) Il se demande d’où lui vient le calme qu’il ressent dans cette situation matériellement difficile et il nous donne la réponse suivante, sous forme d’interrogation: «Et si je n’avais pas une croyance secrète et puissante en l’ordre significatif du monde (quoi qu’il m’advienne), ne serais-je pas désespéré, fou de possibles manques et de grandeurs inatteintes? Serait-ce donc que je crois réellement à la Providence?» (p. 69) Ce qui semblerait plus difficile dans cette situation financière précaire, c’est le rapport qu’il entretient avec son épouse: «Une remarque ironique de ma femme sur mes petits comptes avait amené la première explosion de mauvaise humeur... Je n’étais pas fier.» (p. 131)
Quand on observe la deuxième question soulevée par de Rougemont, à savoir si l’isolement est propice au travail de l’écrivain-intellectuel, il semble assez aisé de répondre par l’affirmative. En effet, il consacre l’essentiel de son temps à l’écriture et à la réflexion. C’est même durant cette période qu’il rédige en partie le livre Penser avec les mains (Paris, Albin Michel, 1936). Seuls les éléments déchaînés — une tempête de dix jours — l’empêchent de travailler sereinement et il note: «... je ne parviens plus à avancer dans mon travail. Obsession du sifflement furieusement modulé dans les cheminées et à travers le toit fragile, jour et nuit.» (p. 101)
Il reste à aborder le troisième point, l’aspect social. Et c’est cette dimension de la vie quotidienne qui fera partir le couple de Rougemont de l’île; il se rendra ensuite dans le Gard pour les mêmes raisons et, finalement, rejoindra Paris. De Rougemont, deux semaines après son arrivée sur l’île, éprouve de l’ennui à se voir observé lorsqu’il traverse la place du village. Par une comparaison avec la capitale, il minimise cet inconvénient de la province. Peu de temps après, il note qu’il ne parvient pas à partager ce qu’il fait et ce qu’il pense avec les gens de l’île. Les indigènes aiment parler du temps et d’eux-mêmes, mais ils sont incapables de poursuivre la conversation si de Rougemont oriente le sujet et propose le débat. Il éprouve alors de la gêne à avoir voulu confronter la culture et la réalité.
De Rougemont participe à la vie sociale en assistant, par exemple, à une séance de cinéma organisée par l’instituteur ou encore à une conférence donnée par le pasteur. Les gens, même les jeunes, lui apparaissent laids et il déplore le manque de conscience de la population. Ses mots sont durs, il parle de «l’apathie générale» (p. 49), d’«Impuissance de l’ ‹ esprit ›, bêtise de l’action: ces deux misères n’auraient-elles pas une origine commune?» (p. 51. Le 20 décembre, de Rougemont note qu’un écrit de Kierkegaard l’éclaire sur cette gêne ressentie en présence des indigènes.
Le philosophe danois parle de vanité ou d’orgueil quand l’admiration obtenue est prépondérante dans l’aide que l’on peut apporter à autrui. Mais de Rougemont de se justifier en écrivant: «C’est peut-être un secret désir, un inconscient désir que j’ai d’être reconnu par eux [les gens] à ma juste valeur. [...] On n’aime pas être tenu pour un feignant ou un rentier, quand on est dans ma situation.» (p. 55) Trois jours plus tard, de Rougemont écrit sur la dune: «Certains jours, on donnerait beaucoup pour une bonne raison de désespérer, pour une bonne et impérieuse raison d’abandonner cette partie mal engagée, ma vie, et de se retrouver neuf, enfantin, ou tout simplement jeune devant un présent ouvert de tous côtés...» (p. 70-71)
En février, de Rougemont semble résigné: en observant les gens travailler, il comprend que des changements opérés dans la division des terres ou dans l’utilisation d’outils mieux adaptés changeraient la condition de vie des indigènes. Mais il pense alors qu’«il faudrait croire fanatiquement à une vérité absolue, qui vaille mieux que la paix et le bonheur, pour oser bouleverser la petite vie de notre île». (p. 81) Le départ de l’île de Ré est fixé au 10 juillet. En effet, une amie met une maison dans le Gard à la disposition du jeune couple.
Et les propos datés du 20 juin sont sans appel et expliquent la raison véritable d’un changement de lieu: «Je feuillette ce journal: voici des semaines qu’il n’y est à peu près plus question des ‹ gens ›. En somme, je ne m’intéresse plus guère à leurs affaires. J’ai pris mon parti de cet équilibre indifférent et cordial qui a fini par s’établir entre nous; et il ne reste que l’ennui de nos conversations toujours pareilles.» (p. 134) Et de Rougemont de conclure: «Il vaut mieux partir quand on en est là. Quand on en est à ne plus voir le voisin, la situation n’est plus humaine, elle ne pose plus de questions utiles.» (p. 135)
2. PAUVRE PROVINCE (SEPTEMBRE 1934 – JUIN 1935)
Dès les premiers jours de son installation dans cette région de France, le Gard, de Rougemont exprime sa désillusion: «Arrivés hier matin, par Nîmes. Déjà je ne sais plus ce que j’attendais, ni ce que j’ai pu rêver de ce pays.» (p. 143) Le couple de Rougemont habite le premier étage d’une magnanerie désaffectée, bâtiment destiné à l’élevage du vers à soie. Et suite à l’industrialisation, les petites entreprises de la région font faillite, les gens vivent dans la pauvreté et la misère et leurs enfants, crasseux, traînent dans les rues.
Le ton du Journal au 20 décembre se fait cassant: «Quand je vois cette place où des retraités tirent leurs savates, quand j’écoute ce qui se dit chez la marchande de journaux, quand je m’informe des raisons de tel parti, de l’idéal de tel individu, et que je trouve partout la confusion, la dispersion, l’indifférence, une veulerie vaniteuse, ou des bonnes volontés exploitées par le plus bavard, je suis tenté d’écrire quelque chose de méchant: que ce pays est à l’image des quelques journaux qu’on y lit. Une autre impression que j’ai eue cet après-midi sur la place, celle d’être devant un film dont la musique vient de se taire.» (p. 185)
Les de Rougemont sortent de moins en moins de chez eux; ils descendent au village de préférence le soir, à la tombée de la nuit. De plus, un voisin proche, Simard le jardinier, se met à dire ouvertement du mal de l’écrivain. Le jeune couple quitte le Gard le 7 juin 1935. Cette dernière ligne éloquente clôt la deuxième partie du Journal: «Après demain, nous partons. Nous fuyons.» (p. 249) La clé de voûte des trois questions auxquelles de Rougemont souhaitait répondre dans ce Journal se laisse entrevoir à la date du 25 février. Le jeune couple souffre de sa relation aux autres qui est tout à la fois trop proche des gens indifférents du voisinage et trop lointaine d’une population locale refermée sur elle-même. De Rougemont reconnaît que son départ de l’île de Ré est également dû à une intégration sociale impossible.
3. L’ÉTÉ PARISIEN (JUILLET 1935 – AOÛT 1935)
Le couple de Rougemont revient à Paris, mais il n’y trouvera plus ses marques; tout lui déplaît: un appartement bruyant dans un bloc locatif, quelques rencontres avec des écrivains admirant les Soviets, la promiscuité des gens dans la rue et le métro. Un nouveau départ s’impose et une petite annonce d’un bien immobilier à louer sert de conclusion au Journal d’un intellectuel en chômage: «Remercier donc, et s’en aller encore. Savoir ce qui compte, et s’y tenir. Je le dis avec d’autant moins d’amertume qu’un espoir vient de m’être donné. Une feuille de papier-machine avec ce poème en prose: à Thivars, 8 kilomètres de Chartres, Petite fermette 3 pièces meublées... » (p. 267) Madame et Monsieur de Rougemont poursuivent l’aventure...
[su_service title="CATHERINE WILLI" icon="icon: keyboard-o"]
Biographie brève de Denis de Rougement
Denis de Rougemont (1906 – 1985) est un écrivain et penseur suisse ayant vécu, dès l’âge adulte, en France et aux États-Unis. Son oeuvre magistrale, L’amour et l’Occident, paraît en 1939. Il est le cofondateur du mouvement personnaliste qui est une réflexion politique, économique et sociale basée sur la personne, à savoir un individucitoyen libre et responsable. Le système d’organisation de la société qu’il prône est le fédéralisme. Partisan d’une union européenne, il devient, en 1950 à Genève, le directeur du Centre européen de la culture. Il fonde en 1963, à Genève toujours, l’Institut d’Études européennes (incorporé par la suite à l’Université) où il sera professeur. Une foi profonde de chrétien sous-tend l’ensemble de ses écrits.
Narcisse Praz, les vies tourmentées d’un heureux mortel
Il a toujours jeté ses pavés dans la mare helvétique, claire en surface, boueuse en profondeur. Et ce n’est pas à 85 ans qu’il va atteindre l’âge d’oraison. Son nouveau combat – ne parlez pas de croisade, grand Dieu! – est de rendre laïque l’État du Valais. Décidément, le rédacteur sans chef de feue La Pilule, continue à se lancer dans les défis les plus improbables. Retour sur sa vie en zigzag et visite à Derborence à ce drôle de zigue.
Il a toujours jeté ses pavés dans la mare helvétique, claire en surface, boueuse en profondeur. Et ce n’est pas à 85 ans qu’il va atteindre l’âge d’oraison. Son nouveau combat – ne parlez pas de croisade, grand Dieu! – est de rendre laïque l’État du Valais. Décidément, le rédacteur sans chef de feue La Pilule, continue à se lancer dans les défis les plus improbables. Retour sur sa vie en zigzag et visite à Derborence à ce drôle de zigue.
Mis en ligne le 28 décembre 2014 à 13:03
[dropcap]I[/dropcap]l a cherché le soleil en changeant de vallée. Narcisse Praz, de sa maison d’Aven, dernier village contheysan avant Derborence, fait face à Nendaz. C’est là qu’il est né en 1929, au village de Beuson. Fils d’un mineur réduit à la pauvreté dès le début de la Mobilisation, par la pingrerie de l’assurance militaire, il a vu sa mère trimer pour quelques sous dans la mine à charbon de Chandoline, près de Sion. Et entendu le curé du village la sermonner parce qu’elle n’avait fait que quatre enfants. «Croissez et multipliez!» Certes, mais le porteur de soutane n’avait pas trouvé le moyen de multiplier les pains. Elle vient de loin, la révolte du petit Valaisan.
Narcisse n’a pas eu le temps de se mirer dans les gouilles de montagnes. Dès neuf ans, il garde les vaches à l’alpage de Novelly pendant les quatre mois d’été. Pour salaire, un demi-fromage et pour couche, la prairie ou l’abri d’un éperon rocheux par temps d’orage. Voilà qui vous forme un caractère de cabochard aussi peu friable que ces pains noirs qu’on taille à la serpe. Et voilà qui vous oblige aussi à fouailler votre imaginaire pour vous raconter des histoires, lorsque les vaches font leur boulot de ruminants sans trop s’approcher des précipices et que l’ennui s’avance à pas de loup.
Narcisse Praz écrit comme il respire et se définit comme graphomane: romans, poèmes, pièces de théâtre — en français et en patois nendard — pamphlets, scénarios, tout y passe. Et ne pas oublier sa fonction hautement perturbatrice: allumeur de brûlots, telle La Pilule et Le Crétin des Alpes. Imagination et colère, voilà l’héritage que lui a légué le berger de neuf ans.
[su_pullquote align="right"]DES TORDUS SUR LES CHAMPS DE NARCISSE[/su_pullquote]
Dès le départ, Praz a secoué la vie qui n’a pas manqué de lui rendre la pareille. En l’écoutant, on éprouve la sensation d’être embarqué dans le grand huit des fêtes foraines. Un jour tout en haut. Un autre tout en bas. Un vrai chaos à la Derborence, sa vie. Mais comme à Derborence, des éboulements, des écroulements surgissent lac et forêt. C’est incroyable le nombre de tordus bien dans leurs droits, de prêtres bien dans leurs vices, de grands dirigeants aux mains aussi blanches que crochues, de faux anars et vrais arnaqueurs qui ont traversé les champs de Narcisse. Des champs de bataille souvent. Au fond, bien au fond, les rares personnes de confiance en affaires figurent principalement chez les contrebandiers et autres fraudeurs qui ont au moins une religion, celle la parole donnée. La seule qui vaille pour l’athée Praz.
Ayant remarqué son envie d’apprendre, les religieux de la Congrégation des Salésiens ont voulu en faire un ecclésiastique en l’envoyant étudier à Fribourg. Pour les pauvres des cantons catholiques, le séminaire constitue alors l’une des rares voies vers le savoir. Il y est resté cinq années, au cours desquelles l’expetit berger a appris, en sus du patois nendard, le français et l’allemand littéraires, le grec ancien, le latin. Il y a aussi subi les agressions pédomaniaques. Plusieurs décennies plus tard, Narcisse Praz évoquera sa douloureuse expérience «chez les talibans salésiens» dans son livre, Gare aux gorilles! (Éditions Libertaires): «Les prêtres catholiques pédophiles? Je connais. Je suis tombé dedans à l’âge de onze ans», écrit-il dès les premières lignes.
[su_pullquote align="right"]LES VOIES DE TRAVERSE DU SEIGNEUR[/su_pullquote]
Mais le Nendard est une confirmation vivante de la théorie de la résilience établie par le magistral Boris Cyrulnik. Après avoir évité la soutane, à seize ans, il prend sa salopette, son pic, sa brouette et sa pioche pour participer comme manoeuvre à la construction du barrage de Cleuson-Dixence. Plus tard, on le retrouve outre-Sarine pour y apprendre les langues vivantes dans une école privée.
Avec la caution de deux parents, il a pu convaincre la Banque Raffaisen de lui prêter 2000 francs, une jolie somme dans les années 1950, afin de payer les cours. Il en sort polyglotte et devient prof de langue au Tessin à 450 francs par mois. Lorsqu’il apprend qu’une fille de son village gagne 200 francs de plus que lui comme ouvrière dans l’horlogerie, Narcisse Praz fonce vers les brumes jurassiennes et tombe dans l’horlogerie, qui va à la fois régler et dérégler une partie de sa vie. Il faudrait écrire tout un livre — que Narcisse s’apprête d’ailleurs à publier — pour évoquer ses heurs et malheurs dans cet univers. On y apprend que la fraude et la contrebande y sont monnaies courantes. Très courantes même. Sous l’image lisse et glamour véhiculée par la publicité horlogère grouillent un arrière-monde, avec poignards dans le dos, dénonciations calomnieuses, magouilles à tous les étages. N’y aurait-il de régulier que l’imperturbable tic-tac?
Notre bouffeur de curés a même assisté en direct à la transaction entre un contrebandier transalpin qui avait pignon sur rue et pognon sur ruse, un Monsignore tout en violet épiscopal et une bonne soeur à l’esprit pratique pour organiser un passage clandestin de montres entre la Suisse et l’Italie. Les voies du Seigneur sont toujours impénétrables, surtout pour la Guardia di Finanza. Au miracle de la multiplication des pains succède celui de la multiplication des montres.
Narcisse parvient tout de même à se frayer un chemin dans cet univers en se mettant à son compte. Et gagne de l’argent. Beaucoup même. Pendant qu’il fonde une famille, court le monde avec ses montres, slalome entre les coups tordus et les déclarations au fisc fédéral, il prend le temps de sacrifier à sa drogue, l’écriture.
En 1954, son premier roman, L’Intrus, lui avait valu un prix et même un contrat pour en faire un film sous les auspices d’une grande compagnie de l’époque, la Gamma. Il était même engagé à Lausanne pour travailler à l’adaptation de son bouquin. Mais la Gamma a sombré dans la faillite par la grâce de «Lola Montès», incarnée à l’écran par Martine Carol, et, surtout, de son réalisateur Max Ophüls qui a englouti 16 millions de francs dans cette mésaventure.
Narcisse a donc dû reprendre, la mort dans l’âme, la route du Jura, pavée de montres. Une fois de plus, les tocantes permettent au scénariste fauché, en pleine gloire, de se refaire une santé financière. Une santé qui deviendra de plus en plus florissante. Question fric, il connaît la musique et sait comment s’en procurer, grâce à un sens du commerce aiguisé. Mais dès qu’il y en a trop, c’est l’ennui qui s’installe. La routine, voilà l’ennemie, bien pire que la mort.
Praz tire un trait sur le Jura pour s’installer à Paris où le Théâtre du Tertre Montmartre a accepté de monter sa pièce Le guet-apens qui deviendra, en traduction parisienne, Clock City. Le tout nouveau Parisien se promet d’ébahir son public en tournant un film qui devait être inclus au sein de la pièce. Mais l’audace ne paie pas toujours. À la répétition générale, le projecteur — que la propriétaire du théâtre avait sauvé de la poussière des accessoires — se met à bouffer la pellicule du film comme un meurt-de-faim. En catastrophe, Narcisse doit remanier sa pièce. Mais celle-ci perd de son sel. Clock City fera tout de même ses trente représentations et obtiendra quelques critiques sympathiques. Mais les planches ne sont guère lucratives, d’autant plus que la famille Praz s’est fait escroquer par l’entrepreneur censé construire leur maison en banlieue.
[su_pullquote align="right"]UNE PILULE QUI FERA DES PETITS[/su_pullquote]
Comme d’habitude, il se saisit de l’horlogerie comme d’une bouée de sauvetage. Le Parisien de Nendaz en est même réduit à faire lui-même le contrebandier. Au moment où Narcisse s’apprête à vider sa voiture des 2000 montres qui y étaient dissimulées, dans un recoin nocturne de la banlieue sud de Paris, des motards de la police foncent sur lui, demandent ce qu’il fait là.
Le contrebandier amateur a juste le temps de jeter son manteau de pluie sur les tocantes clandestines et de dire d’une voix chevrotante qu’il est perdu et cherche un hôtel. Après avoir pris ses papiers d’identité, les flics lui intiment l’ordre de les suivre. Les policiers l’escortent vers un commissariat, puis la prison, sans nul doute. Narcisse est persuadé de vivre au volant ses dernières minutes de liberté. Le convoi s’arrête place de la République. Les policiers le saluent, lui rendent ses papiers en lui désignant les hôtels du voisinage.
Il n’est pas étonnant qu’après de telles aventures, Praz soit victime d’un infarctus qu’il a soigné à domicile, se refusant à perdre son temps à l’hôpital. D’autant plus que trois des employés de sa société parisienne sont en train de le truander.Voilà l’ex-berger au fond du trou, une fois de plus.
Un coup de talon, et il refait surface. Insubmersible, le Narcisse! C’est à Genève qu’il jette l’ancre. Le temps de créer une nouvelle société, la Bourse internationale de la montre (B.I.M.) et de se lancer dans l’une de ses entreprises les plus désespérées — mais qui fut d’autant plus enthousiasmante — la création de La Pilule, hebdomadaire sans pub, sans groupe de presse, sans appuis autre que ceux de ses lecteurs. Mais avec les deniers de Narcisse Praz. La nuit, rédacteur sans chef. Le jour, vendeur de montres.
C’est l’apparition en Suisse romande d’un canard déchaîné, attaquant tous les puissants, cognant sur les militaires, matraquant les flics, vouant les curés et assimilés aux flammes de l’enfer, provoquant la polémique alors que les médias de l’époque dorment du sommeil de l’injuste, dénonçant, moquant, fustigeant, mordant, n’applaudissant qu’avec parcimonie.
Toute une génération de lecteurs et même de futurs journalistes ont ainsi appris l’irrévérence et la soif d’information authentique. Cette Pilule fera des petits en tirant jusqu’à 12 000 exemplaires; elle sort même une exclusivité qui fera le tour du monde, l’implication de la famille du Shah d’Iran dans un trafic de stups. L’empereur fera à l’insolent Narcisse un procès qui sera plus efficace que les plus coûteuses campagnes publicitaires. Mais le rédacteur sans chef et sans peur s’est créé un nombre considérable d’ennemis. Non seulement l’hebdomadaire est attaqué mais aussi la B.I.M. qui le fait vivre. L’aventure aura duré tout de même cinq ans, un record.
Pour payer ses dettes, Narcisse Praz remonte un magasin de montres à prix cassés, rue Voltaire à Genève. Son idée, mûrie dans son mobil-home installé dans un camping à Conches, entre Veyrier et Genève, tourne à plein régime. Le magasin Au Fou! (c’est son nom) ouvrent jusqu’à douze succursales dans toute la Suisse. Les dettes étant payées, le commerçant malgré lui continue cette aventure qui fonctionne selon les principes de l’autogestion. Ni patron ni employés mais seulement des humains gérant leur travail comme ils l’entendent.
Mais le paradis anarchiste est parfois pavé de mauvaises intentions. Trois aigrefins profiteront de cette liberté pour se remplir les poches au détriment de leurs «camarades» et, surtout, de Narcisse. Le ressort moral des montres Au Fou! est cassé. Narcisse quitte Genève pour retourner à Beuson. À 65 ans, il ne peut compter que sur une pension AVS de 1300 francs mensuels. Impossible de vivre en Suisse. Cette fois-ci, ce n’est pas les montres qui le sauvent mais la construction.
Narcisse achète une maisons à bas prix en France, la restaure et la revend avec bénéfice et ainsi de suite durant plusieurs années, jusqu’au retour en Valais à Beuson, puis à Aven. Il pourrait tranquillement peindre ses toiles, pondre ses poèmes, romans et pièces de théâtre en français; celles écrites en patois franco-provençal de Nendaz ont remporté de jolis succès dans les vallées.
[su_pullquote align="right"]LA LAÏCITÉ À L’ASSAUT DU VALAIS[/su_pullquote]
Tranquille, vous avez dit, tranquille? Et quoi encore? En octobre 2010, un enseignant Haut-Valaisan, Valentin Abgottson, est licencié pour avoir décroché du mur de sa salle de classe un crucifix (précision pour les non-Valaisans: cette école est... publique). Narcisse Praz saute sur cette occasion pour lancer un nouveau combat: rendre laïque l’État du Valais... Autant gravir le Cervin en tongs!
Il a donc écrit une initiative en ce sens et trouvé des appuis chez les radicaux — traditionnellement anticléricaux en Valais — et les socialistes ainsi que chez les libres-penseurs. «Mais je veux créer un mouvement citoyen et non politicien», ajoutet- il d’emblée. Parmi les personnalités qui soutiennent l’initiative figurent l’ancienne députée radicale Cilette Cretton, le journaliste (ex-parlementaire valaisan lui aussi) Adolphe Ribordy, la députée Barbara Lanthemann (PS) et le porte-parole du groupe socialiste au Grand Conseil valaisan, Jean-Henri Dumont.
Un comité s’est formé. Sa première tâche a été de transformer le texte buissonnant et foisonnant de Narcisse Praz en une initiative bien ordonnée, comme un jardin à la française. Elle s’inspire de la nouvelle Constitution cantonale genevoise qui proclame la laïcité du canton. Le Comité «Valais laïc» veut changer la constitution du canton en interdisant tout financement des cultes par les deniers de l’État ou des communes, en prohibant les signes religieux sur les édifices publics, en instaurant une «neutralité religieuse absolue». Toutefois, selon le texte proposé, l’État valaisan pourra entretenir des relations avec les communautés religieuses pour leurs activités d’intérêt général.
«Comme il s’agit d’un texte constitutionnel, nous devons récolter 6000 signatures d’ici juin 2015. Pour l’instant nous en avons obtenues un demi-millier. On peut y arriver, mais, ajoute Narcisse Praz, il ne faut pas se le cacher, la tâche est ardue. D’autant plus que la presse locale s’acharne à me présenter comme un anar qu’il faut contenir dans sa marge.» Il en faut plus pour le décourager: «J’ai envoyé, à mes frais, un ‘toutménage’ à 40 000 personnes dans le Valais romand. Et tous les vendredi matin, je prends mon petit présentoir portatif pour faire signer l’initiative sur le marché à Sion.»
Le comité s’active aussi comme autant de diables dans les bénitiers du Vieux Pays. Un comité qui morigène parfois l’octogénaire libertaire: «Ses membres me rappellent à l’ordre lorsque j’exagère dans mes propos antireligieux. Et ils ont raison, la laïcité n’est pas une arme contre les croyants; elle n’a pas d’autre visée que de séparer l’État des religions, afin que l’un et les autres vivent en pleine indépendance réciproque.» Cela n’empêche nullement Narcisse Praz de se revendiquer comme athée tout en se refusant à faire de l’athéisme une nouvelle religion d’État: «Ce serait un non-sens absolu.» Et une hérésie! Sa plus grande victoire dans la vie? «C’est lorsque je me suis accepté comme mortel. Depuis je vis pleinement heureux en goûtant chaque instant.» Et sous Derborence dorée par l’automne, ces instants-là sont divins.
L’insolent matou de la révolution tunisienne
Les artistes de Tunis ont investi l’ancien palais des flics de Ben Ali pour transformer ses murs en lieu de création. Parmi eux, la dessinatrice Nadia Khiari qui a lâché son chat Willis à la barbe des benalistes et des... barbus. Symbole de la Révolution de Jasmin, il n’a pas fini de miauler sous les fenêtres de tous les empêcheurs de vivre en liberté.
Les artistes de Tunis ont investi l’ancien palais des flics de Ben Ali pour transformer ses murs en lieu de création. Parmi eux, la dessinatrice Nadia Khiari qui a lâché son chat Willis à la barbe des benalistes et des... barbus. Symbole de la Révolution de Jasmin, il n’a pas fini de miauler sous les fenêtres de tous les empêcheurs de vivre en liberté.
Mis en ligne le 6 décembre 2014 à 16h57
[dropcap]J[/dropcap]eudi 13 janvier 2011 est une date clé dans l’Histoire de la Tunisie. Tout d’abord, elle célèbre la naissance du chat Willis from Tunis par la grâce, non du Saint-Esprit, mais du crayon de la dessinatrice Nadia Khiari. Ensuite, ce jour a donné l’occasion au dictateur tunisien Ben Ali de prononcer un ultime discours avant de se faire «dégager» par son peuple.
Ulcérée par les propos du tyran qui déblatère au micro, Nadia Khiari crayonne ses pages blanches et Willis from Tunis apparaît.La Révolution tunisienne prend de l’ampleur. Willis from Tunis devient alors le commentateur de cette brûlante actualité sur les réseaux sociaux. Le succès est foudroyant. En une semaine, Nadia et Willis récoltent 900 «amis» sur Facebook. Ils seront bientôt 15 000.
Insolent, narquois, moqueur, pertinent dans son impertinence, griffant là où ça fait mal, feulant contre le clan au pouvoir, léchant les plaies morales d’un peuple qui craint que sa Révolution ne lui soit dérobée par la bande des barbus, Willis from Tunis fait son boulot de chat qui est de donner aux humains le goût de la liberté. Il est désormais l’une des figures les plus évocatrices du printemps tunisien. Lorsque le pouvoir benaliste a été éjecté, Nadia Khiari a réuni ses dessins et les interventions de Willis from Tunis dans un recueil intitulé Chroniques de la Révolution. Les lecteurs se sont rapidement arrachés cet ouvrage, tiré tout d’abord à 5000 exemplaires à compte d’auteur.
[su_pullquote align="right"]RECONNAISSANCE INTERNATIONALE[/su_pullquote]
Depuis, le malicieux talent de la dessinatrice tunisienne a été reconnu, non seulement dans son pays, mais aussi hors de ses frontières. Nadia Khiari a reçu en avril 2012 le Prix Honoré Daumier à Caen (France) ainsi qu’en septembre 2013, le titre de Docteur Honoris Causa à l’Université de Liège. Elle a été couronnée cette année à Forte dei Marmi (Italie) et a représenté la Tunisie au Festival de Cannes 2014 lors de la présentation d’un ouvrage illustré par des dessinateurs-éditorialistes (dont la créatrice de Willis) et intitulé Les dessins de la liberté. Cette initiative était due au dessinateur du Monde Plantu et à l’association Cartooning for peace qu’il préside.
[aesop_image imgwidth="1021px" img="http://lacite.website/main/wp-content/uploads/2015/07/tunisie_matou_3.jpg" offset="-185px" align="left" lightbox="off" captionposition="left"]
Nadia Khiari a souvent résidé en France, notamment à Bordeaux et à Aix-en-Provence où elle a fait ses études. Aujourd’hui, elle enseigne à l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis et tient dans cette capitale, une galerie d’art qui a pour nom «Artyshow», un légume pourtant peu apprécié par les chats. Bien entendu, Willis from Tunis continue à friser ses moustaches dans la presse tunisienne (ainsi qu’à Siné Mensuel) en commentant l’actualité de façon grinçante et griffante.
Après le départ du clan Ben Ali et de ses tortionnaires, Nadia et Willis ont souvent hanté une maison située sur les hauteurs de Tunis. Elle appartenait à des membres des services (sévices?) de sécurité qui ont fui en même temps que le despote. Les artistes tunisiens l’ont aussitôt investie pour la transformer en un lieu de création en liberté.
Cette maison, un photojournaliste français, Arnaud Galy, l’a photographiée sous tous ses angles lors d’un reportage à Tunis. Né en 1965 à Dugny, près de Paris, il est établi en Dordogne et dirige le magazine en ligne consacré à la francophonie, ZigZag (www.zigzag-francophonie.eu), partenaire de La Cité. Arnaud Galy est également à la tête de la plateforme www.agora-francophone.org et de la revue «papier» L’année francophone.
Voici quelques unes des photos qu’il a prises lors de ce reportage à Tunis. Elles révèlent l’art qui vient d’être délivré de ses chaînes. Il est alors en pleine force ascendante. C’est la poésie à sa source même qui jaillit, éclabousse, nettoie, débarrasse des vieilles crasses tenaces. On y entend le rire libérateur. Ce rire qui, parfois, trop rarement, parvient à démolir les murs.
Un monument au-delà de toutes les frontières, malgré tout
À Mostar, l’architecte Bogdan Bogdanovic a créé son cimetière des Partisans. Une oeuvre commandée par Tito mais qui s’est affranchie des codes du réalisme socialiste et du pouvoir politique. Visite dans ce lieu où le surréalisme rend la vie aux pierres mortes.
À Mostar, l’architecte Bogdan Bogdanović a créé son cimetière des Partisans. Une oeuvre commandée par Tito mais qui s’est affranchie des codes du réalisme socialiste et du pouvoir politique. Visite dans ce lieu où le surréalisme rend la vie aux pierres mortes. [dropcap]L[/dropcap]a ville de Mostar est connue pour son Vieux Pont. Il fait désormais figure de symbole de la réconciliation et de la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine, après les conflits de 1992-1995. Au-delà de l’ouvrage d’art, le passant peut entrevoir un passage discret qui mène au cimetière des Partisans. Il fait partie des lieux de mémoire emblématiques élaborés par l’architecte Bogdan Bogdanović, né en 1922 à Belgrade et décédé en 2010 à Vienne.
Cet ensemble monumental, érigé à flanc de colline et de forme inhabituelle pour un cimetière, célèbre le souvenir des partisans antifascistes morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Les ouvriers ont tout d’abord dynamité une partie de la colline pour ensuite entamer un chantier qui a commencé en 1960 pour ne s’achever que cinq ans plus tard. Sur le site, un chemin d’une largeur de quatre mètres environ longe le parc sur un de ses côtés et conduit, par un parcours tout en courbes, vers son point culminant. Plusieurs voies arrivent ainsi des autres côtés du parc, surplombant quelques esplanades qui semblent avoir servi jadis de bassins. Les murs et les sols sont formés de pierre grise, sorte de calcaire taillé en losange, en octogone asymétrique ou sous forme de grands blocs rectangulaires. Conséquence de longues périodes sans entretien (excepté quelques rénovations en 2003), l’ensemble est envahi de ronces et d’arbustes, barbouillé de graffitis et jonché de déchets.
Au détour de ce gigantesque parc surgissent quelques groupes de jeunes ou des joggeurs. La partie surplombante du mémorial, très impressionnante, contient davantage d’éléments décoratifs abstraits et d’ornements inspirés du surréalisme. Sitôt franchies de grandes portes à ciel ouvert, apparaissent divers objets disposés au bout du mémorial. Très discrètes, des pierres sculptées de façon sinueuse sont déposées, accompagnées d’inscriptions à la mémoire des partisans. Plus récemment, des visiteurs ont installé des tissus blancs recouverts d’autres inscriptions en serbo-croate ainsi que des couronnes tressées avec du blé. Il s’agit de la partie funéraire du monument où les corps des partisans sont enterrés. Le parc est appelé acro-necropole par Bogdanović, qui tire son inspiration du terme antique acropole (ville haute) et necropolis (espace funéraire). Le parc possède la particularité de servir autant de lieu de recueillement et de mémorial à la gloire des vainqueurs de la lutte contre le fascisme.
Cette conception du monument est propre à l’idéal socialiste de l’époque et contraste avec une conception plus contemporaine des mémoriaux. En effet, après la monumentalité et la représentation des vainqueurs, les monuments, au travers d’un changement de modèle esthétique, vont peu à peu représenter les victimes, après les guerres des années 1990. Le mémorial de Srebrenica, cimetière dédié aux victimes du génocide de juillet 1995, les pierres commémoratives ou les monuments aux morts qui longent les routes de la Bosnie-Herzégovine en sont les illustrations les plus évocatrices.
L’HÉRITAGE DU SURRÉALISME
Le cheminement et la déambulation, malgré l’ascension qui mène à la partie surplombante, sont plus marqués par la sensation d’horizontalité que par celle de verticalité, propre à l’architecture typique de cette époque. Cette volonté d’horizontalité et d’extension plutôt que d’élévation est la marque d’une «anti-monumentalité » qui s’inscrit dans l’histoire de l’architecture. En plus du sentiment de grandeur, le visiteur éprouve l’impression de se mouvoir dans un espace sinueux et labyrinthique, au sein d’un univers futuriste ou à l’intérieur d’un temple antique.
Ces caractéristiques ne permettent pas de dédier le parc à un style unique et rappellent à la fois les idées du courant surréaliste qui a traversé le XXe siècle et la massivité des sculptures socialistes. Mêlant ces multiples champs d’inspirations, Bogdanović semble avoir ajouté une dimension critique à l’architecture classique du réalisme socialiste par le biais de la fantaisie, de l’extravagance des ornements et des formes abstraites.
À l’époque de la construction du cimetière, pour des raisons principalement politiques, plusieurs mémoriaux et monuments dédiés aux batailles de la Seconde Guerre mondiale et aux sites des camps de concentration étaient commandités par Tito. Le mot d’ordre du régime visait à construire une identité yougoslave unifiée, sous l’égide de la lutte commune contre le fascisme, avec pour slogan «unité et fraternité». Les monuments étaient alors utilisés pour créer une conscience de classe, un élan vers la collectivité et une transmission des idées révolutionnaires. Il s’agissait d’embellir le passé comme gage potentiel d’une mainmise sur le futur.
Le style de Bogdanović, tel qu’on le remarque dans le cimetière des Partisans, met en évidence les relations entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et les pays dits socialistes, formées de moments d’alliances et de désaccords durant la Guerre froide. On peut noter dans ce témoignage de l’histoire de l’art de cet «ancien pays» socialiste, un écart sensible avec les canons artistiques de l’Union soviétique.
Certes, dans le cimetière de Bogdanović, le point de focale est centré sur la mort des partisans. Toutefois, il n’y figure aucune représentation glorifiant travailleurs, paysans ou représentants politiques, contrairement aux codes du réalisme socialiste créés sous Staline. La commande de Tito s’inscrit donc dans la lignée de l’art socialiste par la monumentalité de son architecture, sa volonté de valoriser le passé socialiste et antifasciste, et la glorification, même discrète, des partisans décédés pour leur patrie. Pourtant, l’originalité de cette architecture l’apparente aussi à une tradition moderniste de la sculpture abstraite ou surréaliste, donnant ainsi à l’oeuvre une dimension qui ne dirige pas le visiteur vers une lecture unique.
De 1922 à 1939, la scène artistique de Serbie, spécialement à Belgrade, a connu une forte présence d’artistes — principalement des écrivains et dessinateurs — qui se revendiquaient du surréalisme. Bogdanović, sans pour autant être affilié à ce mouvement, intègre les idées du surréalisme; cela s’explique, dans la majeure partie de ses constructions, par la recherche de formes qui puisaient leurs inspirations dans les constellations solaires, les formes organiques, dans l’ornementation et par son refus de tout réalisme. Ainsi, il n’a jamais représenté de figure humaine.
Dans le surréalisme, la créativité repose sur l’utilisation de formes, auparavant négligées, comme l’association d’idées, le rêve, le jeu de la pensée et l’absence de tout contrôle sur la raison. Le surréalisme représente pour les artistes d’alors un moyen de lutter contre les codes préétablis de l’art qui permettent de le déchiffrer et de le comprendre. L’utilisation spécifique dans son cimetière de formes faisant appel à l’imaginaire et à l’organique, laisse à penser que Bogdanovic a voulu emprunter d’autres chemins que ceux de la figuration, du symbole déchiffrable et du discours esthétique préfabriqué.
LA SCULPTURE COMME LIEU
Au même titre qu’un parc, ce lieu rassemble. Ces aspects rappellent certaines initiatives artistiques comme les sculptures du Land Art aux États-Unis. En effet, durant la même période que Bogdanović, des artistes du Land Art, comme Robert Smithson et la célèbre «Spiral Jetty», ont repensé la sculpture de manière innovante.
Partis d’une volonté de sortir de l’espace du musée et de la galerie, ces artistes intervenaient en pleine nature et construisaient des sculptures formées d’éléments naturels ou de matériaux simples, soumis à l’érosion et à l’écoulement du temps. Un peu comme celles de Bogdanović, ces sculptures à ciel ouvert étaient de taille importante et, de façon encore plus marquée, s’étendaient beaucoup plus qu’elles ne s’élevaient. Les sculptures devenaient aussi des lieux de passage où les héros et la monumentalité verticale avaient disparu. Ce qui restait jusqu’alors dans les marges — la déambulation, l’espace, l’imagination et la nature — se trouvait désormais au centre de la perception.
L’engagement de Bogdanović auprès des partisans dans la résistance contre l’armée allemande en 1941 explique le rôle central qu’il a joué par la suite, en tant qu’architecte, dans l’histoire politique et artistique de son pays. En effet, peu après la guerre, il commence sa longue carrière d’architecte pendant laquelle il réalise, toujours sous la commande de Tito, plus de vingt monuments en hommage aux victimes de la guerre et du fascisme. En 1993, il est contraint de fuir son pays après s’être opposé tant au régime de Milosevic qu’à la montée des nationalismes dans l’ensemble de l’espace balkanique.
Dès les années 1980-1990, la République fédérative socialiste de Yougoslavie a connu la montée de l’ethno-nationalisme, renforcée au moment de la Chute du Mur. Les monuments socialistes ont dès lors souvent été démolis ou détériorés dans le but d’éradiquer cette partie du passé et de créer des nouvelles identités par un retour à des traditions plus anciennes. Le mythe d’un futur utopiste qui avait marqué la période socialiste est remplacé par un mythe ethno-nationaliste du retour vers le passé, au service d’une décennie de conflits.
De manière générale, Bogdanović fut avant tout préoccupé par le contexte yougoslave durant toute la période de l’après-guerre et cela jusqu’à la fin de sa vie. Il adopta une position critique face aux divers conflits liés aux nationalismes et écrit au sujet de ses monuments: «Oui, ils sont archaïques, ils pourraient très bien être des monuments sumériens. Pour éviter les finesses des nationalismes, qui cherchent toujours à savoir si telle forme leur appartient ou non, tout ce que j’ai fait aurait pu être l’oeuvre des origines de la civilisation. Et je pense que c’était la formule de réussite de ces monuments; j’ai toujours évité les spécifications nationales.»
Au sujet des formes que devrait prendre une oeuvre artistique, il existe depuis toujours une polémique entre abstraction et réalisme ainsi qu’entre subjectivité et didactisme. Comme le souligne Bogdanović, l’art n’est pas qu’un instrument esthétique, il relève aussi de la politique. Éviter, contourner les spécificités nationales? N’est-ce pas justement ce dépassement de frontières revendiqué par la pensée surréaliste? Cette tension sur les formes que peut prendre une création artistique pourrait contribuer aujourd’hui à alimenter les initiatives mémorielles et de transmissions du passé. À travers le cimetière des Partisans à Mostar se dessine une tentative de créer un espace qui permette, par les moyens de l’art, de se remémorer le passé, tout en utilisant des formes imaginaires et un montage poétique. Cette démarche offrirait au spectateur sa liberté d’interprétation, grâce à de multiples lectures, et l’inviterait à s’approprier le lieu.
Mais l’abandon partiel du cimetière des Partisans souligne les difficultés que traverse actuellement la Bosnie-Herzégovine. Par le passé, le cimetière célébrait la mémoire des vainqueurs de la lutte contre le fascisme; il évoque, aujourd’hui, l’oubli.
[su_service title="CÉCILE BOSS" icon="icon: keyboard-o"]Assistante au Programme Master de recherche CCC (Critical Curatorial Cybermedia Studies) de la Haute école d’art et de design (HEAD), Genève.[/su_service]
[su_service title="YAN SCHUBERT" icon="icon: camera-retro"]Historien et chercheur associé à la HEAD, Genève[/su_service]
Ces pages achèvent une série d’articles publiés en collaboration avec le projet PIMPA sur la construction de monuments et sur des initiatives mémorielles dans des régions en conflit ou en situation de post-conflit. Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), ce projet est réalisé au Programme master de recherche Critical Curatorial Cybermedia à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.
El-Medina, une histoire suisse
La Cité présente «El-Medina – Entre ici et là-bas», un album de bande dessinée qui sort de la production courante puisqu’il aborde un thème très peu évoqué par le neuvième art, à savoir le parcours en zigzag d’une famille de réfugiés entre le Kosovo et la Suisse. Paru aux Editions Antipodes à Lausanne, il est dû aux talents conjugués de la dessinatrice Gabrielle Tschumi (32 ans) et de la scénariste Elmedina Shureci (26 ans).
La Cité présente El-Medina – Entre ici et là-bas, un album de bande dessinée qui sort de la production courante puisqu’il aborde un thème très peu évoqué par le neuvième art, à savoir le parcours en zigzag d’une famille de réfugiés entre le Kosovo et la Suisse. Paru aux Editions Antipodes à Lausanne, il est dû aux talents conjugués de la dessinatrice Gabrielle Tschumi (32 ans) et de la scénariste Elmedina Shureci (26 ans). L’une et l’autre se lancent pour la première fois dans la BD. [dropcap]E[/dropcap]l-Medina – Entre ici et là-bas... Voilà un album que chaque Suisse devrait lire avant de glisser dans l’urne son bulletin de vote à l’occasion de la énième initiative de l’UDC, le parti de la xénophobie monomaniaque et bégayante. Dans les discours politiciens — politicards serait le terme plus approprié — l’immigration est perçue presqu’uniquement sous forme de chiffres.
Un seul angle de vision, la quantité. L’humain étranger est perçu comme une donnée statistiques à l’égal des tonnes de bananes importées. La vie est absente. Et c’est de propos délibéré qu’elle est éjectée, afin de laisser la place à la propagande hypercalorique et aux caricatures du style mouton noir.
Dans El-Medina, il n’y a pas de moutons noirs mais des humains dans les multiples nuances de gris que nous offre l’existence réelle. Il n’y a ni méchants Suisses, ni gentils réfugiés, ni l’inverse mais seulement des gens qui se débattent au milieu des problèmes personnels et des convulsions géopolitiques. La vie quoi! Qui vous réserve ses coups en vache, ses embellies, ses espoirs déçus et ses désespoirs propices aux rebonds.
Cette histoire est celle qu’Elmedina Shureci a vécue. Née au Kosovo, d’un père albanais et d’une mère albano-serbe, elle suit sa famille en Suisse dès l’âge de 11 ans, au Tessin tout d’abord, puis — après des allers-retours entre le Kosovo et la Suisse ainsi qu’un intermède en Allemagne —, à Lausanne où Elmedina Shureci, devenue Suissesse, continue à résider.
C’est aussi la mise en lumière d’une mère admirable qui lutte contre un cancer, contre les haines communautaires, contre la violence de son mari buveur. Mais qui se bat surtout pour. Pour assurer à Elmedina et à son jeune frère un avenir digne et libre.
Cette histoire est enfin celle de notre pays, formé d’hommes et de femmes qui y ont fait souche, après avoir été rejetés de leur sol natal par les violences politiques, économiques ou religieuses.
Ce qu’Elmedina Shureci a éprouvé, les Huguenots fuyant les dragonnades de Louis XIV, les Italiens du Mezzogiorno quittant une terre sans pain, les Somaliens s’extirpant d’un pays livré à la guerre civile et tant d’autres encore, l’ont ressenti. Le désespoir d’abandonner les siens. La peur au passage des frontières. Les humiliations bureaucratiques du pays d’accueil. La méfiance des voisins de palier. Et aussi, le bonheur, quand tout va bien, d’être accepté et de recevoir ce passeport à croix blanche, rouge sésame vers une vie normale.
Tous ces destins particuliers ont tissé un pays. Le nôtre.
POUSSIN, LE MÉMORIALISTE DES MARAIS D’AMNÉSIE
Son dernier album vient de sortir. Téléportation quantique vers les animaux d’avant l’apparition de la vie. Avec des préfaces de Siné, Sorj Chalandon et Zep.
Son dernier album vient de sortir. Téléportation quantique vers les animaux d’avant l’apparition de la vie. Avec des préfaces de Siné, Sorj Chalandon et Zep. [dropcap]G[/dropcap]râce à Poussin, efforcez-vous de devenir enfin intelligent, comme un enfant. Un enfant d’avant l’école, bien sûr. Un enfant dieu, créateur de l’éternel présent. Un enfant vieux, comme le monde.
Le dessinateur universellement carougeois Gérald Poussin sert de guide, indispensable agent pour mieux vous perdre. Car il faut toujours se méfier des guides qui vous mènent quelque part. Avec eux, la vérité n’est qu’un mensonge parmi d’autres. Préférons le guide qui ne sait pas où aller mais qui s’y rend avec autant de confiance que de détermination. Poussin est une bonne étoile.
Suivons-la, jusqu’à cet album qui vient de sortir aux «Cahiers dessinés». Préfacé par Siné, Sorj Chalandon et Zep, Le catalogue des animaux disparus dans les Marais d’Amnésie dévoile la création d’avant la Création. La création minuscule qui n’avait pas encore fait pousser une majuscule à son C censée hausser son sens.
Le mémorialiste amnésique avertit d’emblée (de crainte, sans doute, qu’il n’oublie cet exorde): La plupart des animaux de ce catalogue sont nés avant qu’il y ait de la vie sur terre. Notez-le, il précise bien, «la plupart», mais non la totalité des animaux. Il en est donc, dans cet opus, qui sont nés APRES l’apparition de la vie sur terre. Et qui donc? Eh bien, c’est vous, gros malin de lecteur!
Vous apprendrez ainsi qu’une masse de pigments de couleurs sur l’étang donnera naissance, au bout de la chaîne évolutive, aux Beatles que Poussin écoute en dessinant. Remarquez son éclectisme, outre les scarabées de Liverpool, il fait courir son crayon avec Debussy, Ravel, les musiques indiennes, Bashung, Manset.
Vous allez devenir familiers de personnages tellement étonnants qu’ils poussent le vice jusqu’à vous ressembler… Si, si! Nous avons tous quelque chose du Bûroûbû, des Hyponponcondriaks qui ont peur d’avoir un zabubon ou une mycoluque à la nuque, de l’inventeur des salles d’attente, des Faignouzares, tellement crevés qu’ils ne peuvent même plus jouer à la bête à deux dos, des moules à bascule (à ne pas confondre avec les moules à gaufre, apanages exclusifs du capitaine Haddock), de Furluflu et Flatatoune, des Knuflus, ces personnages tellement laids que même la vase refusait de communiquer avec eux (il paraît que des spécimens se seraient emparés de la Corée du Nord). Et que dire des Souffreteux qui, vivant les pieds dans l’eau, imploraient leur chaman de faire advenir l’ère du béton? Du Rututu, fuyant devant ses responsabilités paternelles?
Des éponges qui, à l’époque, servaient d’églises? Et mille grâces soient rendues aux Nurfluluches et autres bactéries créatrices! Par elles, nous disposons de ce fleuve épais et nourricier qui a pour nom, pétrole, dispensateur des biens si précieux que sont les bouchons sur l’autoroute les dimanches de ski, les votations multiples sur la traversée de la Rade et la jolie ronde des sacs en plastique au milieu des océans.
Ce Catalogue des animaux disparus dans les Marais d’Amnésie est d’autant plus un événement que cela faisait depuis 2006 et sa Prise de bec que Poussin ne nous avait plus régalé d’un album.
Il faut dire qu’entretemps, l’artiste n’est pas resté à paresser dans les paradis fiscaux plein de glands apportés par un oiseau esclave. Il a créé des peintures murales, notamment à Carouge, à la Gare du Flon, à l’hôpital de Sion, et même au Service des passeports à Onex. Si un porteur de casquette vous cherche des crosses à la frontière, présentez-lui un dessin de Poussin, au lieu de vous tirer des flûtes. C’est magique pour être propulsé aux Violons.
Surtout, il poursuit son oeuvre picturale. Gérald Poussin se trouve actuellement au mitan d’une série inspirée par les sentiers de l’Inde et les rivières du Tessin. A moins que ce ne soit l’inverse. Avec lui, on ne sait jamais... Mais on apprend toujours.
L’art aux prises avec l’impossible mémoire ex-yougoslave
Milica Tomic et Aleksandra Domanovic témoignent de façon fort différente l’une de l’autre, de la complexité «monumentale» à représenter le passé, même récent.
Milica Tomic et Aleksandra Domanovic témoignent de façon fort différente l’une de l’autre, de la complexité «monumentale» à représenter le passé, même récent. [dropcap]M[/dropcap]aints artistes se sont confrontés aux conséquences des guerres en Yougoslavie, notamment Milica Tomic et Aleksandra Domanovic. Une génération les sépare; leur expérience singulière du conflit contribue à façonner des points de vues différents sur les questions mémorielles. Milica Tomic, née en 1960 à Belgrade (actuellement en Serbie) est ébranlée dans sa pratique de la sculpture par la violence du conflit.
Elle commence son oeuvre par un travail de performance et de vidéo sur la construction de l’identité. En 2002, la municipalité de Belgrade lance un concours pour ériger un «monument dédié aux guerres sur le territoire de l’ex-Yougoslavie». L’artiste participe alors à un groupe de discussion. La succession de concours lancés sans succès et la difficulté à nommer le projet alimente les controverses au sein du groupe et témoigne de l’impossibilité de l’opération. Les débats conflictuels finissent par diviser l’entité.
De cet écueil émerge un nouveau collectif qui choisit de prolonger le dialogue par une série de débats publics et d’actions participatives. Grupa Spomenik (Groupe Monument) réunit aussi bien des artistes que des théoriciens et s’entoure d’étudiants, de philosophes, d’anthropologues, de psychanalystes et de théoriciens en sciences politiques. À l’occasion de divers projets, le groupe investit le lieu d’exposition pour le transformer en forum de discussion, en centre de documentation et, depuis 2008, en lieu d’édition d’un journal que les membres définissent comme un «monument distributif», favorisant la prise de parole autour du génocide en Bosnie-Herzégovine.
En 2009, Milica Tomic initie un deuxième groupe de travail intitulé Four Faces of Omarska (Les quatre visages d’Omarska), à nouveau composé d’un grand éventail de chercheurs en sciences sociales et humaines. Le groupe se propose de comprendre et de contribuer à transformer les expériences des personnes dont les vies ont été bouleversées par ce qui s’est passé à Omarska.
Cette ville, actuellement située non loin de Prijedor, dans la Republika Srpska, entité serbe de Bosnie-Herzégovine, fut le lieu d’implantation d’un camp de concentration où furent principalement détenues des populations bosniaques et croates, à partir de 1992. Situé actuellement sur un site minier appartenant à ArcelorMittal, le lieu du camp est pratiquement inaccessible aux familles des victimes et aux commémorations. Four Faces of Omarska a lancé des actions afin de susciter une prise de conscience quant à l’absence de reconnaissance des crimes commis dans le camp auprès des autorités locales et des propriétaires de la mine. Le groupe est allé jusqu’à revendiquer la tour ArcelorMittal du parc olympique de Londres, dessinée par l’artiste indien Anish Kapoor, comme un «monument en exil» pour les victimes du camp d’Omarska, d’où provient le métal utilisé pour la tour.
MOMENTS DÉCONNECTÉS DE L’HISTOIRE
Aleksandra Domanovic, née en 1981 à Novi Sad (actuellement en Serbie) s’intéresse, elle, aux périodes connexes aux conflits, une manière pour elle de commenter les conséquences des guerres et de refléter une certaine histoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Sa pratique artistique explore la circulation et la réception des images, en particulier quand ces dernières changent de sens selon les contextes et les circonstances historiques.
D’abord basée sur l’observation des nouveaux médias, en révélant, notamment, le sens géopolitique des noms de domaines, elle développe depuis quelques années une analyse des images et des discours de l’avant et de l’après-guerre, avec des incursions semi-autobiographiques. Elle révèle par exemple l’obsolescence du nom de domaine de la Yougoslavie, .yu, en l’utilisant pour sa valeur homophonique dans le titre anglais d’une exposition à la Kunsthalle de Bâle en 2012 From yu to me. Dans un essai vidéo, elle étudie l’émergence dans les républiques d’ex-Yougoslavie d’une typologie de sculpture publique issue de la culture populaire occidentale et intitule le phénomène Turbo Sculpture, titre également de la vidéo. En empruntant le suffixe turbo, utilisé dans Turbo-folk pour définir le style hybride de musique balkanique, Aleksandra Domanovic observe les monuments déconnectés de l’histoire récente et traumatique du lieu et représentant des personnages de fiction comme Rocky Balboa ou des acteurs comme Johnny Depp ou Bruce Lee.
Son intérêt porte également sur les monuments du régime socialiste endommagés par les guerres et abandonnés par les nouveaux pouvoirs publics. Elle réalise des répliques de certaines formes issues des mémoriaux de l’un des architectes incontournables de la Yougoslavie, Bogdan Bogdanovic. Son style singulier entre art décoratif et modernité représente l’indépendance de la Yougoslavie de Tito face au vocabulaire architectural des deux blocs antagonistes de la Guerre froide, l’est et l’ouest. Afin de réfléchir à la position de cette alternative yougoslave, Aleksandra Domanovic réalise ces répliques en tadelakt, un enduit typique du Maghreb, rappelant ainsi le lien oublié entre le Maroc et la république socialiste au sein du mouvement des pays non-alignés
SENTIMENTS AMBIVALENTS DE NOSTALGIE
Le portrait du général Tito, omniprésent dans l’enfance de l’artiste, est détourné selon la ressemblance qu’Aleksandra Domanovic lui trouvait avec sa maîtresse d’école. Apparaissant ainsi sous des traits féminins, le portrait semble osciller entre figure autoritaire et maternelle, reflétant ainsi la complexité du rapport des ex-yougoslaves à cette figure historique prépondérante. Chacune des oeuvres de l’artiste intervient comme un symbole de l’ambivalence du sentiment de nostalgie de la période précédant les violences. Elles évoquent également le vide, dans l’époque contemporaine, d’initiatives valables des pouvoirs en place.
Bien que très diverses, les approches de ces deux artistes apportent un regard critique sur l’utilisation, voire l’instrumentalisation de l’art public par le politique, en particulier dans son rapport problématique à la complexité des mémoires, qu’elles soient personnelles ou collectives. Chacune à sa manière, Milica Tomic et Aleksandra Domanovic contribue au débat, à la création de discours et de savoir, en évitant soigneusement le jeu de la commande publique et de l’éventuelle récupération par le pouvoir politique.
[su_service title="DENIS PERNET" icon="icon: keyboard-o"]Commissaire d’exposition, chercheur associé PIMPA[/su_service]
Cet article est publié en collaboration avec le projet PIMPA sur la construction de monuments et sur des initiatives mémorielles dans des régions en conflit ou en situation de post-conflit.
Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), ce projet est réalisé au Programme master de recherche Critical Curatorial Cybermedia à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.
Srebenica, lieu de mémoire et d’oubli
Dix-neuf ans se sont écoulés depuis le massacre de Srebrenica, qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en 2004.
Dix-neuf ans se sont écoulés depuis le massacre de Srebrenica, qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en 2004. Environ 8000 hommes et adolescents ainsi que quelques femmes ont été tués par l’armée de la République serbe de Bosnie, menée par le général Ratko Mladic, dans l’enclave musulmane de Srebrenica protégée en théorie par les Nations Unies. Alors que Mladic a commencé sa défense au TPIY à La Haye en mai dernier, quelques notes sur des lieux où il reste encore à faire mémoire. [dropcap]O[/dropcap]n roule. Depuis plusieurs heures déjà. Secoués par les cahots des routes de graviers et de terre rouge. On est passé devant des maisons et des fermes isolées avant de s’enfoncer dans des forêts où l’on croise des panneaux avertissant du danger des mines toujours présentes. Ces routes de montagne font office de routes principales dans cette région reculée. Que cherche-t-on vraiment? La route de terre se sépare en deux, on bifurque dans un nuage de poussière sur la droite. «Là! Ici... ça te dit rien? On dirait la scierie où il y a eu les exécutions.» «Tu es sûr?» «Oui, je crois. Regarde, tu ne reconnais pas les bâtiments, ceux qu’on peut voir dans le documentaire?» «Je ne sais pas. On s’arrête et on va voir.» On est devant une scierie qui semble abandonnée mais qui se révèle encore en activité, au milieu de nulle part: Zeleni Jadar.
À gauche, une poignée d’hommes travaillent au loin. À droite, on longe une série de petits bâtiments, aux toits écroulés par endroits et aux murs criblés d’impacts de balles. Il n’y a plus de fenêtres, que des ouvertures béantes sur des pièces vides sur lesquelles la nature a repris ses droits: de jeunes arbres poussent à l’intérieur. Encore quelques pas et apparaît un hangar, vide lui aussi. On se dirige vers ses portes en tôle ondulée qui ne ferment plus. Personne n’ose entrer. Ce lieu dégage quelque chose d’indescriptible.
Depuis le seuil, on se dit tous en silence que c’est peut-être là que des centaines, voire des milliers d’hommes ont été emmenés et forcés de rester des jours durant avant d’être exécutés, loin de la ville, à l’abri des témoins. C’est comme si l’on ravivait la mémoire par notre présence. Il ne reste que la coque, l’enveloppe du souvenir de ces évènements. Le souvenir est-il une projection? C’est en tout cas une reconstruction des faits. C’est une mémoire extérieure aux évènements, un récit que l’on a intégré et dont on investit maintenant l’espace. L’imagination permet de se projeter dans l’histoire d’un tel lieu — qu’il ait été réellement le témoin d’exécutions ou non.
On reste longtemps à observer le hangar et les bâtiments vides, puis on rebrousse chemin. On remonte en voiture, toujours en silence, pour partir de nouveau dans la forêt. Par ces mêmes forêts environnantes, des habitants musulmans de Srebrenica ont fui en juillet 1995 en direction de Tuzla pour sauver leur vie.
Une fois les estomacs dénoués, les langues se délient. On partage impressions, avis et questions: pourquoi n’y a-t-il pas une seule plaque, un seul signe de ce qui a pu se passer en ce lieu? Où est la mémoire officielle d’un tel endroit? On est habitué à être pris par la main, à être accompagné, par un guide ou des panneaux, dans tous les musées et mémoriaux qui sont apparus depuis plusieurs décennies sur des territoires qui ont connu des conflits.
Les lieux sont généralement délimités, nettoyés, aménagés, conservés pour permettre aux touristes de visiter, aux familles des victimes de se recueillir et aux autorités d’instaurer un discours. Des cartels, des notes explicatives, de longs extraits de journaux, carnets de notes, correspondances et lettres officielles sont exposés pour faire état des micro-histoires qui ont été balayées par les guerres et les crimes de masse. Quasiment vingt ans après les évènements, il reste encore tout à faire dans un lieu comme celui que nous venons de voir.
LE MÉMORIAL DE SREBRENICA ET LE BARAQUEMENT DU DUTCHBAT
À notre arrivée au cimetière et mémorial de Srebrenica-Potocari, il n’y a pas non plus de long narratif: un petit mur d’enceinte avec un portail, à la droite duquel une plaque annonce sobrement: «mémorial et cimetière pour les victimes du génocide de 1995». Passé le portail, un impressionnant ruban de pierre en arc-de-cercle gravé de milliers de noms, des rosiers et quelques pierres aux textes brefs. Plus loin — aussi loin que porte le regard — des milliers de tombes musulmanes en marbre blanc et d’autres en bois peint en vert. Celles-ci sont les plus récentes: chaque année, de nouvelles dépouilles sont enterrées au cimetière-mémorial après avoir été identifiées. De l’autre côté du mur d’enceinte, une route où passe de temps en temps une voiture. Seul bruit qui vient perturber l’unité sonore, le silence du recueillement.
En traversant la route, on tombe, un peu par hasard, sur un deuxième mémorial, nullement indiqué. C’est un ancien baraquement où était stationné le bataillon hollandais des casques bleus des Nations Unies dépêchés sur les lieux pour défendre l’enclave de Srebrenica. Il a été transformé en «Srebrenica Memorial Room». Il n’y a personne. Pas un bruit, seuls nos pas résonnent. Le hangar paraît vide, il a presque l’air abandonné. Stratégie du négatif: ici, on exploite les traces.
Le long de deux murs d’enceinte, des photos défraîchies de la région prises en vue aérienne. Là où la terre semble avoir été récemment retournée, on devine les fosses communes qui ont été déplacées. Plus loin, quelques artéfacts et courts textes explicatifs sur du papier jauni exposés dans des vitrines peu éclairées. Au milieu de l’espace, un cube noir dans lequel est habituellement projeté un film. Il n’est pas en marche. En sortant du bâtiment, nous remarquons, gravées dans le bitume, les traces des chenilles des véhicules de guerre qui ont fait leurs manoeuvres, ici, durant le conflit.
La mémoire demande à être activée ou réactivée dans ces trois lieux différents. Ces territoires que nous avons sillonnés pendant quelques jours renferment encore les traces des conflits passés: mines enfouies (il y aurait plus de 550 victimes de mines depuis la fin de la guerre), fosses communes qu’il reste encore à découvrir, corps et ossements qu’il reste à exhumer et à identifier. Les traces et la mémoire du conflit sont mouvantes, au propre comme au figuré: récemment, les flots des inondations qui ont frappé la région ont déplacé les mines enterrées.
Au retour du voyage, je regarde deux films sur le massacre de Srebrenica. Le premier, un docu-fiction intitulé Résolution 819, sorti en 2008, retrace l’enquête menée par un policier français chargé par le TPIY de faire lumière sur les évènements de juillet 1995. Le second, A Cry from the Grave, est un documentaire réalisé en 1999 retraçant heure par heure, grâce à des images d’archives, la chronologie du massacre. Je regarde attentivement, je scrute, je reviens en arrière, je regarde de nouveau, mais ni dans l’un, ni dans l’autre, je ne retrouve le hangar abandonné de la scierie.
[su_service title="MÉLANIE BORÈS" icon="icon: keyboard-o"]Chercheuse doctorante associée à la HEAD, Genève.[/su_service]
Cet article est publié en collaboration avec le projet PIMPA sur la construction de monuments et sur des initiatives mémorielles dans des régions en conflit ou en situation de post-conflit.
Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), ce projet est réalisé au Programme master de recherche Critical Curatorial Cybermedia à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.
Lieux délaissés, magies humaines
Une fascination pour les lieux imprégnés d’histoires a conduit l’artiste genevoise Sarah Hildebrand dans des demeures aux pièces extraordinaires à la quête d’une atmosphère.
Une fascination pour les lieux imprégnés d’histoires a conduit l’artiste genevoise Sarah Hildebrand dans des demeures aux pièces extraordinaires à la quête d’une atmosphère.
Mis en ligne le 23 septembre 2014 à 10h02
[dropcap]L[/dropcap]e travail artistique de la Genevoise Sarah Hildebrand tourne fréquemment autour des notions de l’habitat et de l’intimité. Durant dix ans, elle a choisi de visiter et de photographier différents logements momentanément ou à jamais désertés par leurs occupants et qui conservent pourtant encore les traces de leur présence. Lieux délaissés *, c’est le titre donné à cette recherche qui s’apparente à une promenade intérieure, sensuelle et poétique dans des demeures singulières. Les photographies dégagent une intense atmosphère, on entendrait presque les voix des résidents et le parquet craquer. Les plans sont souvent rapprochés et permettent de capter des fragments d’habitations figées dans le quotidien.
Désormais inoccupées, les pièces attirent l’attention du spectateur par des détails qui, à première vue, sembleraient insignifiants: un étui à lunettes sur une table, des plateaux de service déposés entre deux armoires de cuisine, un jouet laissé dans une chambre d’enfant, des traces de doigts dans la poussière, les coussins élimés, le lit défait qui porte encore la marque de celui ou celle qui s’y est reposé, détails qui remplissent ces lieux du souvenir de l’absent et laissent deviner qui les a occupés.
«CHERCHEUSE-COLLECTIONNEUSE»
Au-delà de ses observations de photographe, le spectateur est confronté à des interrogations liées à la vie, à l’absence, à l’histoire d’un pays, peut-être, et sûrement à l’histoire des êtres qui ont habité les pièces photographiées. Où sont les habitants de ces lieux délaissés? Pourquoi ontils quitté leur appartement? Quelles histoires cachent-ils et que révèlent ces chambres vides? Née en 1978, Sarah Hildebrand été formée à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève, et à la Hochschule für bildene Künste (HfbK) de Hambourg, où elle vit et travaille depuis sept ans.
Dans son travail, elle affirme s’être «toujours intéressée aux notions d’identité ». À travers des photographies, des dessins ou des textes, «je cherche à dévoiler dans mes projets les faits, visibles ou dissimulés, qui définissent une personne, la rendent unique et l’inscrivent dans un groupe. Je me définis souvent comme une chercheuse-collectionneuse et décris mon travail artistique non pas à travers une technique, mais par ma propre expérience et mon regard sur le monde».
[su_service title="CHARLOTTE JULIE" icon="icon: keyboard-o"][/su_service]
* Sarah Hildebrand, Lieux délaissés Verlassene Orte (français / allemand), Kehrer Verlag, 2013. www.sarah-hildebrand.com
BOSNIE-HERZÉGOVINE: LA MÉMOIRE À L’ABANDON
22 septembre 2014
À Mostar et Sarajevo, les parcs commémoratifs des partisans morts lors de la Seconde Guerre mondiale sont laissés en friche, malgré la «yougonostalgie». Un symbole de la difficile reconstruction politique.
Construits en 1981, les Cénotaphes de Bogdan Bogdanovic dans le parc mémoriel Garavice à Bihac (bosnie-herzégovine) commémorent les victimes des oustachis, alliés de l’Allemagne nationale-socialiste. © Alberto Campi, 28 mai 2014
À Mostar et Sarajevo, les parcs commémoratifs des partisans morts lors de la Seconde Guerre mondiale sont laissés en friche, malgré la «yougonostalgie». Un symbole de la difficile reconstruction politique.
Sylvie Ramel
Politologue, chercheuse associée
HEAD, Genève
22 septembre 2014 — Monumentaux mais invisibles. À Mostar et Sarajevo, les parcs célébrant le souvenir des partisans yougoslaves de la Seconde guerre mondiale ont ce caractère imposant propre à la période socialiste. Mais les habitants semblent avoir oublié l’itinéraire qu’il faut prendre pour visiter tant le «Parc mémoriel de Vraca» (Sarajevo) que le «Cimetière mémoriel des Partisans» (Mostar). Auraient-ils disparu de la mémoire des habitants de Bosnie-Herzégovine?
Les raisons de ce relatif abandon sont multiples: échec sanglant de la Yougoslavie socialiste au début des années 1990, localisation décentrée de ces lieux de mémoire, négligence par les politiques des espaces publics participant au bien commun. Ce dernier point est criant à Sarajevo, où la plupart des institutions nationales de promotion culturelle ont, un moment donné, fermé leurs portes, faute de financement, à l’image de la Galerie nationale, ou du Musée historique. Une situation aggravée par la fragmentation du champ politique et ses logiques communautaires sous-jacentes.
NOSTALGIE ET SYMBOLES
La situation est similaire à Mostar, où les mêmes antagonismes ethniques et communautaristes paralysent la plus grande part des politiques publiques, même les plus élémentaires. Ainsi des établissements scolaires continuant à abriter des programmes scolaires parallèles sous le même toit; élèves croates d’un côté, bosniaques de l’autre. Au coeur d’un tel marasme politique, subsistant près de vingt ans après la fin des conflits armés, prendre soin des lieux de mémoire de l’époque socialistes a peu de chance d’être une priorité, malgré la vague de «yougonostalgie» déferlant depuis quelques années dans les différentes républiques postyougoslaves.
Une nostalgie qui s’exprime, par exemple, autour de symboles tels que les vestiges des Jeux Olympiques de 1984 ou de leur mascotte, le loup Vučko. Une nostalgie pour l’époque de Tito qui s’érige par moments en remparts contre la relative violence économique induite par la transition post-socialiste, ses processus de privatisation et ses transformations vers une économie néo-libérale. Une nostalgie qui se réfère, parfois plus profondément, à la figure de Tito en tant que leader de la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale.
Inauguré en 1981, le mausolée pour les combattants de Bogdan Bogdanovic à Popina près de Trstenik (Serbie) rappelle l’une des premières batailles des partisans contre les Allemands en octobre 1941. © Alberto Campi, 14 avril 2014.
Pourtant, c’est le manque de soin qu’évoquent en priorité, et avec un certain désarroi, les rares interlocuteurs rencontrés sur place. Comme ce jeune père de famille, connaisseur du Parc mémoriel de Vraca, qui nous recommande de marcher avec prudence entre les bris de verre et les décombres, et qui souligne la honte qu’il ressent que les politiques ne fassent pas plus pour un tel lieu. Un lieu autrefois marquant de la mémoire socialiste, honorant la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale, morts du côté des partisans. Un lieu dont le potentiel est aussi celui d’un simple lieu public, d’une chambre verte avec vue, à deux pas du centre-ville.
À l’entrée, une vue panoramique sur la plaine et la ville de Sarajevo qui s’étend en contre-bas. Puis une longue série d’escaliers, jusque vers les vestiges d’une sorte de temple sans trop de dieux, ni même vraiment de maîtres. S’en suit une promenade au creux des pins, qui s’étire jusqu’à une imposante statue du camarade Tito.
Monument aux soldats serbes et albanais tombés au combat. © Alberto Campi / Pristina, 5 mai 2014
Un état d’abandon qui caractérise également le Cimetière mémoriel des Partisans, à Mostar. Le lieu fut autrefois conçu par l’architecte Bogdan Bogdanović, l’un des auteurs majeurs et parmi les plus prolifiques de lieux de commémoration à travers tout l’espace post-yougoslave. Le parc s’organise en une série de terrasses, auxquelles l’on accède par un petit chemin serpentant la colline, surplombé par une cascade artificielle. Le haut du parc mémoriel se déploie en cheminements et portiques, ponctués, au sol, de pierres mémorielles retranscrivant les noms, date de naissance et de mort des partisans tombés lors des combats.
En réalité, ce décalage entre les dynamiques «yougonostalgiques» et la négligence des pouvoirs publics face à la décrépitude de ces lieux culturels et historiques en dit cependant long sur l’état des politiques bosniennes contemporaines. De fait, ce relatif abandon des espaces publics marquant le souvenir du passé socialiste et yougoslave implique, dans une certaine mesure, une entrée de plain-pied dans ce que Bogdan Bogdanović a qualifié d’«urbicide». Ce néologisme, introduit au début des années 1990, tente de rendre compte de ce qui aura été l’un des aspects centraux des guerres de succession en ex- Yougoslavie: la destruction de l’urbain et de tout ce qu’il pouvait représenter en termes de «vivre-ensemble», de diversité et de pluralisme.
À LA RECHERCHE D’UN ESPACE
POLITIQUE PARTAGÉ
Bien sûr, ni le Parc mémoriel de Vraca à Sarajevo, ni le Cimetière des Partisans à Mostar n’ont été détruits. Ni durant la guerre, ni dans l’après-guerre. Tout au plus souffrent-ils de négligence et d’indifférence. Pourtant, laisser ces deux parcs mémoriels à l’état de quasi-ruine participe clairement, si ce n’est d’une logique de rejet clairement exprimé, du moins de l’oblitération d’une mémoire partagée récente.
Mémorial pour les partisans serbes et albanais tombés durant la guerre (1941-1945) érigé à Mitrovica (Kosovo) par Bogdan Bogdanovic en 1973 © Alberto Campi, 6 mai 2014
Un tel abandon met ainsi en lumière une problématique désormais centrale de l’après-guerre: près de vingt ans de pacification n’ont pas permis de reconstruire un véritable espace politique partagé. Mais plus encore, la transition démocratique n’a pas permis d’ouvrir le champ politique à des dynamiques d’engagement et de mobilisation, que celles-ci soient politiques ou citoyennes. Un constat que sont néanmoins venues contredire les récentes mobilisations politiques, venue en particulier s’articuler autour des plenums, assemblées citoyennes offrant un espace public entièrement ouvert aux revendications de l’ensemble des habitants du pays.
«RUGISSEMENT DE GENS ENRAGÉS»
Produit d’un mécontentement désormais quasi-généralisé des habitants citoyennes et citoyens de ce petit pays face à l’ensemble du corps politique, ces assemblées se sont inscrites dans la continuité des manifestations de février 2014. Ces espaces de parole, de concertation et de mobilisation, que l’ethnologue belge Stef Jansen qualifie de «rugissement de gens enragés 1», se sont d’abord mis en place dans la ville industrielle de Tuzla, sur la base de revendications aussi fondamentales que celle du versement de près de deux ans d’arriérés de salaires. À travers les manifestations de février et les plenums mis en place à leur suite, beaucoup de citoyens ont pris l’ampleur des enjeux communs qui les concernaient, au-delà de tout clivage ethno-national.
Il restera à voir s’il s’agit là d’une véritable tournant démocratique ou d’un sursaut momentané. En effet, sur le plan politique, ce qui compte reste avant tout de mettre en évidence différences et particularismes, avec parfois une pincée de concurrence victimaire. Du point de vue de l’engagement citoyen, l’heure est avant tout au désenchantement, depuis déjà plusieurs années: taux massif de chômage, blocages politiques et institutionnels, absence de réelles perspectives d’avenir.
Monument à la mémoire des partisans de Split, fait exploser après 1990. © Alberto Campi / 28 mai 2014
Pourtant, il semble parfois qu’il manquerait peu pour remettre en état le Parc mémoriel de Vraca à Sarajevo. Du côté de Mostar, des initiatives individuelles et anonymes ponctuent l’espace mémorial, tentant d’inscrire une marque, un geste artistique engagé dans ce lieu abandonné, où la nature a presque entièrement repris ses droits. Ainsi de ces mots peints en noir sur un drap blanc, clamant l’immortalité de la citoyenneté: «chacun d’entre nous porte encore en soi la ville immortelle». Plus loin, vers le centre-ville, diverses initiatives voient régulièrement le jour. En particulier au sein du centre culturel Abrasević, dont l’engagement a été fort, depuis 2003, afin de promouvoir et rendre accessibles diverses activités artistiques et culturelles. Notamment, un projet de présentation de photographies et d’archives datant de diverses époques, dont la période yougoslave, a mis en évidence un vif intérêt de la part des habitants de la ville.
UN LONG STATU QUO
Il reste à comprendre ce qui freine ces initiatives de réhabilitation ou de commémoration. Fussent-elles ponctuelles, modestes et individuelles. La question du temps nécessaire après la fin des conflits fait-elle entièrement sens, près de vingt ans après la fin des conflits armés? Une hypothèse parfois mise en avant: le conflit aurait été gelé, plutôt que résolu.
En ce sens, et tant qu’un espace politique partagé ne peut véritablement se reconstruire, peut-être est-il alors relativement logique que la situation soit celle d’un statu quo depuis si longtemps. En effet, comment évoquer une histoire partagée, aussi longtemps que les institutions, les modes de socialisation et les affiliations politiques resteront si centralement marquées par la fragmentation, les divergences et les divisions? Un état de fait que les mobilisations politiques récentes tentent justement de démystifier et dépasser.
Ces pages sont publiées en collaboration avec le projet PIMPA sur la construction de monuments et sur des initiatives mémorielles dans des régions en conflit ou en situation de post-conflit. Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), il est réalisé au Programme master de recherche Critical Curatorial Cybermedia à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.
1. Interview initialement publiée dans le magazine Slobodna Bosna, N° 902, 20 février 2014.
Les photos d’Alberto Campi sont extraites d’un projet intitulé «+38», en cours de réalisation, un travail iconographique sur l’esthétique et les lieux de la mémoire antifasciste en Ex-Yougoslavie. www.plus38.info
Van Gogh et Artaud, veilleurs au bord de notre folie
Le Musée d’Orsay à Paris expose jusqu’au 6 juillet, une quarantaine de tableaux de Vincent Van Gogh analysés par le poète Antonin Artaud. Parmi bien d’autres d’une nature plus élevée, un point commun relie les deux hommes: ils ont subi l’internement psychiatrique.
Le Musée d’Orsay à Paris expose jusqu’au 6 juillet, une quarantaine de tableaux de Vincent Van Gogh analysés par le poète Antonin Artaud. Parmi bien d’autres d’une nature plus élevée, un point commun relie les deux hommes: ils ont subi l’internement psychiatrique. Dans les armoires métalliques du prêt-à-penser, Van Gogh et Artaud sont classés comme «artistes aliénés». Quelle folie! Personne n’est plus libre que ces deux générateurs d’éclairs. Mais il est vrai que dans un monde aliéné et aliénant, l’esprit sain fait figure de cinglé.
Mis en ligne le 3 septembre 2014 à 15h05
[dropcap]A[/dropcap]ucun poète n’est allé aussi loin qu’Antonin Artaud dans l’exploration du langage. Il en a fait jaillir des geysers fusant dans toutes les directions. Souffrant de maux de tête depuis son adolescence, usant de drogues pour les atténuer, Artaud «était de nous tous celui qui était le plus en conflit avec la vie», jugeait André Breton, plusieurs années après l’avoir exclu, après tant d’autres, du mouvement surréaliste.
En fait, Antonin Artaud se trouvait moins en conflit avec la vie qu’avec un réel qui le fuyait malgré toutes ses tentatives pour le saisir comme une truite de torrent. Poésie, théâtre, cinéma, interventions radiophoniques, Artaud a utilisé tous les moyens pour circonvenir ce fuyard. Afin de dégager l’espace nécessaire à cette chasse, le poète a élargi le champ de l’écriture, à perte de vue et de vie. On se prend de nostalgie à imaginer les provocations créatrices qu’Artaud aurait pu diffuser s’il avait vécu à l’heure d’internet et du numérique.
LE DÉMON DE VAN GOGH
Après avoir été interné pendant neuf ans dans des asiles de fous (la novlangue n’avait pas encore inventé l’«hôpital psychiatrique »), Antonin Artaud est approché en janvier 1947 par le galeriste Pierre Loeb qui lui propose d’écrire un texte sur Vincent Van Gogh, autre habitué des camisoles de force. «Qui mieux qu’un dingue peut comprendre un autre dingue?» se dit peut-être le galeriste. Ce texte est destiné à lancer la rétrospective que le Musée de l’Orangerie à Paris consacre à Van Gogh. Le poète est prêt à refuser l’offre. Mais la sortie d’un ouvrage met le feu à la poudrière Artaud. Il s’agit du Démon de Van Gogh dans lequel un psychiatre, le docteur François-Joachim Beer, explique l’oeuvre du peintre sous l’angle médical et en fonction de la maladie psychiatrique supposée de Van Gogh.
Furieux de voir le peintre réduit à l’état de tableau clinique, Artaud s’enfonce dans l’oeuvre de l’artiste et en tire Le suicidé de la société qui paraît chez Gallimard, un an avant la mort du poète en 1948. Pour lui, ce n’est pas la folie qui a poussé Vincent au suicide 1 mais la société. Une société malade de ses délires de domination et qui ne supporte pas l’humain libre et fugitif. Qui est aliéné? Celui qui supporte sa cage ou celui qui s’en évade? Antonin Artaud plaide et requiert: «Non, Van Gogh n’était pas fou mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques, dont l’angle de vision, à côté de toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie Second Empire (...) Un aliéné est aussi un homme que la société n’a pas voulu entendre. Et qu’elle a voulu empêcher d’émettre d’insupportables vérités.»
Antonin Artaud évoque d’emblée sa propre folie, en guise de clin d’oeil narquois à ces psychiatres qu’il fustige: «La peinture linéaire pure me rendait fou depuis longtemps (...).» La rencontre avec l’oeuvre de Van Gogh a changé cette folle donne: «L’artiste peint, non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature inerte comme en pleines convulsions.» Tout le travail du peintre est traversé par cet oxymore: la convulsion inerte. Il est impossible de l’expliquer avec les pauvres mots, tant usés, tant abusés, du discours rationnel. Quelques lignes tirées de son Ombilic des limbes permettent d’approcher ce qu’Artaud cherche à nous faire comprendre 2: «C’est le parapet du moi qui regarde, sur lequel un poisson d’ocre rouge est resté, un poisson fait d’air sec, d’une coagulation d’eau retirée. Mais quelque chose s’est produit tout à coup.»
Ce fossile a donc fait naître «quelque chose», l’avènement d’un événement. De l’incréé émane le créé. Comme du cadavre grouille une autre vie nourricière. Il s’agit pour le peintre de dépasser «l’acte inerte de représenter la nature pour, dans cette représentation exclusive de la nature, faire jaillir une force tournante, un élément arraché en plein coeur (...) L’orageuse lumière de la peinture de Van Gogh commence ses récitations à l’heure même où on a cessé de la voir».
VOIR AVEC LE NEZ ET LES OREILLES
Après avoir averti qu’il ne décrirait pas un tableau de Van Gogh, Artaud s’empresse d’en faire, sinon la description, du moins la narration. Celui de la chambre à coucher du peintre (voir le reproduction en page 28) en Arles, par exemple: «(...) Si adorablement paysanne et semée comme d’une odeur à confire les blés qu’on voit frémir dans le paysage, au loin, derrière la fenêtre qui les cacherait.»
Artaud aperçoit donc des blés qui ne figurent pas sur ce tableau. Et comment les a-t-il débusqués? Par l’odorat. D’autres sens sont mis sens dessus dessous, comme l’ouïe: «Van Gogh a pensé ses toiles comme un peintre, certes, et uniquement comme un peintre, mais qui serait par le fait même, un formidable musicien.» Van Gogh ne cherche pas à évoquer un parfum ou un son, à poser au mystique ou au faiseur de symboles. Il se borne à labourer son terrain de peintre; mais à le labourer entièrement, à fond, jusqu’au bout. Et il sort de ses labours des pépites qu’il n’a nullement cherchées mais que le poète, lui, s’empresse de s’emparer pour les mettre au jour. Le chemin du poète croise celui du peintre en des lieux qui surprend toujours le passant prosaïque. L’un et l’autre s’entendent comme larrons en feu.
Rien ne leur est plus étranger que l’anecdote en art ou les imitations de délires commises par ces insupportables cabotins qui posent à l’«artiste maudit» pour des magazines sur papier gluant: «Il n’y a pas de fantôme dans les tableaux de Van Gogh, pas de visions, pas d’hallucinations. C’est la vérité torride d’un soleil de deux heures de l’après-midi. Un lent cauchemar génésique petit à petit élucidé. Sans cauchemar et sans effet. Mais la souffrance du pré-natal y est.»
QUAND LE RÉEL DÉLIRE
Antonin Artaud nous met en garde, surtout lorsque règne un calme apparent: «Méfiez-vous des beaux paysages de Van Gogh tourbillonnants et pacifiques, convulsés et pacifiés. C’est la santé entre deux reprises de la fièvre chaude qui va passer. C’est la fièvre entre deux reprises d’une insurrection de bonne santé. Un jour, la peinture de Van Gogh armée, et de fièvre et de bonne santé, reviendra pour jeter en l’air la poussière d’un monde en cage que son coeur ne pouvait plus supporter.»
Par ses va-et-vient entre la folie de Van Gogh, la sienne, la nôtre, Artaud instruit le procès du réel. Le réel tissé d’illusions, de mensonges, de ruses, de délire sous les masques de la raison. Après tout, la physique quantique n’est-elle pas délirante? Quoi de plus folle qu’une onde qui se prend pour une particule? À qui se fier? À quel saint démoniaque se vouer? Seul le langage poétique permet de dire cet indicible, de rendre intelligible ce qui échappe au discours. Et de réunir ce qui est épars comme le suggère ce poème d’Artaud tiré de Pour en finir avec le jugement de Dieu:
vous verrez mon corps actuel
voler en éclats
et se ramasser
sous dix mille aspects
notoires un corps neuf
où vous ne pourrez
plus jamais m’oublier.
Alors, oui! Antonin Artaud et Vincent Van Gogh sont fous dans la mesure où, jadis, le fou était le seul être sensé à dire ses vérités au Roi. Durant la première moitié du XXe siècle, les délires prophétiques d’Artaud ont annoncé la folie qui est la nôtre aujourd’hui. Une folie bien ordinaire qui sombre dans la vitesse pour empêcher la pensée de se développer. Une folie bien vulgaire qui fonce vers son mur en klaxonnant, après avoir écrasé la poésie du monde. Par leurs cris, leurs gesticulations et les feux d’artifice de leurs délires, ils s’efforcent, ces fous, d’attirer l’attention du troupeau humain en lui désignant les précipices à éviter. Une ou deux mufles se lèvent pour redescendre aussitôt brouter la pâture, à perdre haleine, tout en continuant à se diriger vers le grand vide. Dans cette histoire, qui est fou?
Légendes:
- Vincent Van Gogh «La chambre de Van Gogh» à Arles, Saint-Rémyde- Provence, septembre 1889, huile sur toile, 57,3 x 73,5 cm. © Musée d’Orsay, dist. rmn-grand palais, Patrice Schmidt.
- Vincent Van Gogh «Fritillaires couronne impériale dans un vase de cuivre», Paris, vers avril-mai 1887, huile sur toile, 73,5 x 60,5 cm. Paris, Musée d’Orsay, Legs du comte Isaac De Camondo. © Musée d’Orsay, dist. rmn-grand palais, Patrice Schmidt.
- Vincent Van Gogh «Portrait de l’artiste», Paris, automne 1887, huile sur toile, 44 x 35,5 cm. Paris, Musée d’Orsay, don de Jacques Laroche. © Rmn-grand palais (Musée d’Orsay), Gérard Blot.
- Photo d’Antonin Artaud prise par Man Ray en 1926, épreuve gélatino- argentique contrecollée sur papier © Centre Pompidou, mnam-cci, dist. rmn-grand palais / Jacques Faujour © Man Ray trust / Adagp, Paris 2014.
- Dessin d’Antonin Artaud pour «Le théâtre de la cruauté», vers mars 1946. Mine graphite et craie de couleurs grasse sur papier, 62,5 x 47,5 cm. Legs de madame Paule Thévenin, 1994. © Centre Pompidou, mnam-cci, dist. rmn-grand palais / Jacques Faujour. © Adagp, Paris 2014.
1. Une hypothèse, avancée par les biographes Steven Naifeh et Gregory White Smith, conteste la version du suicide. Le peintre aurait été atteint accidentellement par deux adolescents; avant de mourir après deux jours d’agonie, Van Gogh aurait affirmé avoir voulu attenter à ses jours; par cet aveu, il aurait évité aux deux garçons de subir les foudres de la justice. 2. Artaud a écrit ce texte sous l’inspiration d’un autre peintre, le surréaliste André Masson.
«Femmes-univers» et catholicisme social dans le Valais d’hier
«Temps mort», le dernier roman de Jérôme Meizoz, montre l’intensité du contrôle social exercé par la religion dans l’éducation des jeunes filles valaisannes au sein de la Jeunesse Agricole Catholique.
[dropcap]J[/dropcap]érôme Meizoz vient de publier Temps mort aux Éditions d’en-bas. Ce récit passionnant, préfacé par Annie Ernaux, place l’auteur en arpenteur du militantisme de sa tante Laurette V. au sein de la JACF ( Jeunesse Agricole Catholique Féminine) de 1937 à 1945. En suivant, dans un grenier, une «propagandiste », l’auteur questionne avec pudeur l’imaginaire et le vécu des jeunes filles dans le Valais des années quarante. Grâce à des papiers abandonnés, tout un pan de la mémoire familiale surgit, avec ses clivages religieux et politiques, une morale sexuelle très normée et le consentement à l’ordre durant la Deuxième Guerre mondiale. En s’appuyant sur des traces aussi explicites que lacunaires, ce parcours interpelle le désenchantement contemporain sur le besoin d’engagement, le sens de la solidarité et l’abnégation de soi au sein d’un mouvement étroitement surveillé par l’Église. Interview.
Dans Jours rouges, (Éditions d’en-bas, 2003) l’engagement socialiste de votre grand-père Paul Meizoz s’éclairait en profondeur grâce au legs de sa bibliothèque. La soeur de votre mère, Laurette V., a laissé des traces plus modestes mais aussi plus personnalisées, ses procès- verbaux de séances, des prières, des mots d’ordre calligraphiés dans deux cahiers durant ses activités de présidente de la JACF du Cercle de Vernayaz. Dans les deux cas, le déclencheur a été l’imprimé et l’écriture, des signes éloignés du flou des souvenirs, non? Temps mort constitue l’autre versant de Jours rouges, un coup de sonde dans ma famille maternelle, presque dépourvue d’archives. Il y a des êtres, des milieux, qui ne laissent aucune trace écrite hormis à l’État civil. Eux étaient de petits paysans ruinés par la maladie du chef de famille: dans les années 1940, l’unique fils est entré à l’usine, et la fille aînée dans un magasin. J’ai retrouvé cette liasse d’archives par hasard en 2010, dans la maison, dix ans après le décès de Laurette. Elle avait manifestement souhaité la conserver. Pourtant, elle ne parlait presque jamais de l’époque où elle a été «propagandiste »... C’était comme découvrir une partie de sa vie active entre 18 et 25 ans, ses croyances, ses idéaux, son mode de vie. Ce geste d’exhumer, comme un archéologue, les traces méconnues des vivants — d’autant plus quand on les a connus et aimés — relève d’une sorte de magie, et peut-être de la transgression. Je l’ai fait dans l’ambivalence la plus complète: entre la curiosité émue et le dégoût d’avoir à remuer cette poussière. Évidemment, c’est aussi une leçon de ténèbres, sur la brièveté extrême des vies et de leurs traces.
Les premières pages s’ouvrent sur une démarche aussi mentale que physique, l’approche du grenier de la vieille maison, gardée par deux soeurs, qui abrite le trésor dans une malle. Un premier chapitre que vous avez écrit de façon très littéraire sous la plume d’un «vieux gamin ». Belle formule! Quand je monte au grenier pour fouiller ces liasses, je suis à nouveau le gamin qui aimait y explorer tous les objets laissés par les générations précédentes, chemises de lin brodées, cages à poules, outils agricoles, cloches de vaches... «Vieux gamin», oui, homme en âge, ayant gardé cette fascination enfantine pour le passé perdu, la profondeur du temps. Mais elle peut être morbide, cette obsession du passé, si elle ne s’accompagne pas d’une gourmandise envers le futur, là où se joue notre seule partie! Avec Temps mort, je crois avoir achevé un cycle, ce long rituel de sépulture que plusieurs de mes livres accomplissent.
Si les vies de vos parents au sens large sont restées modestes, ouvriers-paysans, cheminots, employée de commerce pour Laurette, «tous ces hommes et ces femmes» n’en sont pas moins des univers. Les ethnologues appellent «hommes-univers» ces personnes, hommes ou femmes, qui portent une culture en voie de déclin. Ils incarnent un monde de savoirs, gestes, croyances dont la pertinence s’amenuise, remplacés par d’autres modes de vie. Ils sont dépositaires provisoires, puisque mortels, d’une culture entière, comme nous tous le sommes de la nôtre... Les faire parler, les voir agir, c’est un instant d’histoire vivante. Gramsci disait que chacun constitue un «site archéologique vivant». C’est extraordinaire, non?, si l’on est un peu curieux ou attentif! Comme j’ai perdu très tôt de proches parents, ma conscience de toutes ces choses a été aiguisée.
Prise de conscience qui rend lucide sur sa filiation mais peut attrister et même «enchaîner» à son appartenance, comme vos précédents livres, je songe à Fantômes et Séismes, le suggèrent. Ce sentiment de la perte a sans doute un versant sombre dont on peut rester captif. Fantômes fait une station prolongée dans les zones du chant funèbre. Quand le mort saisit le vif, comme dit l’adage juridique définissant l’héritage, il y a danger que le «temps mort» l’emporte... Mais dans Séismes, les forces telluriques s’imposent et avec elles le désordre vital (celui du désir, de la rébellion, de l’ailleurs). Les récits se font satiriques, une joie cruelle, libératrice, s’exprime. Temps mort se termine sur un propos de l’écrivain Pierre Bergounioux. Selon lui, la connaissance de l’histoire qui nous précède est le prérequis pour s’en libérer et agir véritablement par soi-même. Je partage cet espoir...
Autre temps, autres moeurs. Se préparer à devenir de bonnes épouses, des catholiques en croisade contre le «dévergondage » moderne situe la JAC dans un esprit réactionnaire mais ce mouvement issu de la doctrine sociale du Vatican, lancé par le pape Léon XIII dans son encyclique «Rerum Novarum» en 1891, ne se voulait-il pas aussi émancipateur? Je ne nie pas sa part émancipatrice, voulue par l’encyclique, ou par exemple les effets de solidarité, d’entraide. Mon but n’était pas de dénoncer ce mouvement, mais de rappeler quelle a été l’éducation de nos mères. Les archives que j’avais à disposition insistent sur le contrôle du comportement des jeunes filles, pour les faire entrer dans un rôle de mère ou, à défaut, de «vieilles filles», entièrement codifié.
Saisie par l’Histoire, l’Église a voulu contenir la séduction communiste auprès des ouvriers. Était-ce également sensible dans le Valais du début du XXe siècle? Clairement, c’est l’un des grands thèmes des documents que j’ai consultés. Les prières pour les «petits enfants russes», la peur de «Moscou » contre laquelle «Rome» serait le seul rempart, des propos contre les grèves et les luttes ouvrières menaçantes pour la paix du pays, etc. Et là on rejoint, par l’autre bout, le tableau de Jours rouges: la difficile implantation du monde ouvrier dans le Valais en mutation de l’entre deux-guerres; la hantise des conservateurs que la population paysanne bascule vers une identité ouvrière déchristianisée, moins soumise...
Quelle est la part de l’engagement personnel de Laurette dans son travail de «zélatrice» auprès de ses camarades? Difficile de le savoir. Laurette a repris la présidence de la JAC locale à la mort prématurée de la propagandiste précédente, lors de ses premières couches. Histoire tragique, presque romanesque: cette jeune femme qui a milité pour le mariage, la famille nombreuse et la morale sexuelle restrictive, s’en trouve la victime collatérale, comme toutes les femmes mortes en couches. L’homme, ensuite, se remariait et fondait une seconde famille. Au fond, sous le rôle sacré que lui donnait la religion, la femme en restait au statut d’objet dans des stratégies matrimoniales et reproductives.
Le revers de la respectabilité, c’était aussi, pour les meilleures jacistes, le destin de «vieille fille» au point de s’interroger sur un tel engagement. Laurette ne s’est jamais mariée, elle a dû prendre en charge financièrement sa mère et sa fratrie, assumer un rôle masculin, ramener son salaire à la maison. Personne n’aurait voulu épouser une fille de paysan ruiné, peut-être. Elle a donc dû vivre le destin de «vieille fille» dont parle l’un des chants jacistes. C’est d’une cruauté étrange. Elle en a sans doute souffert mais dans les années 1970, elle a fini par le réinterpréter en termes féministes: une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette! Les femmes pouvaient très bien se débrouiller seules, elles étaient majeures, actives, libres. Elle en a conçu, tardivement, une certaine fierté.
Le «vieux gamin» finit par monologuer sur sa tante après lui avoir prêté des pensées sur sa militance de jeune femme. Dialogue entre la morte et le vivant? Le «monologue du vieux gamin», qui termine le récit, ramène au présent qui est le mien. À la volonté d’échapper au poids du passé, à la «mémoire obèse» de toute maison de famille. Il y a tout à coup une joie à échapper à ses racines. Surtout dans la période actuelle où l’«identité» sert de prétexte à la xénophobie. Je me moque de cette identité de carton-pâte. Les racines, c’est bon pour les arbres. Nous avons le bonheur d’avoir des pieds. J’ai voulu conjurer les risques mortifères d’une loyauté excessive aux idéaux des ancêtres.
Tout un chapitre présente les archives de la JACF en fac-similé. Un choix «ethnographique »? Un choix documentaire, historique, afin de rendre sensible la matérialité de l’archive, sa concrétude: l’écriture manuelle, très régulière, scolaire, celle de toute une génération; mais aussi des documents émouvants comme le «chant des vieilles filles», dont je ne sais pas l’origine; enfin, un aperçu de l’imprimé jaciste, très abondant: revues, ouvrages, journaux. Cette véritable constellation éditoriale, comparable à celle de son rival, le Parti communiste, a disparu dans les années 1960.
[su_service title="CHRISTIAN CIOCCA" icon="icon: keyboard-o"]
Bibliographie: Jérôme Meizoz aux Éditions d’en-bas: Jours rouges (2003), Père et passe (2008), Fantômes (2010), Temps mort (2014); aux Éditions Zoé: Morts ou vif (1999), Destinations païennes (2001), Les Désemparés (2005), Le Rapport Amar (2006), Séismes (2013).
Le rock est éternel. Même en Suisse
Bête et méchant! Voilà deux mots utilisés parfois pour qualifier le «rock’ n’ roll». Culture autant que musique, il est né dans les années 1950 et a hérissé le poil de maints mélomanes. «La Cité» dresse l’état des lieux des scènes rockeuses, de part et d’autre de la Sarine.
Bête et méchant! Voilà deux mots utilisés parfois pour qualifier le «rock’ n’ roll». Culture autant que musique, il est né dans les années 1950 et a hérissé le poil de maints mélomanes. La Cité dresse l’état des lieux des scènes rockeuses, de part et d’autre de la Sarine. par ALEXANDRE WÄLTI / www.lemurduson.ch
Le rock est plus qu’un genre musical. C’est une culture basée sur la sainte trinité: guitare électrique-basse-batterie portée par l’énergie sauvage. C’est Jimi Hendrix faisant l’amour à sa guitare avant de la brûler lors du Monterey Festival 1967. C’est Phil Spector, producteur talentueux mais controversé, qui menace les Ramones avec une arme à feu. C’est le groupe Oasis, dont l’orageux talent de composition était traversé par les éclairs conflictuels entre les deux frères Gallagher. Ils ne peuvent toujours pas se supporter aujourd’hui. D’ailleurs, le groupe n’existe plus officiellement.
Ces anecdotes ne sont que modestes riffs de guitare au milieu des décharges électriques du rock. D’où vient cette musique? Elle a pour origine le blues dont Chuck Berry s’est inspiré pour composer un titre important de l’histoire rockeuse: Johnny B. Goode. Toutefois, il s’est donné le rôle de premier ministre du rock’n’roll tout en laissant le trône de Roi à Elvis Presley. Les déhanchements du «King» ont scandalisé autant le public qu’ils l’ont conquis durant les années 1950. Pour surveiller ce qui se tramait dans ses sulfureux concerts, la police n’hésitait pas à les filmer.
Il s’agissait de vérifier si «Elvis the Pelvis» n’outrepassait pas les bornes, fortes étroites, d’une Amérique ultra-conservatrice. Notons en passant que le style du «King» appartenait au rockabilly. Ce genre musical trouve ses racines dans le blues, comme le jazz, et se compose traditionnellement d’un trio: guitare électrique-batterie-contrebasse. En Grande-Bretagne, les radios libres ont tenu un rôle moteur dans la promotion du rock en Europe. Elles ont programmé cette musique que les radios «légales» n’osaient pas diffuser, créant ainsi une demande à laquelle ces stations pirates s’empressaient ensuite de répondre. L’exemple le plus célèbre: Radio Caroline, qui a émis dès 1964 d’un bateau ancré dans les eaux internationales.
Le rock semait ses chansons d’allusions sexuelles, d’où la censure exercée par les chaînes d’état. Cette débauche de liberté chamboulait la Couronne et défrisait le gouvernement britannique qui a tenté de museler ces programmes immoraux en interdisant les radios pirates en 1967. Néanmoins, Radio Caroline a continué d’émettre en toute illégalité pendant un an avant de tomber en faillite. Mais l’amour du rock a fait renaître la station pirate dès 1972.
Ce navire des ondes a subi d’autres tempêtes dévastatrices, incitant le directeur à acquérir un nouveau bateau: le Ross Revenge. Lequel a été mis hors service en 1989, à la suite d’un assaut donné par des fusiliers britanniques et néerlandais. Radio Caroline diffuse toujours ses émissions, mais désormais sur internet. Ses aventures ont inspiré Good Morning England, l’excellent film de Richard Curtis avec le regretté Philip Seymour Hoffman.
TERRE DE ROCS ET DE ROCK
Si le rock est né du blues et du jazz, il doit sa croissance et sa popularité aux passionnés de la guitare. Woodstock a illustré tout particulièrement ce phénomène. Le mythique festival s’est déroulé en 1969, alors que la guerre du Vietnam faisait rage, ce qui a donné à ce genre musical sa dimension protestataire expliquant, au moins en partie, le miracle de sa pérennité. Le rock, c’est le droit de dire non. C’est une attitude hors normes qui se perpétue.
Ce tsunami culturel et musical a aussi battu les flancs des montagnes suisses. Quel est l’état des lieux du rock de part et d’autre de la Sarine? Deux disquaires nous aident à le dresser. Commençons par Mauro Bozzi de Stigmate Records à Yverdon. Son magasin est sis dans une cave où les vinyles de tous genres tapissent les murs. Le disquaire yverdonnois évoque, d’emblée, le Spot Bar de Neuchâtel: «Le propriétaire de cet établissement avait pris contact avec un organisateur de tournée bâlois qui proposait aux groupes de se produire à différents endroits de Suisse.» Des musiciens mythiques tels Pink Floyd, John Lee Hoocker ou les Bee Gees ont foulé la scène du bar neuchâtelois entre 1959 et 1971.
Mauro Bozzi ajoute: «Je ne pense pas que les groupes suisses ont leur place auprès des légendes du rock, mais rétrospectivement on redécouvre de bonnes formations tel que Toad.» Ce groupe bâlois a été produit, notamment, par Martin Birtsch qui a travaillé avec Deep Purple et Iron Maiden. Le disquaire nous conseille ensuite d’écouter les Genevois de Gentlemen qui ont gratté des accords dès 1966. Il cite encore l’album Forget Your Dream, et surtout le morceau Thick Fog, du groupe de rock progressif des années septante Pacific Sound.
N’oublions pas la place éminente que les Fribourgeois du groupe The Young Gods occupent dans le paysage du rock mondial. «Ils ont notamment influencé des artistes tels que David Bowie, U2 et les Nine Inch Nails», précise le disquaire. Ce trio, quatuor aujourd’hui, a introduit entre autres l’art du sample dans le rock. «Il était là juste au bon endroit et au bon moment», conclut Mauro Bozzi.
ZURICH, CENTRE NÉVRALGIQUE
Comment le rock sonne-t-il en schwiitzerdütsch? Nous l’avons demandé à Sam Urben de Rockaway Beach à Berne. Le disquaire bernois a commencé par vendre de la musique punk et travaille depuis bientôt trente ans dans ce milieu. D’après lui, le punk – un dérivé du rock – se révèle plutôt prolifique en Suisse alémanique: «À Berne, nous avons l’inclassable Révérend Beat-Man qui domine à peu près tout et fait bouger la scène underground en touchant toujours plus de monde.» Cela dit, ajoute aussitôt le disquaire, le centre névralgique de la scène rock outre-Sarine est situé à Zurich, plus précisément au centre culturel Mascotte. Jadis, un certain Louis Armstrong s’y était produit.
Sam Urben est donc avant tout un amateur de punk. Par quels groupes a-t-il été marqué? Il cite en tête de liste les Zurichois de Nasal Boys, «le premier groupe punk célèbre de Suisse». Le disquaire évoque aussi le groupe féminin Kleenex devenu par la suite LiliPUT. En 1978, ces Zurichoises scandalisèrent les téléspectateurs de l’émission Karusell de la télévision suisse alémanique. La production les avait obligées à chanter en playback, provoquant la légitime colère de la chanteuse Klaudia Schiff. Le groupe a par la suite obtenu un certain succès international et une prestigieuse signature auprès du célèbre label londonien Rough Trade. Voilà pour l’histoire suisse du rock.
Qu’en est-il aujourd’hui? Lorsqu’on demande au Dr. Wheels, du groupe Rambling Wheels, ce qu’est le rock, il répond: «C’est Michael J. Fox qui fait son solo de guitare à genou dans Retour vers le futur.» Ces rockeurs neuchâtelois ont sorti leur troisième album en mars dernier, The Thirteen Women of Ill Repute, avec une musique plus mélodieuse et acoustique que par le passé, zébrée toutefois par les décharges électriques des guitares. Les Rambling Wheels ne sont pas les seuls en Romandie comme en témoigne l’excellent cru 2013 des Genevois The Animen. Ils ont écumé les festivals suisses et enflammé les radios avec leur premier album Hi! Ce condensé de rock à l’ancienne, extrêmement nerveux, a séduit le public très sélect de l’Eurosonic 2014. Cette manifestation, qui réunit maints spécialistes de la musique, permet surtout aux programmateurs des plus grands festivals européens de recruter leurs futurs talents.
Citons encore, dans un autre genre, Mama Rosin qui distille un rock cajun de belle facture, évoquant des vieux bars sales de Louisiane. C’est à renfort de fuzz, une pédale à effets de saturation, et d’accordéon, de groove, et de blues que le trio hyperactif de Genève produit un son «garage» qui n’a rien à envier aux plus grands. Leur dernier album apparaît par ailleurs sur le crapuleux label Voodoo Rythm Records du Révérend Beat-Man. Les punks de Atomic Shelters et Hateful Monday méritent également une écoute attentive. Et enfin, des secrets bien gardés surgissent peu à peu au grand jour comme Lune Palmer, le frère romand de Radiohead, le trio funk-rock Deep Kick ou le quatuor magique Juan Blanco.
Quant à la Fribourgeoise Kassette, elle se distingue par des rythmiques brutales et efficaces, sans pour autant perdre le sens des mélodies aériennes et simples. Emilie Zoé mérite aussi une place dans cette liste tant son jeu de guitare limpide et puissant tient en haleine. C’est en concert qu’elle prend toute son envergure, comme elle l’a démontré au Pully For Noise de l’année passé. Ce festival satisfait, d’ailleurs, tous les amateurs de rock. Ce qui vaut également pour la programmation de deux salles importantes: le Romandie de Lausanne et le Bad Bonn de Guin près de Fribourg.
De l’autre côté de la Sarine, la scène bouge. Ce n’est pas Tizian Von Arx, la voix de 7 Dollar Taxi, qui dira le contraire: «Le rock ne met pas en avant la perfection musicale ni les arrangements pointus. Il y est plus question de l’énergie que l’on vit en concert plutôt que sur un disque. Si l’on quitte la scène sans avoir sué, c’est que l’on a fait quelque chose de faux.» Ces Lucernois ont sorti un nouvel album début 2014: Anything Anything. Ils sont les dignes héritiers des ballades entrainantes des Beatles et de la fureur de jouer des Who, rien que ça!
Les Bâlois The Bianca Story ne laissent pas indifférent. Le groupe a lancé son dernier album, Digger, après une initiative réussie de financement direct par le public. Autres figures de marque du rock d’outre-Sarine: Sophie Hunger et Anna Aaron. Fiona Dan-iel, elle, se veut plus calme mais sait faire grincer sa guitare. Dans la même veine, le Bernois Patrick Bishop compose des mélodies oniriques.
Il existe aussi le mundart, l’art de chanter en dialecte alémanique, qui possède son lot de rockeurs comme Züri West, Adrian Stern ou Stiler Has. Admiral James T. convainc avec un son franc et direct. La Zurichoise Evelinn Trouble produit un son exigeant qui va en tous sens. Dans les mélodies plus planantes et expérimentales, le groupe My Heart Belongs To Cecilia Winter donne aussi une belle leçon de maîtrise de guitare électrique, comme les nouveaux arrivants de Asleep.
Le plus brillant symbole du rock suisse reste le Bernois Stephan Eicher qui chante tant en français qu’en dialecte alémanique. Dès l’âge de 17 ans, il a créé un groupe de punk-disco avec son frère cadet à la fin des années septante: Grauzone. En 1981, ils ont vendu quelque 500 000 disques du titre Eisbär. Devenu moins turbulent, Stephan Eicher a connu la consécration avec son cinquième album Engelberg, vendu à près de deux millions d’exemplaires grâce à deux succès: Hemmige, une reprise du chansonnier bernois Mani Matter, et le fameux Déjeuner en paix. L’amitié qu’il entretient avec l’écrivain français Philippe Djian est à la source de nombreuses compositions plus poétiques comme l’excellent Eldorado. Sur l’album du même nom, Stephan Eicher collabore aussi avec l’écrivain alémanique Martin Suter pour les paroles de Weiss Nid Was Es Isch.
ATOUTS HELVÉTIQUES
Le trio guitare électrique-basse-batterie a encore de beaux jours devant lui. Les Jimi Hendrix, The Who, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd ou encore Metallica possèdent donc de dignes héritiers en Suisse. Peut-on parler d’une scène de rock helvétique? Les nombreuses productions des dernières années et le dynamisme de labels indépendants tels que Two Gentlemen ou Saïko Records sont là pour le démontrer.
La Suisse n’est pas orpheline de salles de concert ni de festivals d’excellente qualité; elle reste une place importante sur le plan musical en général. C’est ainsi que les plus grands jazzmen ont joué dans notre pays. Tous ces facteurs favorisent le développement de la créativité musicale et l’émergence de nouveaux groupes.
Laissons la conclusion à Franz Treichler, chanteur des Young Gods: «Le rock est une énergie positive qui pousse en avant. Elle sert à réveiller les gens, à leur faire prendre conscience qu’il existe autre chose que la voie toute tracée du conservatisme, à les faire agir plutôt que gémir. En plus simple: ça aide à se botter les fesses!»
«Dans ’Chasseurs de crimes’, le défi était de tourner avec des procédures judiciaires en cours»
Nicolas Wadimoff et Juan José Lozano signent un documentaire sur la chasse aux criminels que poursuit l’organisation TRIAL en Suisse, présenté en première mondiale au Festival du film et Forum international sur les droits humains (FIFDH) à Genève.
Nicolas Wadimoff et Juan José Lozano signent un documentaire sur la chasse aux criminels que poursuit l’organisation TRIAL en Suisse, présenté en première mondiale au Festival du film et Forum international sur les droits humains (FIFDH) à Genève.
Mis en ligne le 23 avril 2014 à 11h46
[dropcap]P[/dropcap]oursuivre les criminels sans frontière. Combattre l’impunité des bourreaux. Vaste programme. Rude mission. Les réalisateurs Nicolas Wadimoff et Juan José Lozano ont suivi celles et ceux qui s’y sont attelés. Ils ont présenté leur film Chasseurs de crimes, en première mondiale, lors du récent Festival du film et Forum international sur les droits humains (FIFDH) à Genève. Les deux cinéastes ont suivi les limiers de TRIAL (Track Impunity Always), une organisation non gouvernementale basée à Genève qui œuvre pour débusquer d’anciens criminels réfugiés en Suisse. Du Rwanda au Guatemala, en passant par la Colombie, ce documentaire pose de nombreuses questions: faut-il condamner les «seconds couteaux» pour remonter la chaîne de commandement jusqu’au plus haut niveau? Que peut faire la justice internationale face à la passivité de certaines justices nationales? Entretien croisé.
Votre documentaire met en lumière trois dossiers qui évoquent le Rwanda, la Colombie et le Guatemala. Pourquoi? Nicolas Wadimoff: L’affaire rwandaise mentionnée dans notre film débouche sur une sorte de non-lieu narratif, parce que la personne dont il est question n’a pas commis les crimes qui lui étaient imputés. Cela aurait pu être l’histoire d’un homme vivant en Suisse et qui, du jour au lendemain, est recherché, traqué et éventuellement débusqué. Une personne dont l’histoire aurait pu croiser la grande Histoire des crimes contre l’humanité, puisqu’en l’occurrence il est question du génocide au Rwanda en 1994. Juan José Lozano: Dans le cas du Colombien que nous évoquons également dans le film, l’une des interrogations est l’utilité ou non de poursuivre les «seconds couteaux» ou les petites gens qui participent à la machine du crime. Poursuivre ou non une personne secondaire pour remonter la chaîne de commandement jusqu’au plus haut niveau. Taper quelque part ou ne pas taper du tout, telles sont les questions. Le troisième dossier, celui qui touche le Guatemala, évoque les personnes lâchées par leurs pairs, qui servent de fusibles et sont données en pâture à la justice internationale. Ces arrestations permettent de détourner l’attention, au profit des véritables commanditaires dont la plupart se trouvent encore en poste. Ces points ont guidé nos choix.
Qu’est-ce qui a vous a motivé à unir vos forces pour la réalisation de ce film? NW: Cela s’est fait de manière naturelle et complémentaire. Nous avions l’un et l’autre une expérience du documentaire. Nous avons beaucoup discuté en amont et au retour de chaque tournage. JJL: Je précise que n’avons jamais été sur les tournages ensemble. Nous tournions séparément. NW: L’objectif était de nous partager le travail, car nous n’aurions jamais réussi à être disponibles au même moment pour ce film. Celui qui était libre partait. JJL: Je précise également que c’est Nicolas qui a eu l’idée de suivre le travail des enquêteurs de TRIAL sur le terrain. NW: Pour que l’histoire de nos motivations soit complète, il faut dire que ce sont nos compagnes qui nous ont présentés. Ana Costa, la femme de Juan, qui est monteuse, travaillait avec ma compagne, Ufuk Emiroglu, qui est réalisatrice, sur le film Mon père, la révolution et moi. J’avais entendu parler du travail de Juan. Nous nous sommes rencontrés au moment où je commençais à m’intéresser aux enquêtes de TRIAL. Tourner le film que je souhaitais faire me semblait difficile à accomplir, car le tournage n’allait pas dépendre de moi, mais d’impondérables non maîtrisables concernant la présence d’éventuels criminels de guerre sur le territoire suisse. Il fallait être très disponible et, compte tenu de ma vie professionnelle chargée, je ne pouvais pas être à la disposition de TRIAL à temps plein. En outre, les questions liées à l’impunité étaient complexes. Juan était sur un autre projet et nous avons décidé d’unir nos forces avec l’avantage d’une double disponibilité pour faire face aux aléas des enquêtes de TRIAL. Nous pensions que certaines enquêtes se dérouleraient en Amérique centrale et en Amérique latine. Compte tenu de la vaste connaissance que Juan a de ces régions et du fait qu’il avait réalisé deux films liés à ces questions, nous avons commencé à travailler ensemble. Nous avons décidé que la ligne éditoriale serait plus importante que le regard personnel, nous savions que nous n’allions pas convoquer la poésie, le symbolisme ou la métaphore pour ce documentaire. Nous étions conscients que nous allions nous plonger dans un dossier extrêmement compliqué, avec la nécessité du recul nécessaire pour nous atteler à une tâche aussi délicate. Nous nous sommes dits que, à deux, nous pouvions avoir ce recul indispensable. JJL: Et cette hypothèse s’est finalement avérée sur le terrain!
Comment avez-vous choisi les dossiers et les personnages à suivre? JJL: Nous avons fait une évaluation avec TRIAL des personnages intéressants à suivre et visualisé la façon dont chaque investigation pouvait concrètement être menée. NW: La faisabilité ou non d’un tournage a dicté nos choix, ainsi que les possibilités d’enquêter pour TRIAL. Nous avons voulu suivre une histoire, avec des personnages et une dramaturgie propre à un dossier, afin d’offrir un récit capable de susciter émotion et réflexion et d’ouvrir le débat. JJL: Nous nous sommes beaucoup retrouvés, Nicolas et moi, autour de la table de montage, à chercher la dramaturgie du film et les moments de tension de l’histoire. Nous avons pris le relai à tour de rôle. NW: à la base du projet, nous savions que TRIAL enquêtait sur des criminels potentiels résidant en Suisse ou ailleurs en Europe. Cela a permis d’ancrer le film et de le financer. Il était important de montrer que TRIAL suivait des personnes que l’on peut croiser en allant à la poste ou au magasin d’alimentation, des gens près de chez nous.
À la fin de votre film, vous semblez tendre la perche aux journalistes d’investigation pour qu’ils continuent les enquêtes que TRIAL et vous avez amorcées, comme dans l’affaire Sperisen ¹, par exemple. Était-ce votre intention ou votre documentaire aura-t-il une suite? JJL: Ce n’était pas un objectif en soi, mais la tâche n’est pas terminée, en effet. Dans le cas colombien, le travail de TRIAL s’est achevé alors que j’aurais aimé qu’il continue. L’enquête est close, mais beaucoup d’autres éléments pourraient faire l’objet d’un thriller! Le cas colombien offre des éléments que nous n’avons pas pu développer dans notre documentaire, car cela aurait été un autre film...Pour ce cas colombien, nous avons beaucoup d’autres éléments et je suis intéressé à transmettre les éléments dont nous disposons pour que l’enquête puisse avancer.
Est-ce pareil pour l’affaire Sperisen? Souhaitez-vous passez le témoin à des confrères ou à des consœurs journalistes pour que l’enquête continue? NW: La particularité de Chasseurs de crimes était d’arriver à circonscrire notre champ d’action filmique. Deux affaires sur les trois que nous avons mentionnées sont passionnantes en termes de dramaturgie et d’enjeux politiques, à la fois nationaux et internationaux puisqu’elles touchent la Suisse, la Colombie et le Guatemala. Ces affaires sont d’autant plus passionnantes si l’on pense à d’éventuelles résolutions et aux débats qu’elles suscitent. Chacune des affaires évoquées dans le documentaire pourrait faire l’objet d’un film complet... ou pas! Puisqu’elles se situent dans le champ de la justice, milieu dans lequel œuvrent TRIAL et les avocats que nous avons suivis sur le terrain. Le défi était aussi de tourner avec des procédures judiciaires en cours. Le corollaire pour Juan et moi était que nous étions tenus à la confidentialité, ce qui est le paradoxe de ce projet. Plus nous obtenions la confiance des témoins que nous rencontrions, plus nous nous engagions, pour obtenir cette confiance, à ne pas divulguer ce que nous allions apprendre. Aucun autre film n’aurait pu être tourné tant que les affaires que nous évoquons dans Chasseurs de crimes n’auront pas trouvé leur résolution. Nous étions dans cette contradiction permanente: effleurer des histoires passionnantes sans trop en dire sous peine de procès.
Ce documentaire était-il pour vous, Juan, la suite de votre précédent film Impunity? JLL: Non, après Impunity, je ne voulais plus rien savoir de la Colombie! Je me suis concentré sur d’autres projets. Avec Chasseurs de crimes, je voyais l’opportunité de participer à la réalisation d’un film éloigné de la Colombie, même si nous avons fini par suivre un dossier colombien. J’ai dû faire appel à d’autres ressources, moins viscérales, pour tourner ce film. Votre documentaire est allé jusqu’au bout de ce que vous étiez autorisés à divulguer, place maintenant à des films où la fiction permettrait de dire ce que vous avez dû taire? JJL: Inspiré par ce que nous avons vécu, je suis déjà mis au travail! Cela fait quelques mois que j’habite en Colombie, où je développe une série de fictions pour la chaîne publique Canal Capital de Bogotà, qui touche une audience de 25 millions de spectateurs environ. Cette chaîne, qui est devenue une référence en Colombie et dans le reste de l’Amérique latine, traite de cas liés à la défense des droits humains. Dans cette série télévisée, notre héros est un avocat qui travaille sur des crimes de guerre récents commis en Colombie et des enquêtes dont aucune n’a abouti. NW: Je n’ai pas le recul nécessaire pour envisager une suite aux cas que l’on voit dans le film, à travers un autre type de narration, qu’il s’agisse de fiction ou de documentaire. Je travaille sur d’autres projets qui me laissent peu de temps, mais je n’exclus pas, une fois que les choses se seront décantées, que cela puisse ré-émerger dans mon esprit sous forme de fiction, car il y a là matière à des récits forts. Nous avons la chance inouïe d’avoir un ancrage local et national, qui parle de là-bas et qui évoque des valeurs universelles. Nous avons eu le privilège d’assister au moment où la petite histoire d’une association d’avocats et d’enquêteurs pugnaces a rejoint la grande Histoire.
¹ Erwin Johann Sperisen Vernon (44 ans) est de nationalité suisse et guatémaltèque. Le 1er août 2004, il est nommé chef de la Police nationale civile, Il démissionne de ce poste après l’assassinat de parlementaires salvadoriens par des membres des forces de l’ordre et part pour Genève le même mois. Il est arrêté le 31 août 2012 par les autorités genevoises. Son procès s’ouvrira à Genève avant l’été 2014. Accusé par le procureur général de l’assassinat de dix détenus. Sperisen conteste cette accusation et plaidera l’acquittement.
«Le vent se lève», séance de rattrapage
Au-delà des polémiques, le dernier film du maître japonais Hayako Miyazaki est une poétique du rêve et un testament artistique.
Au-delà des polémiques, le dernier film du maître japonais Hayako Miyazaki est une poétique du rêve et un testament artistique.
Mis en ligne le 16 avril à 14h30
[dropcap]L[/dropcap]orsque le réalisateur japonais Hayao Miyazaki, souvent qualifié de «maitre de l’animation japonaise», a annoncé que Le vent se lève serait son dernier film, il a laissé bien des admirateurs inconsolables. Rares sont les concepteurs de dessins animés à jouir du prestige international de Hayo Miyazaki. Pourtant, au moment de sa sortie en salle, au Japon, puis en Europe, les discussions autour du film ont parfois pris un caractère polémique.
Sommairement résumé, Le vent se lève suit l’itinéraire de Jiro Horikoshi, ingénieur aéronautique concepteur du «Zero», avion de chasse monoplace japonais, de son enfance à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela peut sembler loin des univers oniriques et fabuleux qui avaient fait la renommée du maitre, mais il s’agit d’une lecture trop réductrice, manichéenne, d’une œuvre qui ne l’est pas. Avec ce dernier film, Hayao Miyazaki démontre une fois encore son art de l’animation et signe une œuvre crépusculaire sur la création artistique et la puissance des rêves.
RÉFÉRENCES LITTÉRAIRES
Le projet du réalisateur tient tout entier dans le vers du Cimetière marin de Paul Valéry qui sert de leitmotiv au film: «Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre!» Les films de Hayao Miyazaki nous parlent souvent de mondes disparus ou sur le point d’être engloutis. Ce n’est pas par hasard qu’il place son testament cinématographique sous le signe d’un poème composé pendant la Première Guerre mondiale, et que l’autre référence littéraire européenne du film, La Montagne magique de Thomas Mann, s’achève aussi dans le fracas de cette guerre. Miyazaki sait que les civilisations sont mortelles. Leur chute ou leur salut se trouvent au cœur de plusieurs de ses films.
Dans certains cas, il les sauve du désastre par le truchement d’une héroïne (Nausicaä ou Sophie); dans d’autres, ses conclusions sont plus incertaines (Princesse Mononoke ou Ponyo sur la falaise). Dans Le vent se lève, la destruction a bien lieu. Les rêves d’enfants ne sauvent pas le monde et peuvent même contribuer à l’anéantir. Toutefois, le héros-démiurge reste en vie, malgré le vent et la tempête. Pour Hayao Miyazaki, le créateur témoigne aussi de son temps, des siens et son interprétation, effroyable ou grandiose, doit être prise comme telle, plutôt que comme un manifeste ou pamphlet politique.
On a reproché au réalisateur la passivité de son héros face aux signes avant-coureurs de la catastrophe. Jiro traverse les ans et les soubresauts du Japon de l’Entre-deux-Guerres sans en être affecté, tendu vers un seul but: dessiner des avions. Mais est-ce vraiment si simple? Le ton est donné dès la séquence d’ouverture: le jeune Jiro monte sur le toit de la demeure familiale, s’installe aux commandes d’un avion artisanal, survole sa ville natale avant que d’étranges machines volantes ne l’abattent... et se réveille en sursaut.
 Tout au long du film, la frontière entre le rêve et le cauchemar est floue. Jiro rêve de construire de beaux avions, il est obsédé par la courbure des arrêtes de maquereaux, par les dernières découvertes aéronautiques. Il parvient à ses fins, mais l’aboutissement de son rêve entraine la mort et la destruction. Miyazaki semble se demander — nous demander — quel est le prix à payer pour réaliser ses rêves. Il trace un parallèle évident entre la vocation de l’ingénieur aéronautique et celle de l’artiste: même solitude, même radicalité, voire même décalage par rapport au réel. Lorsque ce dernier se rappelle à l’artiste, il le fait brutalement: une chasse à l’homme en Allemagne, la femme aimée qui se meurt.
Tout au long du film, la frontière entre le rêve et le cauchemar est floue. Jiro rêve de construire de beaux avions, il est obsédé par la courbure des arrêtes de maquereaux, par les dernières découvertes aéronautiques. Il parvient à ses fins, mais l’aboutissement de son rêve entraine la mort et la destruction. Miyazaki semble se demander — nous demander — quel est le prix à payer pour réaliser ses rêves. Il trace un parallèle évident entre la vocation de l’ingénieur aéronautique et celle de l’artiste: même solitude, même radicalité, voire même décalage par rapport au réel. Lorsque ce dernier se rappelle à l’artiste, il le fait brutalement: une chasse à l’homme en Allemagne, la femme aimée qui se meurt.
La monstruosité, ici, n’est pas incarnée par des esprits ou des démons, mais elle se manifeste partout. Les moments de grâce sont brusquement interrompus par une catastrophe. Il en est ainsi de la rencontre amoureuse de Jiro et Nahoko dans un train: à l’éblouissement succède le désastre. Le vent se lève.
ARCHITECTE GÉNIAL
Pourtant, rien ne saurait distraire le personnage central de sa quête. Plus que la figure d’Icare, c’est celle de Dédale qu’évoque Jiro: l’architecte génial qui, croyant maitriser le Minotaure, conçoit le labyrinthe où il sera à son tour enfermé. En cela, il se rapproche d’autres personnages masculins de Miyazaki, tout aussi ambigus.
Dans Le Voyage de Chihiro par exemple, la figure de Haku oscille entre compromission avec la sorcière et protection de Chihiro, même chose pour un autre magicien, Hauru, dans Le Château ambulant. Dans tous les cas, les héros sont en quête de savoir et d’identité; ils sont surtout détenteurs d’une puissance destructrice qui les dépassent. Si les deux magiciens sont révélés à eux-mêmes par l’amour d’un personnage féminin, ce n’est pas le cas de Jiro.
Outre le récit initiatique, on retrouve, dans ce film, bien des thèmes chers à l’auteur. Le plus saillant est sa fascination pour les machines volantes. De l’aile de Nausicaä de la Vallée des vents, à l’avion à pédales de Kiki la petite sorcière, sans oublier Porco Rosso et le Château dans le ciel, Hayao Miyazaki éprouve un plaisir évident à inventer des avions. Cette gourmandise à dessiner les machines se retrouve aussi dans les trains. Une fois parvenu à l’âge adulte, les traits de Jiro n’évoluent plus. En revanche, le spectateur prend conscience du temps qui passe en observant les différents modèles de locomotives qui traversent l’écran.
DÉBALLAGE D'ARCHIVES INTIMES
La violence sous-jacente dans Le vent se lève, n’est pas non plus une nouveauté. L’œuvre de Miyazaki regorge de conflits et de catastrophes plus ou moins naturelles. Cependant, le feu ici ne purifie pas, contrairement au tsunami de Ponyo sur la falaise. Après l’incendie qui ravage Tokyo, deux personnages remarquent — et semblent le regretter — que tout a été reconstruit très vite et à l’identique.
Il y aurait encore beaucoup à dire pour rendre compte de la beauté plastique de ce film et des nombreuses trouvailles cinématographiques de son auteur: la délicatesse d’une déclaration amoureuse par le truchement d’un planeur en papier et d’un chapeau, le destin qui surgit sous les traits d’un personnage aux yeux gris, dissident allemand, prophète de la destruction du Japon, l’intimité entre Jiro et Nahoko...
Lorsque le film se referme, aux portes de l’enfer, le spectateur a l’impression d’avoir assisté au déballage des archives intimes de Hayao Miyazaki. Ce film, qui renvoie à tous les précédents, sans les répéter, prouve, malgré son pessimisme, que la vie vaut la peine d’être rêvée.
Le vent se lève, Hayao Miyazaki, Japon, 2013.
Anna Aaron, la rockeuse en peau de poète
La musique de Anna Aaron mélange douceur et violence. D’un côté, sa voix pure, de l’autre le son grave du piano. C’est près du Marktplatz de Bâle que nous l’avons rencontrée, dans l’ambiance des percolateurs et du brouhaha des conversations. Son troisième album, Neuro, est sorti fin février en Suisse. Portrait d’une musicienne à la fois timide et séduisante.
La musique de Anna Aaron mélange douceur et violence. D’un côté, sa voix pure, de l’autre le son grave du piano. C’est près du Marktplatz de Bâle que nous l’avons rencontrée, dans l’ambiance des percolateurs et du brouhaha des conversations. Son troisième album, Neuro, est sorti fin février en Suisse. Portrait d’une musicienne à la fois timide et séduisante.
Mis en ligne le 1 mars 2014
[dropcap]A[/dropcap]nna Aaron a grandi en naviguant entre plusieurs mondes: Angleterre, Asie et Nouvelle-Zélande. À 12 ans, elle commence à suivre des cours de piano classique. Jusqu’au moment où, deux ans plus tard, son professeur qualifie le rock n’roll de «musique de Satan». Elle abandonne aussitôt son prof à ses imprécations hors d’âge. Car ces sonorités nées des amours contrariées du blues et de la country lui serviront de sources d’inspiration. Même si, aujourd’hui, son identité musicale ne saurait être catégorisée de façon péremptoire. Son style est avant tout personnel et s’exprime entre lyrisme et mélodies hantées.
«La musique est spontanée; elle ne se planifie pas», affirme- t-elle avec conviction, sa timidité se dissipant au fil de la conversation. Sa verve s’allume même, lorsqu’elle évoque sa rencontre déterminante avec un professeur de musique à l’École de jazz de Bâle qui lui a enseigné les rudiments de la composition: «Il m’a vraiment donné beaucoup d’éléments qui m’ont servi pour composer mes chansons.» Sa carrière professionnelle débute lorsqu’avec le batteur Giacun Schmid, elle autoproduit son premier disque I’ll dry your tears little murderer entre 2007 et 2008. Un premier essai qui lui permet de commencer à capter l’attention du public et de la presse spécialisée. En effet, si ces sept titres — qu’Anna Aaron et Giancun Schmid enregistrent avec des amis musiciens — respirent la naïveté, ils évoquent surtout un univers musical ténébreux, éclairé par une voix limpide.
«Au coeur du processus créatif, il y a toujours le travail que j’accomplis à la maison, sur mon ordinateur», précise-t-elle en ajoutant que ces compositions lui viennent généralement sous forme d’«une mélodie entière». Elle décide ensuite «si le morceau doit être produit ou si c’est une idée qu’il faut jeter». Quant à la nécessité de composer, elle en rigole doucement: «Les gens s’en font une idée un peu romantique.»
Le deuxième album d’Anna Aaron est sorti en 2011: Dogs In Spirit, produit par le bassiste Marcello Giuliani. Celui-ci joue dans le quartet du trompettiste français Erik Truffaz. Tous trois ont partagé la scène lors d’une tournée en 2013. Cette expérience a-t-elle remis en question la musique d’Anna Aaron? «Non, mais ce n’était pas le but», s’empresse-t-elle de préciser. Les trois musiciens partagent le même label lausannois: Two Gentlemen. Ce qui a évidemment facilité leur rencontre.
Craignait-elle de jouer avec un quartet de jazz? «Je n’avais pas peur parce que je n’ai pas réfléchi. Je ne me suis pas dit que c’est un objectif très exigeant. Je l’ai fait. J’étais assez naïve et cela m’a aidée», conclue-t-elle. L’ancienne étudiante de littérature et de philosophie aime changer d’univers d’un disque à l’autre. «Chaque album a son monde», assure-t-elle vivement. Les lectures et les films «font partie du processus de création». Elle nous parle aussi de son admiration pour Ludwig Wittgenstein, avec des gestes amples et vifs. «Il a eu le génie de trouver une analogie pour expliquer la frontière entre la raison et la compréhension», raconte-t-elle en citant encore l’écrivain Joseph Campbell, car «il parle des mythologies qui sont toujours les mêmes histoires et réapparaissent sous la même forme dans toutes les cultures». Cet autre intérêt pour l’universalité mythologique n’est pas étranger aux personnages qui apparaissent ici et là dans les textes d’Anna Aaron et au caractère poétique de ses compositions.
Cette énergie qu’elle voue à repenser sans cesse l’univers musical de ses créations passe également par un travail important sur l’image qu’elle effectue pour chacun de ses projets artistiques. Elle affirme que l’impact visuel «peut aussi transmettre des idées». Ce qui est notamment illustré par le clip du morceau Linda dans lequel la danseuse Oriana Cereghetti et Anna Aaron se fondent peu à peu dans un fourmillement numérique. D’où l’ambiance plus électronique et presque robotique de Neuro. Toutefois, la Bâloise y conserve la limpidité de son toucher pianistique, la profondeur de sa voix et y ajoute quelque chose de plus magique, plus aérien.
Le fait marquant la sortie de l’album Neuro est encore une fois un changement de producteur. Anna Aaron voulait effectivement travailler avec David Keaton qu’elle apprécie pour le «son magique et lumineux» qu’il produit. «C’était très irréaliste au départ, c’est un grand nom et on n’est jamais sûr qu’il vous réponde», affirme-t-elle, ravie par la réponse positive du Britannique. Qui a notamment produit Bat For Lashes dont l’album The Haunted Man a terminé dans les cinq meilleurs de Grande-Bretagne en 2012. Une bonne surprise ne vient jamais seule. C’est ainsi que Jason Cooper, le batteur de The Cure, s’est joint par hasard à l’enregistrement de l’album, à la suite d’un coup de téléphone échangé avec son ami David Keaton. «J’adore The Cure. C’était la folie quand je l’ai su!», s’émerveillet- elle. Ces hasards ont fait naître un album puissant, profond. Et loin de Satan.
6 mars: Nouveau Monde de Fribourg; 7 mars: Kaserne de Bâle; 8 mars: Pont Rouge de Monthey; 13 mars: Bogen F de Zurich; 14 mars: Dampfzentrale de Berne; 15 mars: Le Romandie de Lausanne www.annaaaron.com
www.lemurduson.ch
Un institut des cultures arabes voit le jour à Genève
14 janvier 2014
C’est une première. L’Institut des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM) ouvre ses portes à Genève. Le 14 janvier 2014, les fondateurs, Alain Bittar et Patrice Mugny, ont inauguré ce nouveau centre culturel dans les locaux de la librairie arabe L’Olivier, qui héberge le siège de l’ICAM. Le choix des lieux va de soi, puisque la cheville ouvrière et le concepteur de l’institut, Alain Bittar, n’est autre que le titulaire de L’Olivier.
Alain Bittar vu par © Charlotte Julie / Genève, 14 janvier 2014
Charlotte Julie
14 janvier 2014
C’est une première. L’Institut des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM) ouvre ses portes à Genève. Le 14 janvier 2014, les fondateurs, Alain Bittar et Patrice Mugny, ont inauguré ce nouveau centre culturel dans les locaux de la librairie arabe L’Olivier, qui héberge le siège de l’ICAM. Le choix des lieux va de soi, puisque la cheville ouvrière et le concepteur de l’institut, Alain Bittar, n’est autre que le titulaire de L’Olivier.
Il assumera dorénavant également la fonction de directeur de l’ICAM, avec une vision claire du rôle que jouera son institut: «Au vu des événements en cours dans le monde arabe, l’ICAM a pour but de continuer de développer à Genève un lieu favorisant les rencontres et les échanges ainsi que des événements qui reflètent la diversité des cultures concernées. Cette démarche jette par ailleurs des passerelles entre les communautés et contribue au rayonnement de la Genève internationale.»
Alain Bittar œuvrera en tandem avec Patrice Mugny, ancien maire et conseiller administratif de la Ville de Genève chargé de la culture, nommé à la présidence de l’ICAM. «Cet institut entend poursuivre et développer les activités culturelles et de médiation initiées par Alain Bittar depuis plus de trente ans. Des animations qui se développent et rencontrent un important succès», a-t-il souligné.
«Je salue la création de l’Institut des cultures arabes et méditerranéennes qui va dans le sens de l’enrichissement des activités associatives, ainsi que du renforcement de la diversité culturelle à Genève», a affirmé pour sa part Pierre Maudet, conseiller d’État genevois en charge du Département de la sécurité et de l’économie, ouvrant ainsi symboliquement le bras de la république genevoise à cette initiative. «La diversité de ses habitants et le mélange des cultures sont des atouts pour Genève. Ce nouvel institut valorisera les cultures avec lesquelles nous avons des liens forts ici et là-bas. Nous nous réjouissons de son ouverture qui permettra de valoriser la diversité culturelle», ont affirmé dans une déclaration conjointe la maire de Genève, Sandrine Salerno, et le conseiller administratif chargé de la culture, Sami Kanaan.
L’institut bénéficie du soutien de la Ville de Genève, du Bureau de l’intégration des étrangers de l’Etat de Genève ainsi que d’autres sponsors publics et privés. Il doit encore réunir plus de 120 000 francs pour boucler son budget annuel.
Les vies gâchées de la postmodernité
27 septembre 2013
Zygmunt Bauman demeure à 87 ans l’un des penseurs les plus féconds de notre temps. De la shoah aux conditions d’un renouveau du politique, des mécanismes de l’exclusion sociale aux effets de la culture médiatique, le sociologue polonais se veut l’interprète exigeant de la postmodernité. Un essai, premier du genre en français, en éclaire les enjeux.
«Le potentiel de la modernité demeure inexploité et la promesse de la modernité reste à tenir.» © Keystone EPA / Toni Albir / 11 mars 2013
Zygmunt Bauman demeure à 87 ans l’un des penseurs les plus féconds de notre temps. De la shoah aux conditions d’un renouveau du politique, des mécanismes de l’exclusion sociale aux effets de la culture médiatique, le sociologue polonais se veut l’interprète exigeant de la postmodernité. Un essai, premier du genre en français, en éclaire les enjeux.
Christian Ciocca
27 septembre 2013
Ce qui intéresse avant tout Zygmunt Bauman relève d’une interprétation sociologique pour «enrichir la réflexion sur ce que signifie être un humain dans le monde», analyse Keith Tester, professeur de sociologie de l’Université de Hull, au Royaume-Uni, cité en introduction de l’ouvrage que le philosophe français Pierre-Antoine Chardel consacre à Zygmunt Baumann. Les Illusions perdues de la modernité propose en deux cents pages un dialogue avec l’œuvre du penseur polonais, dont la diversité ne doit pas masquer l’unité¹.
L’ouvrage de Chardel enthousiasme par sa capacité à discuter les points de vue de Zygmunt Bauman en miroir de ses lectures multiples. Une telle démarche témoigne une attention constante aux exclus, une vive inquiétude face aux vies gâchées par les orientations économiques des dernières décennies. On estimera que de telles préoccupations collent à notre seul contemporain en oubliant l’apport décisif de Marx revisité par Gramsci, apport auquel Bauman est resté fidèle: «Un certain dégoût pour toutes les formes d’injustice sociale et la volonté de dénoncer les mensonges sous lesquels la responsabilité de la misère humaine est travestie et cachée à la vue de ceux qui souffrent», précisera-t-il dans un entretien en mars 2010.
Né en 1925 dans une famille juive de Poznan, Zygmunt Bauman a acquis une solide formation universitaire en sciences humaines et sociales en Union soviétique où sa famille s’était réfugiée après le partage de la Pologne entre l’Allemagne et l’URSS. Lieutenant dans l’Armée rouge, il participa à la libération de Berlin. Membre du parti communiste, apparemment bien intégré dans la Pologne en reconstruction, le jeune intellectuel fut néanmoins exclu de l’armée en 1953 suite à la campagne antisémite dans les pays de l’Est connue sous le nom du «complot des blouses blanches [médecins juifs]» soi-disant ligués contre Staline.
À la même époque, contre l’orthodoxie marxiste qui se gargarisait de «sociologie» dans tous les domaines, Zygmunt Bauman prit ses distances et se défia de toute théorie face à l’évaluation des phénomènes sociaux tout en poursuivant sa carrière à l’Université de Varsovie. En janvier 1968, il rompit de manière retentissante avec le Parti communiste polonais et fut contraint à l’exil. Il enseigna quelque temps à Tel-Aviv et aux États-Unis avant de s’installer en Grande-Bretagne en occupant une chaire de sociologie à l’Université de Leeds dès 1971.
Nomade malgré lui, l’exilé a médité l’inanité de toute ligne dogmatique et s’est davantage appuyé sur sa grande curiosité intellectuelle que sur des certitudes théoriques. Son compagnonnage avec Marx, Weber, Durkheim, Husserl, Gramsci, Arendt, Adorno, Lévinas, Simmel, Jonas, Élias, Castoriadis, Camus, Musil, Foucault, Baudrillard, Virilio, Løgstrup, Derrida, Gadamer, Bourdieu et Kundera... plaide en soi pour les remises en question.
La société liquide
Depuis le milieu du XIXe siècle, nous nous sommes habitués à fréquenter des spectres: celui du communisme pour tétaniser la bourgeoisie et éveiller le prolétariat, celui du totalitarisme pour accentuer la démocratie libérale, celui du spectacle pour piéger nos simulacres. Or, dans notre époque hantée par le nouveau spectre de la transparence, il est bien moins question d’esprits que de liquidités de toutes sortes. Bauman a progressivement perçu les évolutions des sociétés occidentales sous le signe des flux mais aussi de la liquidation. Au lieu de se heurter à la résistance des matériaux, faudrait-il désormais se noyer dans La Vie liquide, selon le titre de l’un de ses ouvrages?
La radicalité de son approche de la postmodernité marque une visée éthique et, de façon troublante, frappe par son évidence: «Dans une société moderne liquide, les réalisations individuelles ne peuvent se figer en biens durables car, en un instant, les atouts se changent en handicaps et les aptitudes en infirmités.» Avec ironie, Zygmunt Bauman a réinterprété les préceptes de sagesse de Lao-Tseu qui recommandait de se déplacer rapidement, sans jamais se battre contre le courant ni s’arrêter assez longtemps pour stagner... coulant comme de l’eau!
Cet éloge postmoderne de l’apathie soft, avoisinerait-il les analyses de Bauman sur l’holocauste (Modernité et holocauste, 2002)? Le premier grand chapitre détaille ses positions sur la shoah en discutant la vision hégelienne de l’histoire. Si le destin temporel de l’humanité devait culminer à l’âge moderne par le règne de la raison, Bauman ne suit pas Horkheimer et Adorno qui voyaient dans les mécanismes «rationnels» qui ont conduit à l’extermination des juifs un renversement négatif du rationalisme philosophique. L’élan émancipateur des Lumières se serait perverti en issue mortelle. Cette conception surplombante accrédite l’idée d’une inexorable marche tragique de l’histoire. Là encore, Zygmunt Bauman s’interroge sur cette «banalité du mal», selon la formule ressassée de la philosophe allemande Hannah Arendt, sans l’accepter. Dans la perspective d’une soi-disant «banalité», la shoah aurait-elle été commise «avec insouciance, comme par étourderie?»
Dans ce questionnement vertigineux, il a cherché à appréhender cet «événement sinistre et terrifiant, rédigé selon son propre code», en brisant ce code avant de le rendre compréhensible. à ce titre, proche d’Arendt et de l’École de Francfort, Zygmunt Bauman a pensé la shoah «comme un symptôme retentissant des sociétés industrielles et de leur mode d’organisation», en précisant qu’il lui importe de ne jamais perdre de vue les témoignages des hommes et des femmes frappés par l’horreur. Ainsi, il se montre un interprète soucieux de recueillir au plus près la parole soulevée par l’expérience, hier comme aujourd’hui.
C’est plutôt l’«exténuation de toute sensibilité morale», par soumission au totalitarisme technocratique et bureaucratique, qui doit nous alerter, alerte que Zygmunt Bauman réactive dans notre contemporain. Il insiste sur l’efficacité technique et administrative du génocide par l’usage généralisé de «somnifères moraux», nécessaires aux bourreaux pour leur rendre invisibles les conséquences des décisions criminelles. En se gardant de tout amalgame réducteur, comment ne pas s’étonner du règne d’Hypnos dans nos sociétés dont la géométrie éthique fluctue en «variables» accommodantes en proportion de l’effacement du souci d’altérité. «[...] le fait que je sois attaché à l’Autre par des moyens émotionnels signifie que je suis responsable de lui, et par-dessus tout de ce que mon action ou mon inaction peut lui faire», souligne-t-il dans La Vie en miettes (2003).
Le réfugié ineffable
Le socle trinitaire de l’État-nation reposant sur le territoire, la souveraineté étatique et l’unité nationale, modèle planétaire du siècle dernier, cède la place à des distorsions significatives. «Les États dans leur dimension libérale semblent aujourd’hui devenir de moins en moins intégrateurs et à même d’endiguer les pressions du capitalisme actionnarial. Ils s’avèrent majoritairement impuissants à dresser le bilan au sein de leurs propres frontières, à imposer des critères de protection et de régulation, à garantir un minimum de principes éthiques et de modèles de justice qui atténueraient l’insécurité sociale et apaiseraient l’incertitude qui fragilise en profondeur la confiance en soi des individus», observe Zygmunt Bauman dans La Société assiégée (2005). Or, le souci d’éthique qui passe chez lui par un véritable engagement subjectif en reconnaissance de l’Autre se répand aujourd’hui dans l’économie mondialisée.
Pour être respectueuse de l’environnement, attentive aux conditions de travail dans les pays émergents ou sourcilleuse quant à l’application des droits de l’homme, «l’éthique des affaires» n’en contamine pas moins toute la sphère économique et guide les gestes communicateurs des politiciens. Cette honnêteté contractuelle, pour souhaitable qu’elle puisse paraître, se révèle pourtant formaliste et très instable. Elle s’exporte avec succès mais peine à s’ancrer solidement dans les sociétés occidentales à l’heure de l’exclusion au nom des intérêts sécuritaires des citoyens.
Ce paradoxe n’est pas fortuit, il dessine les contours des politiques de ségrégation qui remplacent, selon Zygmunt Bauman, les normes de contrôle social encore actives hier. Face aux potentialités apparemment infinies d’épanouissement par la consommation, il s’agit aujourd’hui de définir quels individus ont accès aux marchés et aux crédits. L’enjeu est tel que Bauman le qualifie, dans La Société assiégée, d’une «guerre dont les désirs sont les principales armes. On a soin d’éviter que les habitudes, même celles qui sont promues le plus énergiquement, se figent en traditions. Les changements de désirs, soutenus par une attention fluctuante, constituent le plus efficace des remèdes préventifs». Les conséquences en sont terrifiantes: «C’est bien l’exclusion, et non l’exploitation, comme le suggérait Marx il y a 150 ans, qui est aujourd’hui à l’origine des cas les plus flagrants de polarisation sociale, d’inégalité croissante et d’augmentation massive de la pauvreté, de la misère et de l’humiliation» (Vies perdues, la Modernité et ses exclus, 2006).
Restaurer la société hétérogène
Victimes de l’indifférence morale tout aussi dévastatrice que l’exploitation à outrance, les réfugiés incarnent le destin des «déchets humains» vivant une souffrance indicible, cernés dans un no man’s land, mais assignés à résidence, interdits d’avenir et de lieux chargés de sens et de socialisation. En cela, ils reflètent a contrario l’immobilisme économique en proie à sa propre dévoration.
Pour Antoine Chardel, Zygmunt Bauman se veut l’interprète et non le législateur de notre temps, mais n’en prône pas pour autant la seule distanciation critique. à l’impuissance des intellectuels et des politiques face au désordre des dérégulations, le sociologue réplique: «Le potentiel de la modernité demeure inexploité, et la promesse de la modernité reste à tenir.» Autrement dit, il s’agirait pour chacun d’entre nous de s’atteler à restaurer les valeurs d’autonomie et d’accomplissement individuel orientées vers la personne pour construire une société rationnelle et garante de son hétérogénéité. La tâche, on le voit, s’avère immense, non seulement réparatrice, mais au-devant de nous.
Gageons qu’elle s’imposera à nos consciences fatiguées par deux décennies de démoralisation pour peu que nous puissions détourner nos regards des sollicitations accélérées par écrans interposés... où l’autre se virtualise si bien mais se ressent si mal.
Paru dans La Cité du 27 septembre 2013
1. Pierre-Antoine Chardel, Zygmunt Bauman. Les illusions perdues de la modernité, CNRS Éditions, 2013.
2. La plupart des traductions de Bauman sont publiées aux Éditions Le Rouergue/Jacqueline Chambon.