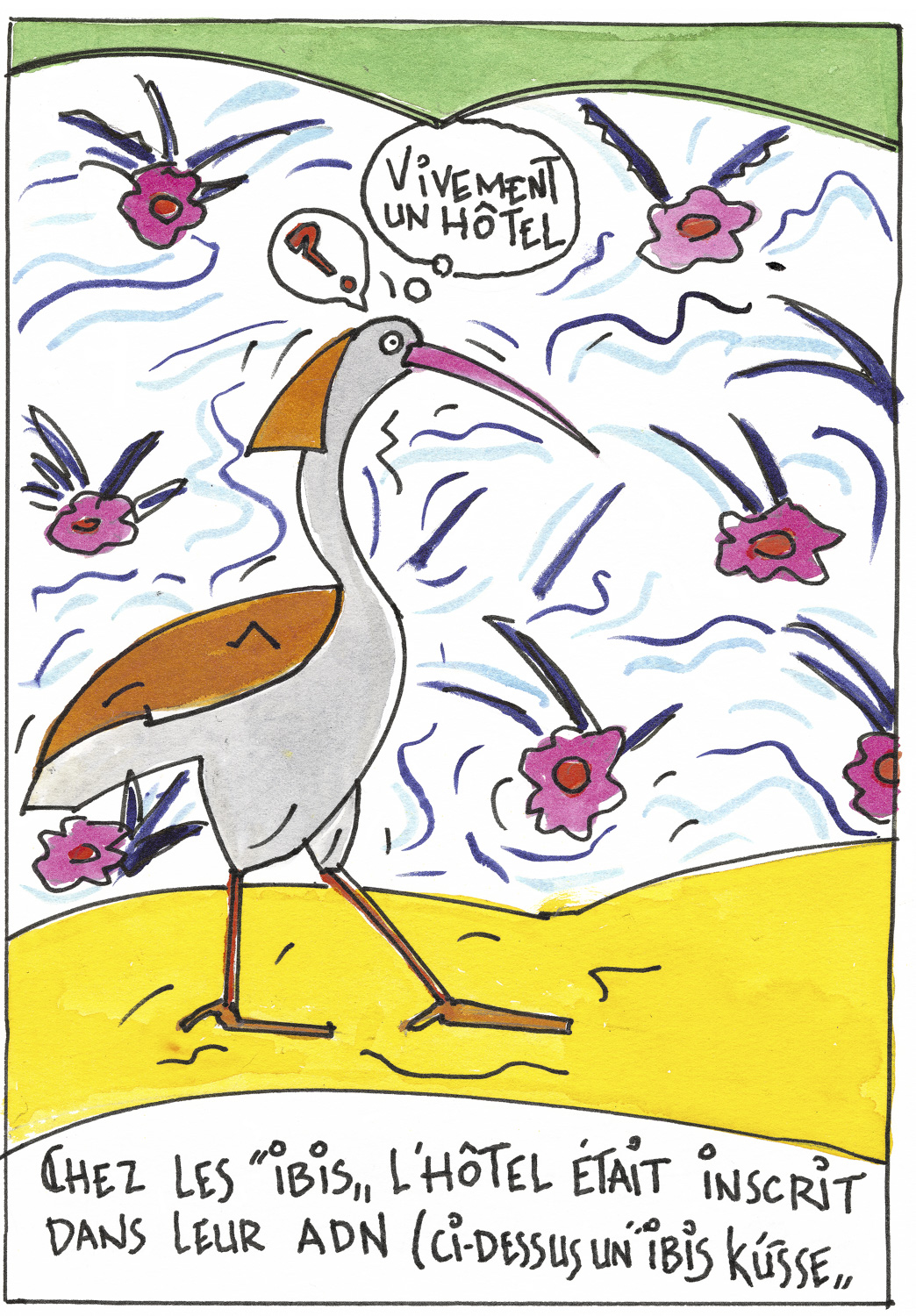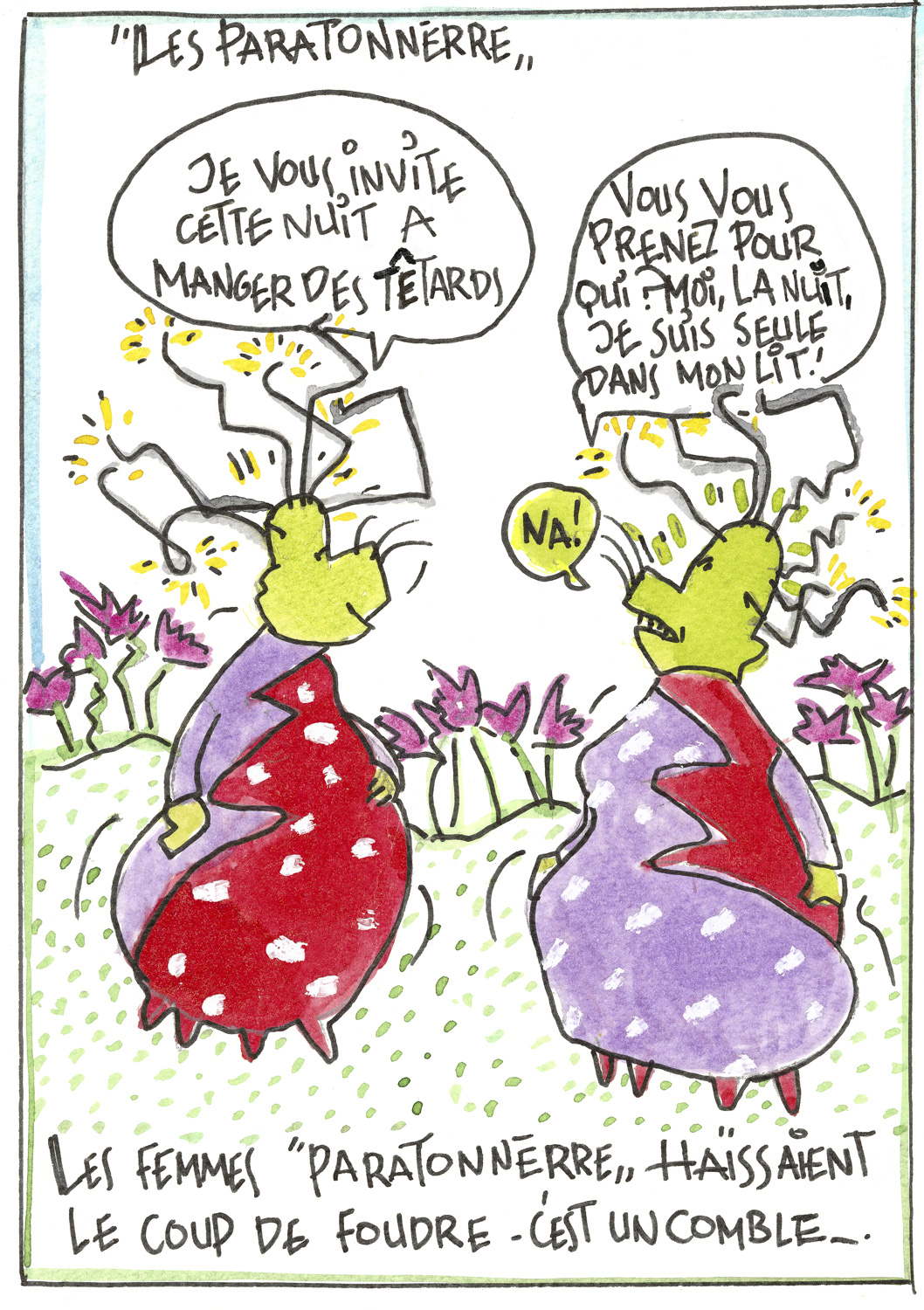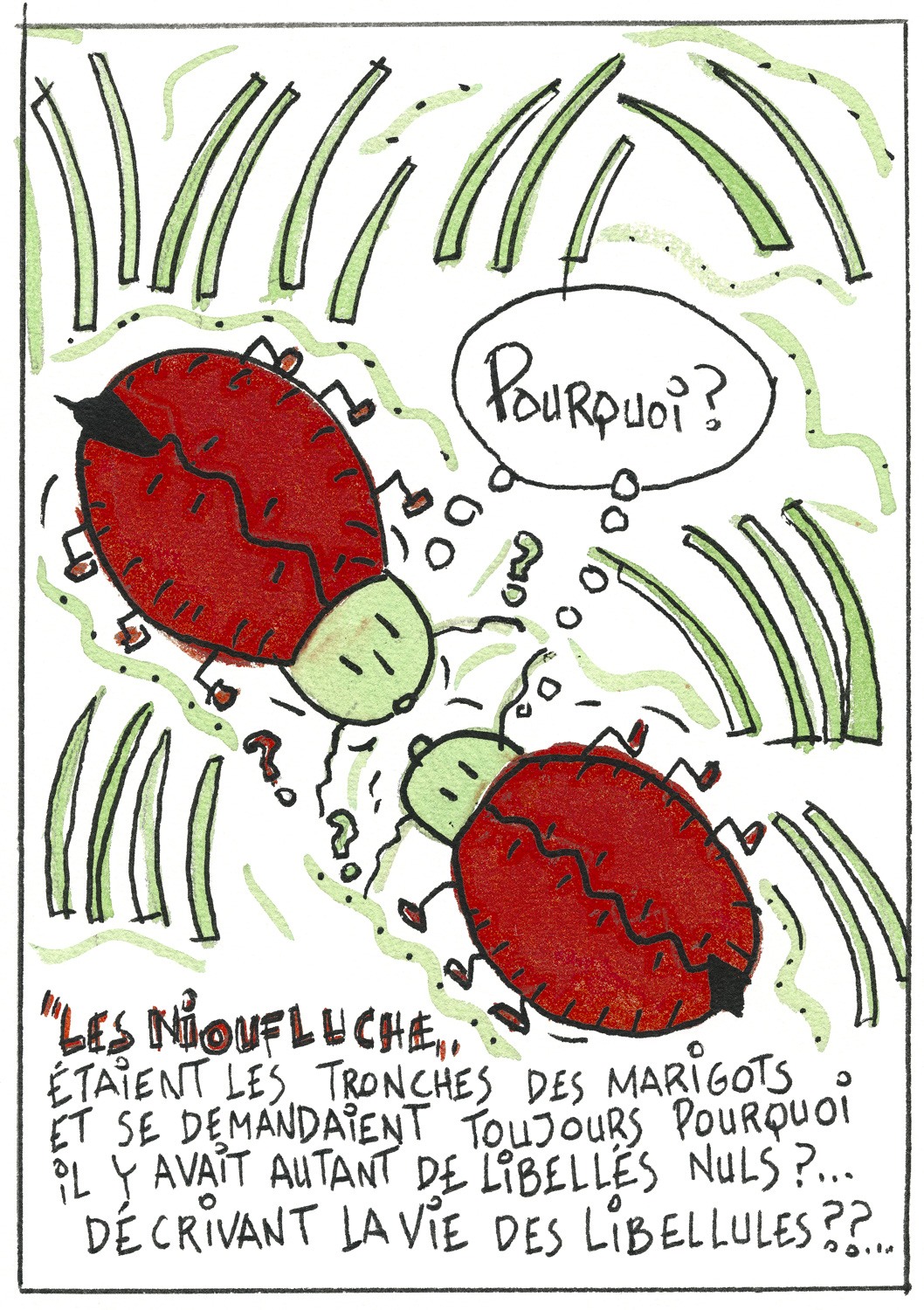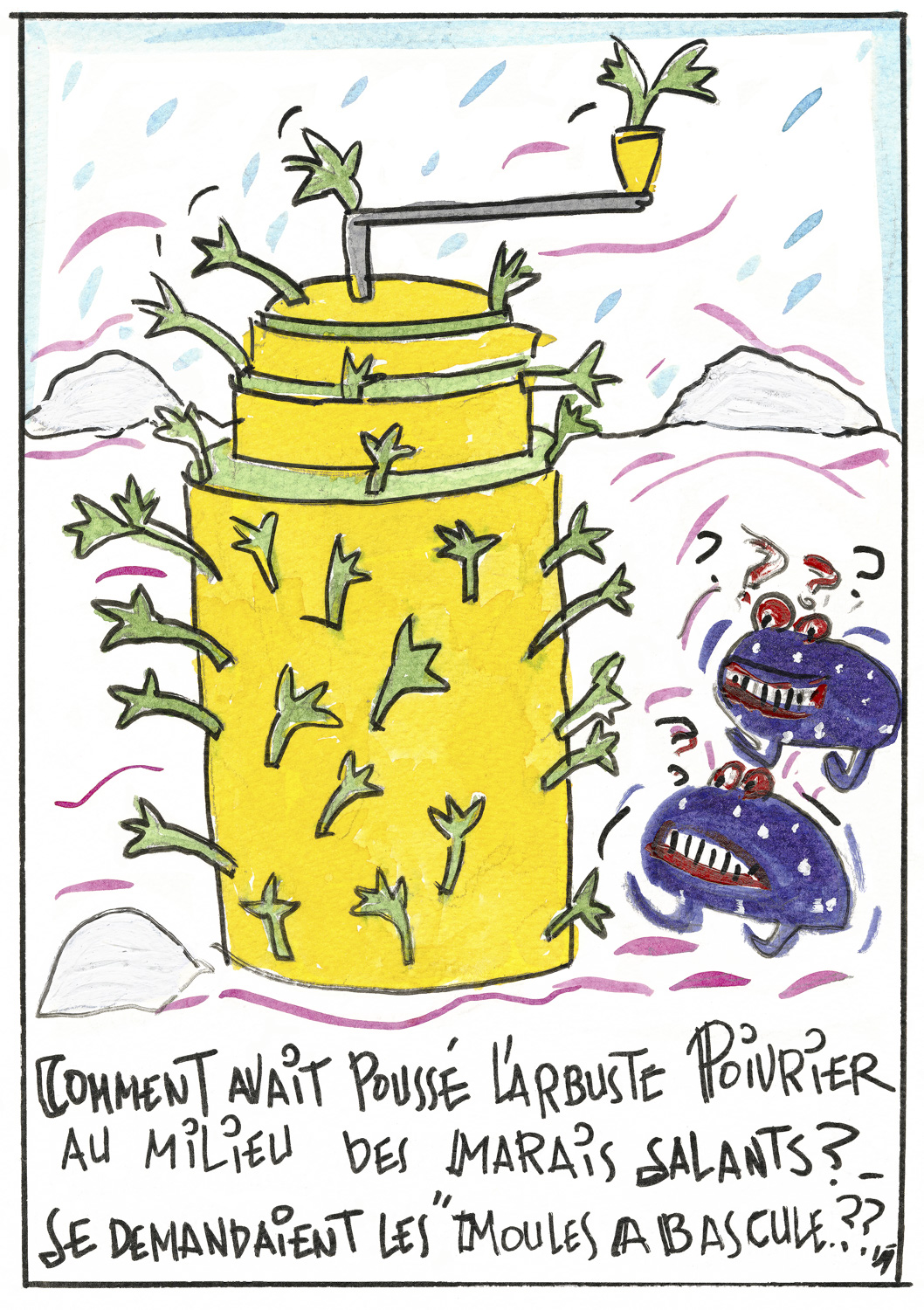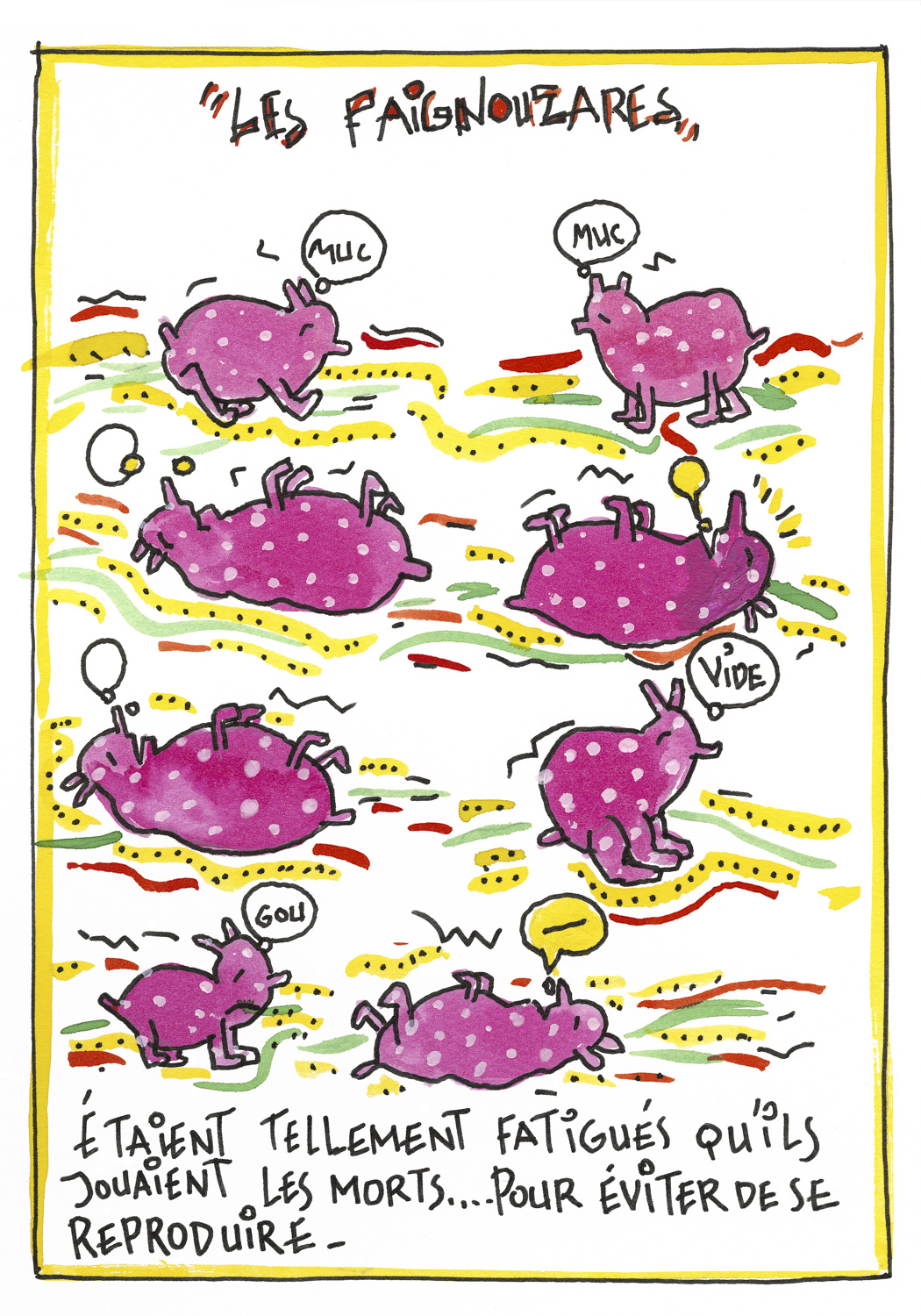Amok ou le mystère Stefan Zweig
22 janvier 2016 — Le comédien français Francis Huster a joué à Genève, en première mondiale, la pièce «Amok» tirée d’une nouvelle du grand écrivain austro-hongrois.
Le comédien Francis Huster apprécie tout particulièrement Genève et le Théâtre du Léman, où il choisi de présenter, jeudi 21 janvier, la première mondiale de sa pièce «Amok», adaptation réussie de la nouvelle de l’écrivain austro-hongrois Stefan Zweig, mise en scène par Steve Suissa. Œuvre envoutante sur l’amour, la mort et cette frénésie destructrice, parfois meurtrière que les Malaisiens appellent l’amok.
Publié le 22 janvier 2016
Par Luisa Ballin
Né à Vienne, en 1881, naturalisé Anglais en 1940, l’écrivain, dramaturge, biographe et journaliste se donne mort au Brésil en 1942, avec sa deuxième épouse et secrétaire Charlotte Elisabeth Altmann, dite Lotte. Auteur fascinant, Stefan Zweig garde une part de mystère plus de 70 ans après sa disparition. Il laisse une œuvre qui reste dans l’air du temps et que Francis Huster a choisi de remettre en lumière avec brio.
Après avoir triomphé dans «Le joueur d’échecs» et avant de monter «L’Enigme Stefan Zweig», dont la première mondiale sera présentée au Théâtre du Léman le 8 mai, l’homme de théâtre et son complice metteur en scène ont donné au public genevois la primeur de découvrir «Amok», avant une tournée internationale.
Pour recréer sur les planches l’atmosphère envoûtante qui se dégage à la lecture de l’œuvre de celui qui fut sans doute le plus grand écrivain de son temps, il fallait le talent d’un grand comédien et l’audace d’un metteur en scène à la sobriété originale. Francis Huster et Steve Suissa ont emmené le public genevois dans une «traversée d’âme» à bord de l’Océania, le transatlantique qui ramène l’anti-héros de cette histoire haletante de Calcutta à Londres. Médecin officiant en Malaisie dans l’entre-deux guerres l’homme désabusé se confie à l’auteur devenu conteur, dévoilant sa dépendance au souvenir de l’amok qui l’avait foudroyé et qui avait brisé sa carrière.
Sur le pont du paquebot qui vogue vers l’Europe qu’il avait fuie, le médecin se confie une nuit à l’homme rencontré par hasard. Une femme de la haute société anglaise, enceinte de son jeune amant, lui a demandé de l’avorter pour sauver sa réputation et éviter le scandale avant le retour de son mari. Francis Huster incarne avec maestria tour à tour le médecin prisonnier de ses tourments et l’inconnu devenu conteur.
Seul sur scène, il n’est rejoint que pendant quelques instants fugaces par la présence muette d’une femme vêtue de rouge et de noir. Mirage féminin pour évoquer celle qui obsède le médecin, rappelé à ses souvenirs par une musique qui accompagne ses confessions dont l’intensité est soulignée par un faisceau de lumière rouge ou atténuée par un halo de fumée.
Si les ressorts qui ont mené à l’amok sont révélés dans ce face-à-face poignant qui ira au-delà de la nuit, «l’énigme Stefan Zweig» demeure. Fasciné par l’écrivain viennois, Francis Huster, devenu son biographe le plus passionné, a commis un livre enquête sur les motifs qui ont conduit cet homme de lettres érudit et raffiné à mettre fins à ses jours, alors qu’il connaissait la gloire tant dans la Vieille Europe que dans le Nouveau Monde.
Les symptôme d’une dépression qui a frappé Zweig suite à la boucherie de la Première Guerre mondiale et à la montée du nazisme et de l’antisémitisme n’expliquent pas le geste fatal de l’auteur de nouvelles qui ont marqué l’histoire de la littérature: Le joueur d’échecs, La confusion des sentiments, Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme et Amok, texte qui n’a rien perdu de sa puissance.
En saluant le public du Théâtre du Léman à la fin de la première mondiale d’«Amok », moment de théâtre fort mais malheureusement éphémère, Francis Huster a rappelé l’attachement de Stefan Zweig à la Suisse où l’écrivain était venu à plusieurs reprises. Il a rendu hommage à l’engagement moral et a évoqué, tout en finesse, la résonance entre ce qui s’est passé lors des persécutions jadis et ce qui se passe aujourd’hui dans une Europe qui ferme ses frontières aux milliers de personnes qui fuient la violence dans leurs pays en conflit.
Les mots de Stefan Zweig dans son autobiographie «Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen» étaient-ils prémonitoires? «Né en 1881 dans un grand et puissant empire [...], il m’a fallu le quitter comme un criminel. Mon œuvre littéraire, dans sa langue originale, a été réduite en cendres. Étranger partout, l’Europe est perdue pour moi... J’ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison [...]. Cette pestilence des pestilences, le nationalisme, a empoisonné la fleur de notre culture européenne.»
Francis Huster sera à l’Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates, le 11mars à 20h00,
où il reprendra «Le joueur d’échecs», d’après Stefan Zweig, mis en scène par Steve Suissa. http://www.leprogramme.ch/programme-de-la-saison/espace-velodrome/plan-les-ouates
Francis Huster reviendra au Théâtre du Léman à Genève, le 8 mai à 20h30, pour la première mondiale de sa pièce «L’Enigme Stefan Zweig», également mise en scène par Steve Suissa. http://www.theatreduleman.com/new.html
«La Route du Levant», face-à-face décapant entre un aspirant djihadiste et un policier
16 janvier 2016 — Le dramaturge genevois Dominque Ziegler met en scène une pièce policière à l’humour percutant qui confronte deux visions monde. À voir au théâtre du Grütli à Genève jusqu’au 4 février.
Le dramaturge genevois Dominque Ziegler met en scène une pièce policière à l’humour percutant qui confronte deux visions du monde. À voir au théâtre du Grütli à Genève jusqu’au 4 février.
Publié le 16 janvier 2016
Par Luisa Ballin
Dominique Ziegler a le sens du rythme, de l’humour, de l’histoire et de l’actualité. À l’heure où des attentats terroristes revendiqués par la nébuleuse islamiste sèment mort et terreur dans de nombreux pays, l’homme de théâtre genevois signe le texte et la mise en scène de «La Route du Levant», face-à-face décapant entre un aspirant djihadiste et un représentant de l’ordre républicain.
Dans une unité de temps et de lieu — un jour, ou une nuit, dans un sinistre commissariat de banlieue —, le spectateur assiste à une joute oratoire où s’affrontent deux visions subjectives de la société mondialisée: celle qu’un jeune en mal d’identité voudrait islamiste et celle qu’un représentant de l’ordre veut résolument républicaine. Avec pour guide suprême et allié indispensable, internet, l’omniprésent.
© Alex Kurth / alex@alexkurth.ch
Choc des cultures entre un jeune qui rêve de départ et de jihad à portée de clic et un policier qui tente de le dissuader de passer à l’acte. Tout en l’invitant au passage à collaborer pour aider police et justice à démanteler les filières de recrutement au départ pour la dite guerre sainte au Levant et en Occident. Le décor est minimaliste, pour mieux enfermer le spectateur et les deux protagonistes, dans un huis-clos qui colle à l’actualité et réveille les consciences. Deux destins, une histoire de dérives et une chute à rebondissement.
Le théâtre de Dominique Ziegler fait rire, réfléchir et captiver. Le dramaturge genevois tend des miroirs à qui veut les saisir pour s’interroger ou décrypter des enjeux de nos sociétés. «L’idée de cette pièce est née à la lecture d’articles de journaux qui relataient la recrudescence du nombre de jeunes Européens en partance pour la Syrie ou l’Irak, séduits par la propagande des groupes extrémistes d’Al-Qaida ou de Daech», explique Dominique Ziegler. Le propos est clair. La trame de la pièce est, elle, sans temps mort et les répliques aiguisées.
FASCINATION MYSTÉRIEUSE
«Le départ pour le djihad de jeunes gens éduqués dans les écoles républicaines ayant vécu dans une société occidentale reste un mystère, malgré l’écho médiatique que rencontre cette problématique», s’interroge Dominique Ziegler qui, s’il n’apporte pas de réponse à cette question lancinante, propose quelques pistes de réflexion truffées de bons mots et de remarques pertinentes pour mieux saisir le point de vue des deux protagonistes de sa pièce qui iront jusqu’au bout de leurs logiques antagonistes.
© Alex Kurth / alex@alexkurth.ch
«La Route du Levant» est aussi un questionnement sur une certaine utilisation du web qui, comme l’affirme le metteur en scène, «permet le lavage de cerveau, la propagande massive qui utilise parfois les codes de l’entertainment hollywoodien pour les retourner contre leur initiateurs et défendre une conception rigoriste et extrémiste de la religion. Le net n’est plus simple technologie, mais acteur à part entière de cette nouvelle confrontation interplanétaire. Il est arme, il est champ de batailles, il est substitut de prêche, il est logiciel espion, il est lieu de recrutement et de planification». Il peut aussi être arme de dissuasion massive qui permet parfois aux autorités de traquer et d’arrêter les djihadistes présents et futurs, d’accumuler des preuves et de déjouer des attentats.
Politique, policière et populaire, «La Route du Levant» est une œuvre à l’humour percutant qui interpelle. Conçue pour tous publics, toutes générations et toutes sensibilités confondues, la pièce est interprétée par Olivier Lafrance et Ludovic Payet qui campent avec talent le policier et le djihadiste.
La Route du Levant
pièce écrite et mise en scène par Dominique Ziegler.
Avec Olivier Lafrance et Ludovic Payet.
À voir jusqu’au 4 février au Théâtre du Grütli à Genève.
Du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 18h
Réservations: 022 888 44 88
ou www.grutli.ch
Le japonisme bouddhique, mystère dévoilé du pays du Soleil Levant
5 janvier 2016 — Plus que quelques jours! Ne ratez pas «Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme bouddhique», magique et envoûtante immersion au pays du Soleil Levant, dont la spiritualité sans Dieu a séduit voyageurs, peintres et écrivains, dont le Genevois Nicolas Bouvier. L’exposition a lieu jusqu’au 10 janvier au Musée d’ethnographie de Genève (MEG).
Tous droits réservés en dehors de la communication de l’exposition «Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme bouddhique» Du 9 septembre 2015 au 10 janvier 2016 au Musée d’ethnographie de Genève.
Publié le 5 janvier 2016
Par Luisa Ballin
Plus que quelques jours! Ne ratez pas «Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme bouddhique», magique et envoûtante immersion au pays du Soleil Levant, dont la spiritualité sans Dieu a séduit voyageurs, peintres et écrivains, dont le Genevois Nicolas Bouvier. L’exposition a lieu jusqu’au 10 janvier au Musée d’ethnographie de Genève (MEG).
Dans le dernier tiers du XIXe siècle, les Occidentaux découvrent le Japon qui vient de s’ouvrir au monde. Son histoire intrigue. Sa culture fascine. Elle influencera les beaux-arts européens et inspirera notamment l’Art nouveau. Et le japonisme ne laissera indifférents ni les peintres, ni les écrivains, comme Pierre Loti qui écrira Madame Chrysanthème, livre qui inspirera à Giacomo Puccini son opéra le plus célèbre Madama Butterfly, l’une des œuvres du Bel Canto la plus jouée au monde. Le MEG propose livres et livrets, photos et objets de la genèse de cet opéra, ainsi qu’une vidéo qui projette sur grand écran, casques audio à l’appui, l’un des airs de cette œuvre lyrique qui marquera paradoxalement le crépuscule du japonisme.
L’exposition du MEG, sobre et d’une grande élégance, donne à voir quelques fragments de la rencontre des cultures européenne et japonaise et évoque le bouddhisme du pays du Soleil Levant comme l’une des composantes de la spiritualité universelle. La découverte des six sections qui structurent l’exposition permet de s’imprégner de l’atmosphère que le visiteur imagine être celle de ce pays resté mystérieux, tout en admirant des objets raffinés au style épuré venus de célèbres musées, dont le Musée national des arts asiatiques, devenu également un musée des religions de ce continent, fondé à Paris par Émile Guimet qui invitera le peintre japonisant Félix Régamey (1844-1907) à immortaliser son périple au Japon.
Outre la présentation, pour la première fois depuis cent ans, de sept grandes huiles du peintre, le MEG propose une évocation de la cérémonie bouddhique que deux religieux japonais célébrèrent au Musée Guimet en 1891, avec une partie du mobilier d’origine.
Le Japon, devenu escale incontournable pour de nombreux voyageurs, dévoilera ses traditions, sa culture et son organisation sociale, tout en gardant une part de mystère. En 1872, l’Anglais Thomas Cook lancera la vogue des voyages organisés pour particuliers, inaugurant ainsi le premier périple autour du monde. Les jeunes de bonne famille ne manqueront de saisir cet appel du large afin de parfaire leur instruction au pays des samouraïs, des shoguns et des geishas. Comme de nombreux autres Genevois, le peintre et collectionneur Alfred Étienne Dumont séjournera au Japon en 1891. L’exposition du MEG présente ses dessins, jamais montrés au public auparavant, que l’artiste a exécuté au gré de ses escales. Paysages et instants de vies croqués sur les quais qui permettent au visiteur de capter quelques bribes d’un Japon devenu désir d’Orient lointain.
Si Genève vibre depuis le mois de septembre et pour quelques jours encore aux sons et aux images du japonisme bouddhique, grâce à cette exposition à ne pas manquer, et aux conférence, films, ballades au fil des mots et des sons qui ont jalonné cette immersion japonisante, son moment culminant a eu lieu à l’Alhambra, lors de l’interprétation de trois danses de Miyakita Yoshitaka, passionné de danse depuis l’âge de deux ans, élève de Nakamura Mansaku pendant dix ans, puis son digne successeur à la tête de l’école du maître. Spectacle rare et inoubliable proposé par la Société des Amis du MEG, le jeune danseur, vénéré comme une idole au Japon, a offert trois danses représentant respectivement la neige, les feuilles tombantes, la mer. Moment de grâce qui a permis ou spectateur ébloui de mieux comprendre l’âme japonaise.
ÉCOUTER ET RELIRE NICOLAS BOUVIER, CONTEUR DU JAPON
L’écrivain, poète, photographe, iconographe et grand voyageur genevois Nicolas Bouvier est également présent dans l’exposition «Le bouddhisme de Madame Butterfly», grâce à d’une vidéo projetée en boucle où il relate le premier des trois voyages qu’il a effectués au Japon, lorsqu’il fut l’un des premiers photographe européens à proposer des images aux agences japonaises, quelques années après la fin de la guerre.
Tous droits réservés en dehors de la communication de l’exposition «Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme bouddhique» Du 9 septembre 2015 au 10 janvier 2016 au Musée d’ethnographie de Genève.
Débarquant à Yocohama en 1955, avec pour toute fortune 25 dollars pour son premier séjour (1955-1956), Nicolas Bouvier note que: «L’air de Yokohama s’avalait comme du Champagne.» Initié à la photo par Jean Mohr peu avant son départ pour le pays du Soleil Levant, ses portraits de Japonaises et de Japonais croisés au hasard de ses pérégrination nippones, tout comme ses Chroniques japonaises, sont une référence dans le monde de l’édition et pour tout écrivain voyageur qui se respecte.
En 1964, Nicolas Bouvier retournera au Japon avec son épouse Éliane et leurs deux fils. Séjours et expériences seront consignés en 1967 dans son livre Japon, qui sera réédité en 1989 sous le titre Chroniques Japonaises. On peut y lire notamment: «Le voyageur est une source continuelle de perplexités. Sa place est partout et nulle part. Il vit d'instants volés, de reflets, de menus présents, d'aubaines et de miettes.»
Tous droits réservés en dehors de la communication de l’exposition «Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme bouddhique» Du 9 septembre 2015 au 10 janvier 2016 au Musée d’ethnographie de Genève.
Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme bouddhique.
Jusqu’au 10 janvier au Musée d’ethnographie de Genève,
Boulevard Carl-Vogt 65-67, 1205 Genève.
Toutes les informations sont sur www.meg-geneve.ch
La sculptrice Catherine Bouroche a rejoint ses nuages
13 décembre 2015 — Cette grande artiste française nous a laissé sur la terre, vendredi matin, 12 décembre, à Paris, sa ville de résidence.
Comment sculpter un élément aussi dépourvu de densité qu’un nuage? Catherine Bouroche avait réussi ce tour, non de force, mais de douceur. Cette douceur plus vigoureuse, plus pleine de vie que toutes les apparences de la puissance. Cette grande sculptrice française a rejoint ses nuages. Elle nous a laissé sur la terre, vendredi matin, 12 décembre, à Paris, sa ville de résidence, alors que la Galerie ART Aujourd’hui lui consacre actuellement une exposition en compagnie des œuvres de Gianbattista Bresciani, Nadine Cosentino et Jean-Marc Ehanno*.
Publié le 13 décembre 2015
Par Jean-Noël Cuénod
Née en 1942 à Casteljaloux (Lot-et-Garonne), Catherine Bouroche a obtenu en 1965 son diplôme de l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art à Paris. Trois ans plus tard, elle s’est installée dans son atelier, rue Pradier dans le XIXe arrondissement parisien. De 1975 à 1977, elle a réalisé des œuvres monumentales pour plusieurs établissements scolaires. L’année 1992 marque un tournant dans son œuvre. Elle scelle sa rencontre avec le plexiglas qui lui permet d’exprimer son univers onirique peuplé de formes légères, nébuleuses mais denses, éclairé ça et là de touches d’humour.
Le peintre Philippe Rillon– qui anime la Galerie ART Aujourd’hui avec Marianne Rillon et Daniel Chassagne – a bien décrit le travail de la sculptrice : Catherine Bouroche, tout en délicatesse et légèreté, aime interroger et surprendre nosregards et nos esprits. Jamais ses nuages ne suggèrent des orages ou des drames. Tiens, il pleut...! C'est pas grave! Les nuages traversent la fenêtre, on peut les attraper, les caresser, ils sontlisses, prendre leur empreinte, les mettre en cage, ouvrir la cage, les ausculter, les disséquer, rien de grave! Et le ciel, lui, estlimpide et clair comme la plaque de verre ou le miroir qui le signifie. Chez Catherine Bouroche, ciels et nuagessont "idéaux". Ils sont une invitation au voyage.
Dans son œuvre, rien de répétitif. Chaque nuage a son «être» qui lui est propre. Il vit sa vie de nuage, l’air de rien. Ou plutôt l’air de tout. Puisque tout est air, tout est vide entre les particules de la matière. La vapeur a une solidité que lui envierait la pierre. L’apparence des choses est un faux-semblant. Catherine Bouroche définit les contours du vrai-semblant. Puissent les nuages lui tenir chaud.
* Exposition
Temps calme, beau fixe…
jusqu’au 20 décembre 2015
Galerie ART Aujourd’hui
8 rue Alfred-Stevens
75009 Paris
http://galerie-art-aujourdhui.com/fr/
Paru dans le blogue «Un Plouc chez les Bobos» www.jncuenod.com
Allende, à la recherche d’un grand-père au delà du mythe
8 décembre 2015 — La petite fille de Salvador Allende présente à Genève le documentaire qu’elle a consacré à son abuelo (grand-père), tué en 1973 par les putschistes à la botte du général Pinochet.
© Adok Films Distribution
La petite fille de Salvador Allende présente à Genève le documentaire qu’elle a consacré à son abuelo (grand-père), mort en 1973 lors du coup d’État perpétré par les putschistes du général Pinochet.
Publié le 8 décembre 2015
Par Luisa Ballin
Cela a commencé comme une recherche personnelle. J’avais besoin de connaître l’homme qu’était mon grand-père. L’intimité du père de famille et du grand-père que je n’ai pas connu.» Dans un entretien accordé à La Cité, Marcia Tambutti Allende, petite fille de Salvador Allende, président du Chili démocratiquement élu en 1970 puis renversé le 11 septembre 1973 par le général Pinochet lors d’un coup d’État militaire sanglant, explique la genèse du documentaire Allende, mi abuelo Allende (Allende, mon grand-père Allende), projeté en avant première lors de la 17e édition du Festival FILMAR en América Latina, un film qu’elle présente le soir du 9 décembre à Genève aux Cinémas du Grütli.
Pénétrer dans la vie intime de Salvador Allende. Savoir comment il était en vacances et dans la vie quotidienne. Découvrir qui prenait les décisions à la maison. Percer les secrets, y compris les amours, du premier dirigeant socialiste à avoir accédé à la présidence d’un pays par la voie des urnes dans une coalition comprenant des communistes. «Tout ce que l’on ne trouve pas dans les biographies qui lui sont consacrées. Voilà la démarche qui m’a motivée», explique Marcia Tambutti Allende, auteure d’une œuvre honnête et intimiste dédiée à ce grand-père devenu un mythe, qu’elle n’a pas connu. «Mon film est le portrait d’un homme, pour une génération qui cherche à en savoir plus et à enfreindre l’inertie du silence qui peut nous mener à la perte de la mémoire familiale et de l’identité. L’homme Allende était un sujet un peu tabou dans la famille. Lorsque nous étions petits et que nous posions des questions, la réaction des adultes était de se protéger, de garder le silence ou d’en dire le moins possible. Comme une petite censure qui fait que l’on s’autocensure également», explique la jeune femme, qui a su mettre en mots et en images les non-dits de sa célèbre famille.
«ON S’IMAGINE MAL CE QUI ENTOURE LA VIE D’UN LEADER POLITIQUE»
Ce documentaire, qui a obtenu L'Œil d’or, prix du documentaire au Festival de Cannes 2015, lui a-t-il permis de découvrir la vie secrète de son grand-père? «Plus que la découverte de ses secrets, j’ai réussi à cerner un personnage qui se résumait à des mots sans beaucoup de contenu. J’ai pu aller au-delà de ce qui se trouve dans les livres. Approfondir la façon dont il travaillait pendant les campagnes électorales et mieux connaître la vie quotidienne de la famille lorsqu’il était pris par la politique. On s’imagine mal ce qui entoure la vie d’un leader politique et les sacrifices qui incombent à sa famille, comme par exemple vendre une maison pour éponger les dettes d’une campagne électorale. Ce n’était pas un secret, mais dans la famille, on n’en parlait pas.»
Marcia Tambutti Allende n’occulte pas non plus les amours contingentes de Salvador Allende, à côté du sentiment profond qu’il avait pour son épouse Hortensia Bussi, appelée affectueusement Tencha. «Lorsque j’étais petite, ma mère — Isabel Allende, dirigeante socialiste qui a présidé successivement la Chambre des députés et le Sénat du Chili — m’avait dit que mon grand-père avait eu d’autres femmes à part ma grand-mère. Ce film m’a aidé à mieux comprendre l’homme, les traces qu’il a laissées, la douleur de ma famille après le coup d’État et les exils. Le nôtre, celui de ma grand-tante et celui de ma tante — Beatriz, la fille cadette de Salvador et Hortensia Allende qui se suicidera à Cuba où elle était en exil. C’est une transition entre la douleur et la récupération de la mémoire.»
Être la petite-fille de Salvador Allende n’a pas dû être facile. «J’ai grandi au Mexique et j’y ai passé une grande partie de ma vie. Là-bas, j’étais Marcia Tambutti. Je vivais une vie plutôt tranquille et je ne ressentais pas ce poids. Bien sûr, lorsque j’étais adolescente, on ne cessait de me dire: tu dois bien te comporter car tu es une Allende! Lorsque je suis allée vivre au Chili, j’ai ressenti très fort le fait que Salvador Allende appartenait à un grand nombre de gens. Lorsque j’ai voulu tourner mon film et que je n’avais pas encore une idée précise du scénario, personne ne m‘a demandé ce que je voulais faire, mais tout le monde me disait ce que je devais faire. Ma conclusion est que beaucoup de gens ont le sentiment que Salvador Allende leur appartient un peu et qu’ils savent donc ce qu’il est important de dire à son sujet. Cela dilue un peu la responsabilité d’être la petite-fille d’Allende, puisqu’Allende appartient à tous!» résume la jeune femme en souriant.
Le documentaire a libéré la parole. Il a aussi permis de s’approprier un autre Allende. «Je fais une métaphore d’un Allende en noir et blanc, comme une affiche. Le film offre plusieurs facettes de la complexité d’un être. Comme l’est la vie. Les jeunes qui ont vu le film ont eu l’impression de connaître une autre dimension d’Allende. Et le documentaire a une résonance particulière pour celles et ceux qui ont eu un passé douloureux. Et pas seulement pour eux d’ailleurs», estime Marcia Tambutti Allende. Tout comme les Allende, de nombreuses familles chiliennes parlaient peu de ce qui s’était passé avant et pendant le coup d’État de 1973. Ou après. «Plusieurs personnes m’ont remerciée de leur avoir donné la possibilité de retrouver des souvenirs, une mémoire. Et même de récupérer le dialogue au sein de la société chilienne», souligne la réalisatrice.
«DANS LES ANNÉES 1970 ET 1980, LES GENS VIVAIENT DE MANIÈRE TRÈS IDÉOLOGIQUE»
Une société chilienne toujours très fragmentée plus de quarante ans après ce funeste 11 septembre 1973. Le dialogue est-il dès lors possible entre les partisans d’Allende et ceux qui ont soutenu les responsables qui l’ont fait tomber? «La ligne entre les deux est tranchante, mais il est nécessaire de construire le dialogue, y compris entre nous, au sein d’une famille où l’on ne parlait pas de certaines choses. Nous avons vécu les conséquences de ce qui s’est passé et nous n’avons pas compris comment a fonctionné notre famille, ni quelle en était sa dynamique et pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Nous avons aussi besoin de récupérer cette mémoire affective et laisser libre cours aux émotions qui s’expriment enfin», affirme la petite-fille d’Allende, qui ne se prive pas de tacler lucidement au passage famille et compatriotes.
«Dans les années 1970 et 1980, les gens vivaient de manière très idéologique. Nombre de décisions qui avaient des répercussions familiales étaient prises sans se demander comment nous, les enfants, nous vivions cela. Pour nous, il ne s’agissait pas de faits énoncés dans un livre, mais de décisions qui nous affectaient directement. Nous avons dès lors besoin d’explorer tout cela afin de continuer d’avancer.»
Comment la famille Allende a-t-elle réagi lorsque Marcia a mis à nu le côté obscur, voire secret de Salvador Allende? «Elle était mal à l’aise. Par amour envers lui. Mais je reconnais qu’elle a fait preuve d’une grande générosité. Lorsque les membres de ma famille ont vu le film, ils se sont rendus compte des résistances qu’ils avaient opposées, qui étaient au fond une façon inconsciente de se protéger. Ensuite, ils ont beaucoup ri! Le jour où je leur ai montré le film, nous avons déjeuné tous ensemble et nous avons passé l’après-midi à parler de ce dont nous ne parlions pas avant. Cela nous a fait du bien. C’est un processus de transition. Car qui sait où commence et où termine le silence?» conclut la petite fille d’Allende.
Marcia Tambutti Allende présente «Allende, mi abuelo Allende» le 9 décembre à 19h30 aux Cinémas du Grütli à Genève. À voir également les 10, 13 et 14 décembre 2015.
À la recherche de Borges
29 novembre 2015 — Le réalisateur brésilien Cristiano Burlan tourne à Genève.
Le réalisateur brésilien Cristiano Burlan tourne à Genève un film sur l’écrivain argentin Jorge Luis Borges.
Publié le 29 novembre 2015
Par Luisa Ballin
Genève inspire le réalisateur brésilien Cristiano Burlan. Lors de sa deuxième participation au festival Filmar en América Latina, qui bat son plein jusqu’au 29 novembre à Genève, l’auteur de Fome (Faim), film en noir et blanc en compétition dans la boîte section Coups de Cœur*, a décidé de tourner une fiction en hommage à l’écrivain argentin Jorge Luis Borges, enterré au cimetière dit des Rois de la Cité de Calvin.
«L’année dernière, j’ai été invité à participer au festival Filmar en América Latina. J’en ai profité pour aller voir la tombe de Borges. À l’école, j’avais lu nombre de ses livres qui m’avaient enchanté. J’avais aussi été touché par son histoire. Cette année, lorsque la directrice de Filmar, Sara Cereghetti, m’a invité à présenter mon film Fome, je me suis dit que l’occasion était belle de tourner un film sur Borges à Genève. J’ai contacté le Consulat suisse à São Paulo qui a accepté de soutenir mon projet. Faire un film en six jours, c’est de la folie. Je tournais la journée, je présentais mon film le soir et je dialoguais avec le public et les autres cinéastes la nuit. Je suis épuisé, mais l’atmosphère que dégage Genève me porte», affirme Cristiano Burlan dans un entretien avec La Cité.
«À la recherche de Borges» évoque un scénario que Borges aurait écrit et qui n’a pas été filmé et relate l’histoire d’un réalisateur de cinéma qui est à Genève pour présenter un de ses films. Il y rencontre des personnes qui ont connu Borges comme le journaliste argentin Juan Gasparini, qui fut le dernier à interviewer l’auteur de L’Aleph avant sa mort. Mais au milieu des péripéties du tournage, le réalisateur vit une crise profonde. Il doute. Réussira-t-il à terminer son film?
Henrique Zanoni, complice et acteur fétiche de Cristiano Burlan, incarne le protagoniste d’«À la recherche de Borges». Les deux artistes ont fondé la maison de coproduction de cinéma et de théâtre Bela Films qui a produit vingt œuvres, dont celles de Cristiano Burlan avec Henrique Zanoni en tête d’affiche. «C’est un acteur très intéressant féru de cinéma expérimental. Je l’apprécie car je n’aime pas travailler avec des acteurs cartésiens et pragmatiques. Je préfère des êtres qui, comme moi, doutent, cherchent et créent. Lorsque j’étudiais le cinéma, j’avais des certitudes, j’intellectualisais les choses. J’étais très cérébral. À 40 ans, je commence à oublier les choses que j’ai apprises à l’école de cinéma et je fais plus confiance à mon instinct», déclare Cristiano Burlan.
Pourquoi Genève? «Parce qu’à Genève, je sens que je peux faire quelque chose de puissant. Cette ville m’inspire une réflexion profonde sur le monde et sur les choses de la vie. Je suis nostalgique à Genève, ville que je sens proche de moi. En deux séjours, j’y ai passé en tout dix jours. Cette ville fait partie de moi. Je ne sais pas pourquoi. C’est ainsi».
Cristiano Burlan espère présenter la première mondiale de «À la recherche de Borges» au Festival du cinéma suisse à Sao Paulo. Sa directrice Celia Gambini l’a d’ores et déjà invité à l’ouverture. «Et j’espère que le film sera également à l’affiche lors de la prochaine édition de FILMAR en América Latina à Genève, en 2016», conclut le réalisateur brésilien.
* Outre Forme de Cristiano Burlan, les autres films en compétition dans la boîte section Coups de Cœur du Festival FILMAR en América Latina sont: Carmín tropical, de Rigoberto Perezcano (Mexique); Eva no duerme, de Pablo Agüero » (Argentine-Espagne-France); La obra del siglo / L’œuvre du siècle, de Carlos Quintela (Cuba-Argentine-Suisse-Allemagne); La once, de Maite Alberdi (Chili); NN sin identidad, d’Héctor Gálvez (Pérou); Tiempo suspendido, de Natalia Bruschtein (Mexique-Argentine) et Tus padres volverán / Tes parents reviendront, de Pablo Martínez Passi (Uruguay). Le Prix du Public a été décerné, le 29 novembre 2015, à ce dernier film.
Éduquer à la citoyenneté: parallèles entre la Serbie et la Suisse
25 novembre 2015 — En juin dernier, j’ai été invitée par le Kulturni Centar Grad de Belgrade à participer à une résidence intitulée «Inspiration Belgrade». J’avais carte blanche pour m’immerger dans cette ville et en retirer de la matière pour ma démarche artistique, ce qui n’a pas manqué. Parmi cette matière, un nouvel éclairage s’est imposé sur mon champ d’intérêt: ce qui nous fait vivre ensemble et l’éducation à la citoyenneté.
© Lucie Schaeren / 2015
Publié le le 25 novembre 2015
Par Lucie Schaeren
En juin dernier, j’ai été invitée par le Kulturni Centar Grad de Belgrade à participer à une résidence intitulée «Inspiration Belgrade». J’avais carte blanche pour m’immerger dans cette ville et en retirer de la matière pour ma démarche artistique, ce qui n’a pas manqué. Parmi cette matière, un nouvel éclairage s’est imposé sur mon champ d’intérêt: ce qui nous fait vivre ensemble et l’éducation à la citoyenneté.
Invitée à rédiger un article pour une revue pédagogique, je commence par contextualiser ma réflexion dans le cadre du plan d’études romand. Mais la tentation est forte d’ancrer mon propos ailleurs. Je choisis donc de la situer dans l’«entre-deux» qui m’occupe.
L’«entre-deux» entre la Suisse et la Serbie, entre le cœur de l’Europe et sa périphérie, entre une approche scientifique et artistique; l’entre-deux dans lequel évolue la démocratie, heureusement difficile à figer dans une seule définition. Un «entre-deux» si riche et si inconfortable, tant il serait plus agréable de s’accrocher à des certitudes. «Quand on commence à poser des questions, on entre dans la complexité», me rappelle une enseignante en formation à mon retour.
Qu’est-ce que l’éducation à la citoyenneté? Où puise-t-elle ses racines? Pourquoi est-elle fondamentale? Quels sont les liens entre l’individu, le groupe et le politique? Comment les institutions influencent-elles les citoyens et inversement? Ce séjour à Belgrade m’a ouvert une nouvelle perspective sur le rapport de confiance entre citoyens et institutions que je vais développer ici.
Mon projet à Belgrade s’est articulé autour de la relation à l’autre, dans ses dimensions multiples, intimes et sociales, collectives et politiques. L’autre à l’intérieur de chacun, celui qui nous donne du fil à retordre; l’autre à l’extérieur, avec lequel on entre en relation. L’Autre, auquel on ajoute une majuscule, par peur, par respect ou par ignorance. L’autre politique, aussi, celui qui dans les Balkans a été construit dans la douleur, découpant un peuple en catégories, en nationalités, se répercutant ironiquement sur les paquets de céréales, lorsque le même texte, dans la même langue, est labellisé BIH (Bosnie et Herzégovine), HRV (Croatie), RS (République serbe) et MNE (Monténégro). Et si les lois qui régissaient notre relation à «notre» autre intime étaient similaires à celles qui régissent la relation d’un pays à un autre? Et si le politique commençait en nous? Et s’il n’était plus cette «chose si lointaine» qui ne nous concerne pas?
C’est une hypothèse qui peut tenir la route lorsqu’on considère le politique comme une chaîne infinie de tentatives de résolution de problèmes actuels ou à venir1. On serait donc tantôt seuls à essayer de les résoudre, tantôt en groupes, tantôt représentés par des autorités. On envisagerait alors une éducation à la citoyenneté qui partirait de la connaissance de soi, la reconnaissance de ses propres besoins et des responsabilités qui y sont liées, qui s’étendrait à la connaissance de l’autre, de ses droits et de ses devoirs et inclurait ensuite la connaissance des institutions, leurs droits, leurs devoirs et les nôtres à leur égard. Élargissons.
Lors d’une visite du Mémorial dédié à Tito à Belgrade, le père de la Yougoslavie socialiste, j’ai été surprise de constater le manque de mise en perspective des expositions et la nostalgie qui émane des mots de condoléances laissés depuis sa mort en 1980 dans le livre des hommages. Je n’avais pas, de mon point de vue helvétique, saisi l’histoire sous cet angle. Pourtant, plusieurs échanges avec des citoyens serbes ont changé la perspective que je m’étais construite et ont fait émerger un constat: si la nostalgie prend racine dans une Yougoslavie qui unissait une région au-delà des nationalismes qui ont provoqué les déchirements que l’on sait, elle s’alimente également d’un climat socio-économique catastrophique depuis les années 1990 et d’une difficile reconstruction.
QUE PENSE ET APPREND LA JEUNE GÉNÉRATION SERBE DE L’HISTOIRE DE SON PAYS?
Ainsi, le constat «c’était mieux avant» est une rambarde à laquelle il est facile de s’accrocher pour contrecarrer une confiance effritée et effritable dans les institutions du pays. Pour échapper à une incertitude quotidienne, en somme. Comment cette défiance envers les autorités se répercute-t-elle dans les enseignements? Que pense et qu’apprend la jeune génération serbe de l’histoire de son pays? Comment l’accompagner, en tant qu’enseignant, à développer une citoyenneté active, critique et responsable lorsqu’on doute soi-même de son environnement institutionnel et politique?
La notion de confiance, et celle d’engagement se trouvent au cœur de la citoyenneté. Un engagement vis-à-vis de soi, de l’autre et des institutions qui nous représentent. Cet engagement n’égale pas une approbation aveugle, mais plutôt un questionnement continu pour ne laisser rien ni personne tomber dans les certitudes figées, lorsque la vie s’arrête. Il va de soi que la guerre laisse des traces à l’intérieur des individus qui l’ont subie, qui marque ensuite leur relation l’autre, ainsi qu’à l’État. Inversement, il est également évident que l’attitude qu’un individu adopte envers lui-même détermine son rôle dans la société: l’engagement prend racine dans une relation engagée avec soi-même avant de s’étendre à la société.
En Serbie, certains citoyens semblent se désintéresser de la politique, car leurs efforts paraissent trop souvent vains, empêtrés dans un contexte de méfiance envers des autorités qu’ils estiment corrompues et poursuivant leur propre intérêt. En Suisse, les citoyens disposant du droit de vote peuvent mobiliser ce droit pour influer sur l’organisation du pays, moyennant une connaissance du fonctionnement des institutions. Cette participation, exigeante certes, est peu mobilisée par les citoyens.
Quel est le lien entre l’exercice de la citoyenneté et la confiance envers les institutions? Il réside notamment dans la participation politique accordée aux citoyens et dans l’impact de leurs actions sur leur environnement. Il est important de souligner, toutefois, l’éventail des manières d’exercer sa participation politique afin de développer un comportement citoyen, actif et responsable, incluant et allant au-delà de la mise en œuvre de ses droits politiques à proprement parler.
Lorsqu’un élève est invité à participer à l’organisation d’un événement au sein de son établissement et que son implication donne un résultat dont il est fier; lorsqu’il est invité à s’exprimer sur l’actualité et que son opinion est considérée; lorsqu’il peut exprimer ses valeurs et que celles-ci sont respectées; en somme, lorsque l’institution lui accorde de la confiance, alors celui-ci développe, pas à pas, un comportement citoyen qui influencera fondamentalement son positionnement dans la société, à la fois critique, actif et responsable, de sorte à retourner ensuite sa confiance à l’égard de son environnement sociopolitique.
L’élaboration d’un comportement citoyen se situe au cœur de l’éducation à la citoyenneté qui articule à la fois des savoirs, des compétences et des méthodes favorisant l’action. Ce comportement réunit des dimensions individuelles (Qui suis-je ? Quelles sont mes valeurs, mes émotions, mes besoins? Comment dois-je m’y prendre pour trouver un équilibre?), sociales (Qui est l’autre? Quelles sont ses valeurs? Comment vivre ensemble?), politiques (Comment fonctionne mon environnement socio-politique? Quelles sont ses valeurs? Comment puis-je y participer/l’influencer?)
Toutes ces questions invitent la complexité et l’incertitude mais aussi, inévitablement, la vie. En Serbie, comme dans beaucoup d’autres pays dont le système souffre de beaucoup de «dysfonctionnements» apparents, il y a une intensité de vie qui manque parfois en Suisse ou le système «fonctionne». Alors, s’il ne s’agit pas de souhaiter l’insécurité pour redonner un souffle aux personnes résidant en Suisse, il peut être souhaitable d’insuffler un peu d’incertitude dans les enseignements tout en développant, avec les élèves, les compétences qui permettent au mieux de l’aborder.
C’est dans cet échange critique, constructif et honnête entre les élèves et leur enseignant que se développe, de manière dynamique et non linéaire, l’exercice d’une citoyenneté, comme une éducation au politique. Et le politique est présent partout, dans tous les pays, à l’intérieur de chacun et dans chaque collectivité, lorsqu’on aborde de manière engagée les problèmes liés au quotidien.
Finissons sur une histoire de bus... À Belgrade, lors d’un trajet quotidien je me tiens à une patère de bus avec une autre femme. Lors d’un freinage un peu brusque, la patère, censée nous sécuriser, est «partie» avec nous, avec le mouvement. Pas de mal, mouvement assez fluide, tout est revenu en place facilement. Toutefois, dans le regard de ma co-passagère, j’ai aperçu une exaspération qui allait au-delà du bus et de ses fragilités... elle semblait faire référence à un pays, à ses failles, à quelque chose qui venait de loin.
De retour à Lausanne, je me retrouve dans un bus, par 35 degrés en fin de journée, chargée de bagages. Un passager m’interpelle pour me demander «de prendre moins de place», une autre s’insurge contre deux jeunes enfants assis: «Vous n’avez pas vu qu’il y a une vieille personne? Bravo! C’est ça la nouvelle éducation?!» Les bus cristallisent beaucoup de dimensions citoyennes. Mon regard doit être empreint à ce moment précis d’incrédulité vis-à-vis non pas uniquement de passagers singuliers, mais de la sensation que nous, Suisses, manquons de quelque chose... La patère tient, le bus est climatisé, on peut faire confiance, mais on cherche des problèmes ailleurs. Pour en avoir à résoudre justement, autour desquels on se sentirait citoyens, ensemble?
1 Karl Rohe, Politikbegriffe, in: Wolfgang Mickel (Hrsg.), Handlexikon zur Politikwissenschaft (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, numéro 237), Bonn 1986, p. 350.
Lucie Schaeren
Artiste et sociologue
Lausanne
«En Amérique latine, l’enfance se construit dans le déchirement»
27 octobre 2015
La directrice Sara Cereghetti (photo) met l’accent sur le thème de l’enfance, à l’honneur de la dix-septième édition du festival Filmar en América Latina, du 13 au 29 novembre.
La directrice du festival, Sara Cereghetti, vue par © Charlotte Julie / Octobre 2015
La directrice Sara Cereghetti met l’accent sur le thème de l’enfance, à l’honneur de la dix-septième édition du festival Filmar en América Latina, du 13 au 29 novembre.
Charlotte Julie
27 octobre 2015
Sergihno a à peine 15 ans, mais il est déjà l’homme de la maison. Il s’occupe de son petit frère malade, délaissé par sa mère alcoolique. Le film du Brésilien Chico Texeira, Ausencia, raconte les tribulations de ce courageux adolescent qui, fatalement, vit une troublante découverte de sa sexualité. Dans Dos Aguas, Nató, 11 ans, veut devenir joueur professionnel de football au Costa Rica, pour sortir sa famille de la pauvreté. Mais il découvre que son frère est impliqué dans une sombre histoire avec une bande de narcotrafiquants. Il décide de l’aider, à ses risques et périls. La réalisatrice Patricia Velásquez réussit ici une admirable œuvre sur la puberté comme moment d’éveil mais aussi de souffrance. Une métaphore purement latino-américaine.
Comme Sergihno et Nató, en Amérique latine, les enfants et les adolescents, souvent pris dans les filets de la déchéance sociale, multiplient les expériences d’abandon, de souffrance et de deuil. «Du nord au sud du continent, l’enfance se construit dans le déchirement», affirme Sara Cereghetti, directrice de Filmar en América Latina. Le festival consacre à cette thématique sa section Dédicace, «un espace de célébration, d’attention kaléidoscopique portée à un sujet», ajoute-t-elle. Dix films qui constituent autant d’actes de dénonciation sociale.
«PETITS HÉROS, GRAND CINÉMA»
Les «petits héros» du festival se nomment aussi Nieve, une petite fille cubaine de 8 ans, dans Todos se van, du Colombien Sergio Cabrera, Rocio, petit paysan de l’Altipliano guatémaltèque dans La casa más grande del mundo de Ana Bojórquez et Lucìa Carreras, ou El Gurì, orphelin argentin abandonné par sa mère, une jeune prostituée condamnée par une terrible maladie dans le film homonyme El Gurì, de Sergio Mazza. «Petits héros, mais grand cinéma», ajoute Sara Cereghetti dans sa présentation au Club suisse de la presse à Genève.
Les films présentés nous font explorer «l’univers de l’affectivité et la dimension familiale latino-américaine», analyse la directrice du festival. «Une dimension plus intense qu’en Europe.» Dans le passage à l’âge adulte, «les enfants et adolescents traversent peut-être plus souvent des moments de rupture», étaie-t-elle. «On peut même dire que la rupture est un élément constitutif de l’enfance en Amérique latine.»
À sa dix-septième édition, Filmar en América Latina «continue à proposer des films qu’on ne verrait pas en Suisse», déclare Jean-Pierre Gontard, président de l’association des Trois Mondes, à l’origine du festival. «Avant Filmar, on découvrait les merveilles du cinéma latino-américain à Cuba ou en Argentine, en faisant en tout cas le déplacement de l’autre côté de l’Atlantique.»
Avec 99 films, dont huit œuvres en compétition, le festival représente la plus grande manifestation cinématographique de Suisse dédiée à l’Amérique latine. Pour l’édition 2015, il se métamorphose en abolissant la distinction entre documentaire et fiction, déclare Jean-Pierre Gontard, mais aussi en remaniant l’offre des lieux de projection, à Genève, Lausanne, Pully, Martigny, entre autres, ainsi qu’en France voisine*. Une nouvelle formule, déclinée en «neuf boîtes conceptuelles», conçue «pour amplifier le dialogue avec le public».
Programme et liste complète des salles de projection* : www.filmar.ch
(lien à utiliser aussi pour Filmarcito, le festival des petits, du 14 octobre au 2 décembre)
À peine dévoilé, le Pôle muséal de Lausanne étale ses défis à venir
6 octobre 2015
Le projet des architectes portugais Manuel et Francisco Aires Mateus remporte le concours international pour compléter le futur quartier des musées à proximité de la gare. Devisé à 183 millions, il pourrait sortir de terre à l’horizon 2020.
Le projet des architectes portugais Manuel et Francisco Aires Mateus remporte le concours international pour compléter le futur quartier des musées à proximité de la gare. Devisé à 183 millions, il pourrait sortir de terre à l’horizon 2020.
Lucy Isler
6 octobre 2015
Primé à l’unanimité du jury pour sa «force, cohérence et luminosité», le projet d’architecture des frères Aires Mateus réunira deux musées sous un seul toit: le Musée cantonal de la photographie (musée de l’Élysée) et le Musée de design et d’arts appliqués contemporains (Mudac). Le premier en sous-sol et le second au premier étage. L’ensemble «s’intégrera et respectera parfaitement le site», a souligné le conseiller d’État Pascal Broulis à la proclamation du résultat, lundi 5 octobre 2015, au Palais de Beaulieu à Lausanne.
Un musée, deux musées,... trois musées au total! Avec le projet retenu des architectes espagnols Barozzi et Veiga pour le Musée cantonal des beaux-arts (mcb-a), devisé à 83 millions, le plan d’aménagement du site est désormais entièrement dévoilé. «Sa particularité sera la mise en synergie de trois disciplines — la photographie, les arts plastiques et le design — sur un seul site pour la création d’un quartier des arts unique», souligne Chantal Prod’hom, présidente du conseil de direction du Pôle muséal et directrice du Mudac.
Reste encore à trouver les fonds pour cette deuxième phase. Estimée à 100 millions de francs, la construction prévoit d’être financée à hauteur de 40 millions par l’État de Vaud, 20 millions par la Ville de Lausanne et, enfin, 40 millions par des dons privés, calcule Pascal Broulis, conseiller d’État chargé du département des finances. Le projet doit d’abord être décliné dans ses étapes de réalisation avant qu’une enveloppe ne soit demandée au Parlement vaudois. Olivier Steimer, président de la fondation de soutien au Pôle muséal et président du jury, se dit «confiant» quant à la participation de mécènes privés et institutionnels, mais «aussi de grandes entreprises». À l’arrivée, le Pôle muséal coûtera dans son ensemble 183 millions.
«La construction de la deuxième phase suivra celle du Musée cantonal des beaux-arts», a précisé Anne-Catherine Lyon. À savoir, entre 2017 et 2020. La conseillère d’État s’est réjouie de voir sortir de terre lesdeux édifices qui, de fait, doubleront la surface actuelle des trois musées concernés. Une opportunité unique pour la «conservation et la mise en valeur de leur patrimoine culturel», a-t-elle affirmé. La réunion d’œuvres d’art sur un seul site pourrait, selon elle, attirer jusqu’à 250 000 visiteurs par année. Soit un peu plus du double qu’aujourd’hui pour les trois musées réunis.
Après le 29 juin 2010, date à laquelle le Grand Conseil vaudois a accordé 13,8 millions de francs pour les projets de réhabilitation, le Pôle muséal s’est attiré de nombreuses oppositions. En octobre 2012, dix-huit dossiers sont déposés contre le projet d’affectation du Musée cantonal des beaux-arts. 14 d’entre eux émanaient de particuliers, 4 d’associations. Juin 2014, ce sont 186 oppositions qui font obstacle à la mise à l’enquête du bâtiment, dont une opposition collective de 145 signatures. En mai 2015, les riverains opposés aux projets finissent perdants au Tribunal cantonal. Ils saisissent alors le Tribunal fédéral en juin, tout en voyant les CFF entamer le chantier — un mois avant la date officielle du début des travaux.
Aujourd’hui, la réalisation de cette première étape reste bloquée à la décision des juges de Mon-Repos. Quant à la deuxième, des oppositions au permis de construire restent possibles. Ce qui pourrait retarder le projet de «18 à 24 mois», a commenté le syndic de Lausanne, Daniel Brélaz. Les ambitions du Canton et de la Ville sont grandes. Ex-quartier industriel, la reconfiguration complète de la parcelle de 22 000 m2 derrière la gare (image ci-après) promet de devenir un «espace culturel unique en Suisse».
Les statues de Snowden, Assange et Manning se dressent devant l’ONU à Genève
La place des Nations héberge, du 14 au 18 septembre, un monument au courage d’Edward Snowden, Julian Assange et Bradley Manning, réalisé par l’artiste italien Davide Dormino.
La place des Nations héberge, du 14 au 18 septembre, un monument au courage d’Edward Snowden, Julian Assange et Bradley Manning, réalisée par l’artiste italien Davide Dormino.
Mis en ligne le 14 septembre à 17h04
[dropcap]L[/dropcap]es figures en bronze d’Edward Snowden, Julian Assange et Bradley Manning, debout sur des chaises, trônent sur la place des Nations. Après Berlin et Dresde, avant Paris (du 23 au 29 septembre), l’œuvre itinérante du sculpteur italien Davide Dormino — intitulée Anything to say? (quelque chose à dire) — est exposée sur la place des Nations à Genève jusqu’à vendredi 18 septembre.
«C’est un monument au courage de trois personnes qui ont dit non à la mise en place d’une surveillance globale et aux mensonges et qui ont choisi de dire la vérité», explique l’artiste. L’œuvre est un hommage à la liberté d’expression et d’information, hors de toute polémique politique.
[vsw id="141159693" source="vimeo" width="1024" height="450" autoplay="no"]
[su_video url="http://lacite.website/main/wp-content/uploads/2015/10/2015_09_14_.mov" poster="http://lacite.website/main/wp-content/uploads/2015/09/AU5A4888_L.jpg" width="1020" height="400"]
Une quatrième chaise a été volontairement laissée vide pour que chacun puisse s’exprimer aux côtés de Julian Assange (cofondateur du site WikiLeaks, confiné dans l’ambassade d’Équateur à Londres), d’Edward Snowden (informaticien américain réfugié en Russie) et de Bradley Manning (soldat condamné aux États-Unis à 35 ans de prison pour avoir livré des secrets d’État). Snowden, Assange et Manning, «traîtres» ou héros de notre temps? C’est au public de répondre en montant sur la quatrième chaise.
L’exposition en Suisse de cette œuvre tombe au moment où la loi Pour une meilleure protection des lanceurs d’alerte est discutée dans la commission compétente du Parlement fédéral, en vue de son examen aux Chambres. Le comité de soutien suisse¹ à Anything to say? milite aussi pour qu’Edward Snowden puisse obtenir l’asile politique en Suisse. Les concepteurs du projet souhaitent pour leur part que l’oeuvre demeure définitivement à Genève, après avoir fait le tour du monde.
- Le comité de soutien pour la manifestation de Genève est composé de l’ONG Presse Emblème Campagne (PEC), du Centre international pour la paix et les droits de l’homme (CIPADH), de Pilar Ackermann, Fabio Lo Verso, Charly Pache et du représentant d’un groupe de citoyens qui ont contribué à la réalisation du projet, Marco Benagli.
À Genève, l’officine bülbooks renouvelle l’art du «romantisme éditorial»
Créateur de B.ü.L.b comix, Nicolas Robel lance une nouvelle maison d’édition, bülbooks, en gardant intacte sa passion créatrice: «Je publie des livres sur un coup de foudre, et j’ai pour principe de ne pas privilégier la rentabilité aux dépens de la qualité d’un projet.» Rencontre avec un irréductible idéaliste.
Créateur de B.ü.L.b comix, Nicolas Robel lance une nouvelle maison d’édition, bülbooks, en gardant intacte sa passion créatrice: «Je publie des livres sur un coup de foudre, et j’ai pour principe de ne pas privilégier la rentabilité aux dépens de la qualité d’un projet.» Rencontre avec un irréductible idéaliste. [dropcap]L[/dropcap]’édition est parfois un monde de brutes. Mais le plus souvent, ce sont des anges qui le peuplent. Éperdument amoureux de leur métier, ils le pratiquent sans se laisser guider par le profit, uniquement par le plaisir de créer et de procurer de la joie. Nicolas Robel fait résolument partie de ces créateurs désintéressés. Il a fondé B.ü.L.b comix, en 1996 à Genève, avec cette vaillante maxime: «Je publie des livres sur un coup de cœur et j’ai pour principe de ne pas faire de profits.»
Dix-huit ans plus tard, il lance bülbooks, une nouvelle aventure éditoriale aussi ludique, décalée, ironique et jouissive que la précédente. En automne 2014, la dernière création de B.ü.L.b comix portait la lettre Z, signe que la série touchait à son terme. Fin naturelle d’un cycle qui va cruellement manquer aux fans de ces «bandes dessinées ütopiques à lire dans son bain», appellation loufoque, diffusée sous l’acronyme B.ü.L.b., qui a accouché de 75 ouvrages et publié 125 auteurs.
La maison bülbooks change de registre, mais reste tout aussi espièglement créative: elle publie... des «guides détournés». Le premier-né de la collection, paru en septembre 2014, est un petit bijou; son titre à rallonge, une irrésistible invitation:
Un guide sur la pratique du FuittFuitt, manuel détourné de danse ultra fluide, développé par les danseurs Laurence Yadi et Nicolas Cantillon | Compagnie 7273, en pas de trois avec l’éditeur.
On ne se laisse pas prier pour glisser dans ses 72 pages virevoltantes qui cachent, derrière les déhanchements souplissimes des danseurs, «une protestation muette en mouvement pour libérer les esprits et les frontières culturelles et politiques», explique Nicolas Robel. «Regardez, par exemple, les pages 18 et 19, où les deux danseurs illustrés sous forme de géants monochromes se jouent des frontières devant les gardes-frontières de Ramallah et comptent bien danser coûte que coûte dans un contexte politique tendu.»
Sur la couverture du livre, une citation de Bruce Lee en lettres rouges: «Il n’y a pas un style mais plein de styles dans ma façon d’aborder le Kung-Fu!» D’où sort-elle? «C’est une référence, proposée par les auteurs, au décroisement des styles voulu dans la danse FuittFuitt comme a tenté de le faire Bruce Lee avec les arts martiaux. Cela nous semblait bien plus pertinent de citer un maître des arts martiaux qu’un danseur étoile du Bolchoï», ajoute-t-il.
[su_pullquote align="right"]Une officine de petits bijoux éditoriaux savoureusement décalés[/su_pullquote]L’officine bülbooks concocte d’autres petits bijoux éditoriaux savoureusement décalés. à commencer par un manuel détourné du tennis de table qui cache un guide sur le graphisme. «La table de ping-pong, les trajectoires des balles, autant de formes et de lignes dessinant un univers graphique», se réjouit son concepteur, qui songe aussi à réaliser un guide détourné de promenade en forêt, cachant une introduction à l’art contemporain… Et un guide de survie en milieu éditorial, dont on ne dira pas plus. Un, deux, trois, bülb, bülb, bülbooks!
Mais il faudra être patient avant de voir tenir ces trois belles promesses. Dans l’officine bülbooks, rien ne presse. Nicolas Robel évalue entre douze et dix-huit mois le temps de production pour un livre «abouti, accompli, réussi, dont on ne regrette rien, même pas une ligne». Rendez-vous est donc pris en 2016. Ou peut-être plus tard. Le public de bülbooks est au diapason avec ce «romantisme éditorial»: créer par passion, sans but lucratif, sans être pressés, séduire les lecteurs avec humour, élégance, brio et ironie.
«Nous prenons le temps de bien faire les choses, nous ne sommes pas soumis à l’exigence de sortir un nouveau livre pour avoir des subventions ou une bonne place dans les librairies au rayon des nouveautés», assène le fondateur de bülbooks. «Nous sommes en librairie, si le libraire se montre motivé dans notre démarche culturelle et accepte les conditions proposées, à savoir vente-ferme 40% sans retour, trois exemplaires minimum pour constituer une commande. Cela en refroidit quelques-uns et, du coup, cela fait office de tri. Exit le diffuseur, nous ciblons les lecteurs via notre site web¹.»
[su_carousel source="media: 13294,13291" width="1600" height="600" items="2"]
Graphiste, Nicolas Robel gagne sa vie grâce à des mandats privés et publics. Il gère bülbooks avec un modèle archiplein de bon sens, celui-là même qui avait assuré la pérennité de B.ü.L.b comix: «Je publie un livre seulement si je dispose de l’argent pour le faire. Il est exclu de s’endetter, de demander un prêt, ou de réclamer une subvention.» Si le titre s’écoule bien, l’éditeur rentre dans ses frais... Sinon, peu importe: «Pas question de ne pas suivre un coup de cœur pour une banale question financière.» La production est rigoureusement artisanale, «les auteurs sont payés en livres, tout se fait sur la confiance».
Pas question non plus d’être angoissé par des échéances commerciales: «Il a fallu cinq ans pour vendre les 1100 exemplaires imprimés de l’un de nos titres», rappelle Mathieu Christe, co-éditeur de B.ü.L.b comix depuis 2002. C’est au sublime Move to the City, de l’auteur britannique Tom Gauld, que l’associé de Nicolas Robel fait allusion.
Une bande-dessinée mélancolique et lunaire, touchant récit d’une aventure humaine animée par la finesse de l’humour anglais. Ce chef-d’œuvre a été publié en plusieurs épisodes dans le Guardian puis dans Le Courrier. Malgré le succès, aucune réédition n’a été réalisée. «Un livre n’a qu’une seule vie au sein de B.ü.L.b comix...», enchaîne Nicolas Robel. «Cela m’amuse de me donner des règles», ironise-t-il.
[su_pullquote align="right"]«L’indépendance financière découle de l’indépendance intellectuelle.»[/su_pullquote]En réalité, cet éditeur hors catégorie reste farouchement attaché à sa devise: «L’indépendance financière découle de l’indépendance intellectuelle.» Le concept bülbooks est l’expression d’une autonomie radicale, imperméable à toute infiltration de la logique commerciale, qui «continue d’avancer très sournoisement», s’inquiète Nicolas Robel.
Le Genevois a été de tous les combats en faveur d’une édition résolument indépendante. Il s’était associé au Comptoir des indépendants puis dissocié des Belles Lettres, qui en avait repris les rênes. Après une longue agonie, le Comptoir a succombé en janvier 2011. Et ce climat de désolation se poursuit avec les difficultés que traversent les éditeurs Atrabile et Drozophile, avec lesquels B.ü.L.b comix avait formé le Trois Pattes, association de diffusion dissoute en 2002.
Pour comprendre les raisons de la désillusion qui ronge les éditeurs indépendants, Nicolas Robel indique un ouvrage de référence: La trahison des éditeurs, de Thierry Discepolo, publié en 2011 aux Éditions Agone. «Une antilégende de l’édition démontant les mécanismes qui transforment les lecteurs en consommateurs, les librairies en boutiques, les éditeurs en vendeurs de poisson.» Par son analyse lucide des mirages économiques qui ont aveuglé l’édition, le livre de Discepolo sert de boussole «pour ne pas égarer les coordonnées de l’indépendance intellectuelle».
Et pour «garder intacte la passion créatrice», rien de tel qu’une rencontre stimulante: «Les danseurs Laurence Yadi et Nicolas Cantillon sont venus à l’atelier car ils voulaient faire un livre, nous étions en train de préparer le dernier ouvrage chez B.ü.L.b comix, la 2w Box set Z, et le projet bülbooks était encore à l’état embryonnaire. Cette rencontre a accéléré les choses. Je me suis dit: pourquoi pas commencer par un guide de danse? Je n’ai pas vraiment eu le temps de me rendre compte de ce qui se passait. Le songe B.ü.L.b comix touchait à sa fin et je me devais de repartir contre mes moulins, mais sans Don Quichotte ou sans Pancho, c’est selon.» Olé!
Les photos sont de © Nicolas Robel / 2014.
[su_service title=" Article paru dans l’édition de Juin 2015." icon="icon: sign-out" size="30"][/su_service]
Le peintre K. Vasili a rejoint l’Idée
Samedi matin, 4 avril 2015, à l’Hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine, un peintre majeur a quitté le monde de la matière pour rejoindre celui de l’Idée, qu’il n’a cessé de chercher tout au long de son œuvre. K. Vasili était aimé, apprécié, admiré par tous ceux qui servent l’art et refusent de s’en servir.
[dropcap]S[/dropcap]amedi matin, 4 avril 2015, à l’Hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine, un peintre majeur a quitté le monde de la matière pour rejoindre celui de l’Idée, qu’il n’a cessé de chercher tout au long de son œuvre. K. Vasili était aimé, apprécié, admiré par tous ceux qui servent l’art et refusent de s’en servir. C’est dire si la société médiamercantile – qui exerce actuellement ses ravages – l’a ignoré… Un signe de haute qualité qui ne trompe pas. La société médiamercantile a un mauvais goût très sûr. Vasili est né en 1942 à Lakotama en Grèce; son enfance a été marquée par la guerre civile qui, dès la fin du second conflit mondial, a opposé les communistes grecs aux nationalistes. Avec son frère aîné, Vasili avait trouvé refuge en Yougoslavie où il a accompli toute sa formation scolaire et artistique, notamment aux écoles des beaux-arts de Pec, Skopje et Belgrade. Dès 1964, il s’installe à Paris avant d’être naturalisé français. Rien n’était plus étranger à K. Vasili que le bruit.
En ascète de la peinture, il le tenait à l’écart, préférant l’ombre qui protège la vraie lumière aux projecteurs qui n’éclairent rien mais aveuglent la foule. D’ailleurs, même son patronyme est source d’interrogation, tantôt écrit à la grecque, tantôt rédigé à la serbe. Comme si l’important n’était pas dans une identité bureaucratique et forcément vague. Or, K. Vasili – c’est ainsi qu’il signait ses tableaux – n’aimait pas le vague, le flou, l’à-peu-près près trompeur.
C’est la vérité qu’il cherchait à atteindre. Ou plutôt l’idée de vérité. Parti de la représentation figurative d’un monde bouleversé et souvent conflictuel, l’artiste a épuré son geste et pris progressivement le parti de l’abstraction afin de tendre vers l’essentiel, l’essence-ciel où vibre le monde des Idées platoniciennes. Cette ligne qui figure dans nombre de ses tableaux est un chemin vers la lumière. Mais il en va ainsi de tous les chemins de crêtes, il faut dominer son vertige pour tendre vers le but.
S’il fallait lui coller une étiquette – un acte toujours douteux – celle de peintre platonicien serait la moins fâcheuse. Cette phrase tirée du Phèdre de Platon illustre parfaitement sa démarche artistique:
Une intelligence d’homme doit s’exercer, selon ce qu’on appelle «Idée», en allant d’une multiplicité de sensations vers une unité, dont l’assemblage est acte de réflexion.
Parti du multiple, l’artiste est parvenu à l’Un. Dans ce monde qui turbule à la folie, l’œuvre de K. Vasili n’est pas seulement nécessaire, elle est devenue vitale.
[su_service title="La Cité a consacré un hommage à K. Vasili dans son édition de mai." icon="icon: arrow-circle-right" size="30"][/su_service]
Ventes d’art mondiales: plongée dans un marché en plein boom
En 2014, 51 milliards d’euros se sont échangés en œuvres d’art dans le monde, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Dopé par la multiplication des musées et des intermédiaires, le marché accentue son profil spéculatif.
En 2014, 51 milliards d’euros se sont échangés en œuvres d’art dans le monde, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Dopé par la multiplication des musées et des intermédiaires, le marché accentue son profil spéculatif.
Mis en ligne le 1 avril 2015 à 21h45
[dropcap]L[/dropcap]a progression est de 300% en une décennie. Depuis 2004, le marché de l’art affole tous les indicateurs. Cette ascension est liée au segment de l’art contemporain, qui affiche une croissance vertigineuse de plus de 1000% sur dix ans. Le rapport d’Artprice sur les ventes d’art contemporain réalisées entre juillet 2013 et juillet 2014 enregistre un chiffre d’affaires de 15,2 milliards de dollars, contre 12,5 milliards en 2013, soit un bond de près de 30%. Un sommet inégalé sur ce segment, marqué par un fort nombre de ventes supérieures à un million. Tombées en automne 2014, les statistiques d’Artprice concernent uniquement les ventes Fine Art (1).
Mi-mars, le TEFAF Art Market Report, le plus complet existant à ce jour (2.), fait état d’un pourcentage global de croissance bien moins marqué que les 12% enregistrés par Artprice, au niveau global mais sur une année différemment considérée. De janvier à décembre 2014, quelque 51 milliards d’euros se sont échangés en œuvres d’art, soit 7% de plus qu’en 2013. C’est tout de même le niveau le plus élevé jamais enregistré. Avec 48% des recettes, l’art contemporain se taille la part du lion, l’art moderne représentant 28%.
Le marché est dopé par la multiplication des musées dans le monde, analyse Thierry Ehrmann, fondateur et président d’Artprice. «Il s’est créé plus de musées entre 2000 et 2005 que durant tout le XIXe et le XXe siècle et il s’ouvre dans la Grande Asie un musée par jour», lit-on dans son rapport. «Et un musée a besoin d’un minimum de 3000 à 4000 œuvres de qualité pour être crédible.»
VOCATION PREMIÈRE
Spécialiste du marché de l’art contemporain, Hayat Jmammou, directrice de la galerie genevoise Hayat Fine Arts Selection, considère pour sa part que «ce boom est aussi en grande partie lié à la spéculation réalisée par des acteurs puissants, qu’ils soient marchands d’art, collectionneurs, puissantes institutions ou les artistes eux-mêmes». Elle cite l’exemple du marchand d’art Larry Gagosian: «Il joue avec le système, il spécule, il exerce un marketing agressif et augmente ainsi la valeur de ses artistes.» Parmi ses «protégés», on dénombre Damien Hirst ou un certain Jeff Koons, le créateur du Balloon Dog, sculpture de trois mètres sur quatre adjugée par Christie’s pour 58,4 millions de dollars en novembre 2013. C’est le coup de marteau le plus fort qui a retenti à ce jour pour une œuvre d’art contemporaine.
«Nous sommes aux antipodes de la manière et du style d’un Paul Durand-Ruel, qui a vécu un siècle avant Larry Gagosian. Lui s’endettait pour acquérir les toiles des artistes qu’il affectionnait, comme Renoir ou Monnet», assène Hayat Jmammou. «L’art a été détourné de sa vocation première», déplore Frédéric Elkaïm, expert en marché de l’art contemporain, actif entre Genève et Paris. «De vecteur de valeurs culturelles et esthétiques, il est devenu un véhicule de placement financier.» Un changement de paradigme intervenu sous l’impulsion des nouvelles générations d’acheteurs:
[su_quote cite="Hayat Jmammou"]Aujourd’hui, nous comptons 450 millions de consommateurs d’art dans le monde, alors que, dans les années 1945, nous en comptions 500 000. Parmi ces consommateurs, beaucoup de jeunes trentenaires s’offrant le luxe d’une belle œuvre d’art au-dessus d’un meuble au nom suédois imprononçable qu’ils ont dû monter eux-mêmes.[/su_quote]
«Pour nombre d’acheteurs et de collectionneurs, l’art est une façon de acquérir un statut social. Parfois, cela va très loin. Certains n’hésitent pas à définir François Pinault comme le Lorenzo de Medici du XXIe siècle... Ce n’est pas mon point de vue, mais il est de plus en plus courant de l’entendre dans le milieu», ajoute Frédéric Elkaïm.
DOMINATION DES VENTES PRIVÉES
«À noter que Pablo Picasso reste l’artiste avec les transactions les plus importantes en 2014 avec 345,8 millions de dollars. Mais Andy Warhol le talonne avec 299,2 millions. Jusqu’à quand Picasso tiendra-t-il le flambeau?» se demande Hayat Jmammou. Aux yeux de l’amateur d’art, il serait impensable qu’un Wahrol puisse détrôner un Picasso. Ainsi va le marché de l’art, où les intermédiaires font la pluie et le beau temps. «Ce sont eux qui régulent le marché, analyse Hayat Jmammou. Contournant les enchères publiques, où ils sont évalués avec les critères du marché, les prix peuvent flamber.» Le rapport TEFAF confirme en 2014 la domination des ventes privées — réalisées par l’intermédiaire d’une galerie, d’un marchand d’art, ou même à travers les services «ventes privées» d’une maison de ventes aux enchères — sur les ventes publiques.
«On achète aussi beaucoup dans les foires, ajoute Hayat Jmammou, les volumes les plus importants se faisant dans les couloirs des vingt-deux plus grands salons internationaux sur les 180 grandes foires d’art comportant un élément international, couvrant fine et art décoratif, recensées en 2014.» Avec 9,8 milliards d’euros, les ventes réalisées dans les foires d’art représentent le deuxième canal de vente en importance après les transactions en galerie. Mais on achète également sur internet. L’an dernier, selon le rapport TEFAF, il s’est vendu en ligne pour 3,3 milliards d’euros en œuvres d’art, soit environ 6% des ventes globales.
Les géants des enchères d’art, Christie’s et Sotheby’s, ne semblent en rien perturbés par la montée en puissance des intermédiaires et des «ventes privées». Début mars, Sotheby’s annonçait un nouveau record historique de ventes en 2014, à 6,1 milliards de dollars, en hausse de 19% sur 2013. L’entreprise américaine occupe le deuxième rang mondial derrière la maison britannique Christie’s. Fin janvier, le numéro un mondial affichait une année 2014 historique, avec des ventes pour un montant de 8,4 milliards de dollars en 2014, en hausse de 12% sur un an.
Le marché de l’art en 2014 était composé de quelque 309 000 entreprises dans le monde entier, pour la plupart des petites entreprises, employant environ 2,8 millions de personnes, lit-on dans les pages du rapport TEFAF. Les États-Unis se font la part belle, avec 39% des transactions mondiales. C’est ensuite en Chine et au Royaume-Uni que les ventes ont été les meilleures, les deux pays arrivant deuxième ex-aequo avec chacun 22% de parts de marché. Face à la fulgurante progression de la Chine dans les statistiques mondiales, les géants anglo-saxons, États-Unis et Royaume-Uni, détiennent (encore) 61 à 62% des parts de marché. «En perte de vitesse, la France arrive en quatrième position, alors qu’elle détenait plus de 50% du marché de l’art dans les années 1960», ajoute Hayat Jmammou.
Le marché de l’art serait-il devenu une gigantesque bulle spéculative? Selon le président d’Artprice, Thierry Ehrmann, «le nombre d’œuvres vendues dans le monde reste relativement stable par rapport à 2013: 505 000 adjudications. Ce qui démontre l’absence de spéculation». Pour Frédéric Elkaïm, «le marché tient le choc car les fortunes des principaux investisseurs sont solides et le taux de transactions qui pourraient paraître spéculatives reste encore bas».
ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MARCHÉS
Cet expert du marché de l’art se souvient des chutes à répétition dans les années 1990, «du fait d’un vrai contexte spéculatif». Un phénomène qui a touché de plein fouet les années 2009-2010, «avec un effondrement sensationnel de 48% de la valeur du marché», rappelle Hayat Jmammou. La galeriste genevoise observe l’émergence de nouveaux segments de marché qui diversifient l’offre, satisfont la demande et atténuent le risque spéculatif. Le 24 mars dernier, le Salon du dessin ouvrait ses portes à Paris, avec des œuvres sur papier de Tiepolo, d’Ingres et de Gauguin. «Les dessins sont la colonne vertébrale de toute œuvre d’art, analyse Hayat Jmammou. Ils ont l’avantage d’avoir une valeur artistique et d’être exposés à des prix abordables dans des salons pointus.» Où on y sent moins fort l’argent que dans les foires d’art traditionnelles.
[su_service title=" Article paru dans l'édition d'avril." icon="icon: sign-out" size="30"][/su_service]
1. Les ventes Fine Art, c’est-à-dire les peintures, sculptures, volumes-installations, dessins, photographies, estampes, aquarelles, à l’exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier.
2. Le TEFAF est le seul à couvrir aussi bien les ventes d’antiquités que d’œuvres d’art de toutes époques confondues à travers le monde.
Avec de Rougement, voyage en zig-zag dans une crise pas si ancienne que cela
Le Journal d’un intellectuel en chômage tenu par le grand penseur suisse Denis de Rougemont évoque la période qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Un ouvrage à lire et relire pour prendre conscience que la déprime actuelle n’est qu’un cycle parmi d’autres, à inscrire dans une vision historique à long terme.
Le Journal d’un intellectuel en chômage tenu par le grand penseur suisse Denis de Rougemont évoque la période qui précède la Deuxième Guerre mondiale. La catastrophe économique de 1929 fait encore ressentir ses effets. Les faillites se succèdent. Les haines se lèvent. Privé de travail à Paris, l’écrivain et sa femme tentent de s’implanter en province pour retourner à Paris temporairement. Durant ce voyage en zigzag, ils rencontrent une «apathie générale» qui sonne comme un écho à l’ambiance régnant sur cette France d’aujourd’hui, de mauvais poils et de traits tirés, celle qui souffre des effets de la mondialisation avec une acuité plus vive qu’ailleurs. À lire et relire cet ouvrage, pour prendre conscience que la déprime actuelle n’est qu’un cycle parmi d’autres, à inscrire dans une vision historique à long terme. Catherine Willi retrace les grandes étapes de ce Journal. [dropcap]R[/dropcap]éédité en 2012 par les Éditions la Baconnière, le Journal d’un intellectuel en chômage a paru la première fois en 1937 chez Albin Michel. Ce Journal, qui se veut non-intime, enthousiasme à l’époque la quasi unanimité de la critique, dépassant largement les frontières des pays francophones. Ramuz et Mauriac, pour ne citer qu’eux, prennent la plume. Denis de Rougemont dit avoir rédigé ce Journal à temps perdu. Parallèlement, il travaillait à la rédaction de l’ouvrage Penser avec les mains.
Pourquoi ce Journal a-t-il remporté un tel succès? L’écriture, qui n’a pas laissé Ramuz insensible, y est d’une grande clarté. Les descriptions de la nature se transforment en évocations poétiques. Quant au contenu d’une grande richesse, qu’il s’agisse de réflexions sur la condition de chômeur, de pensées sur des lectures personnelles, d’observations sur le travail, le comportement et la mentalité des gens, il permet au lecteur d’établir des liens avec sa propre vie. Mauriac parle du sentiment qui a inspiré ce livre et qu’il ressent. Le Journal d’un intellectuel en chômage tient en 267 pages; il a été rédigé de 1933 à 1935 et il se compose d’un préambule suivi de trois parties.
1. N’HABITEZ PAS LES VILLES (NOVEMBRE 1933 – JUILLET 1934)
Nous sommes en septembre 1933. De Rougemont perd son emploi à la direction littéraire des Éditions «Je sers», suite à une mise en faillite de l’entreprise. Il vit à Paris depuis le début des années 1930. Il est reconnu dans les milieux intellectuels et littéraires pour avoir signé de nombreux articles dans différentes revues. Toutefois, il n’a pas encore publié de livre en France et n’a pas d’entrée dans la grande presse.
Il décide alors de se rendre avec sa jeune épouse sur l’île de Ré pour y passer l’hiver. Au sixième jour de son séjour, de Rougemont baigne dans le bonheur de la nouveauté et de la découverte et il écrit: «De l’île, du village, de la mer, je ne veux rien dire encore: je laisse tout cela se mêler à ma vie, dans l’heureux étourdissement de la lumière maritime.» (p. 13) Sa situation financière ne le préoccupe pas encore; d’après ses calculs, il peut vivre pendant six semaines. Il énonce alors trois aspects de sa vie qu’il va vérifier et noter jour après jour. Il s’agit premièrement du problème matériel: peut-on séjourner loin d’une ville, sans gain assuré, en vivant d’articles et de traductions? Deuxièmement, il étudiera le problème psychologique: ce choix de vie favorise- t-il l’acte d’écrire et rend-il heureux? Finalement, il se penchera sur la troisième question: le problème social, à savoir le rapport avec les indigènes.
Le 13 décembre, il reste 2 francs 50 au couple de Rougemont. Un ami, auquel l’écrivain avait auparavant prêté de l’argent, lui envoie à ce jour et par courrier 100 francs. Dix jours plus tard, de Rougemont décrit comme un échec son choix de l’indépendance financière: il accepte l’invitation de trois semaines de la part d’un ami. De janvier à mi-juin, il vit dans l’économie la plus stricte d’un travail payé d’avance.
Le 14 juin, il reçoit par courrier le chèque d’un prix récompensant un petit ouvrage écrit il y a dix-huit mois et qui lui permettra «de passer l’été ici sans inquiétude. Ou encore de le passer ailleurs sans ennui». (p. 132) Le lendemain, par lettre toujours, une amie lui propose une maison dans le Gard. Le couple fixe le départ définitif de l’île au 10 juillet 1934.
De Rougemont ne semble pas souffrir de l’instabilité due à l’incertitude financière. Tout au plus, note-t-il: «C’est lassant, le manque d’argent, à la longue.» (p. 128) Il se demande d’où lui vient le calme qu’il ressent dans cette situation matériellement difficile et il nous donne la réponse suivante, sous forme d’interrogation: «Et si je n’avais pas une croyance secrète et puissante en l’ordre significatif du monde (quoi qu’il m’advienne), ne serais-je pas désespéré, fou de possibles manques et de grandeurs inatteintes? Serait-ce donc que je crois réellement à la Providence?» (p. 69) Ce qui semblerait plus difficile dans cette situation financière précaire, c’est le rapport qu’il entretient avec son épouse: «Une remarque ironique de ma femme sur mes petits comptes avait amené la première explosion de mauvaise humeur... Je n’étais pas fier.» (p. 131)
Quand on observe la deuxième question soulevée par de Rougemont, à savoir si l’isolement est propice au travail de l’écrivain-intellectuel, il semble assez aisé de répondre par l’affirmative. En effet, il consacre l’essentiel de son temps à l’écriture et à la réflexion. C’est même durant cette période qu’il rédige en partie le livre Penser avec les mains (Paris, Albin Michel, 1936). Seuls les éléments déchaînés — une tempête de dix jours — l’empêchent de travailler sereinement et il note: «... je ne parviens plus à avancer dans mon travail. Obsession du sifflement furieusement modulé dans les cheminées et à travers le toit fragile, jour et nuit.» (p. 101)
Il reste à aborder le troisième point, l’aspect social. Et c’est cette dimension de la vie quotidienne qui fera partir le couple de Rougemont de l’île; il se rendra ensuite dans le Gard pour les mêmes raisons et, finalement, rejoindra Paris. De Rougemont, deux semaines après son arrivée sur l’île, éprouve de l’ennui à se voir observé lorsqu’il traverse la place du village. Par une comparaison avec la capitale, il minimise cet inconvénient de la province. Peu de temps après, il note qu’il ne parvient pas à partager ce qu’il fait et ce qu’il pense avec les gens de l’île. Les indigènes aiment parler du temps et d’eux-mêmes, mais ils sont incapables de poursuivre la conversation si de Rougemont oriente le sujet et propose le débat. Il éprouve alors de la gêne à avoir voulu confronter la culture et la réalité.
De Rougemont participe à la vie sociale en assistant, par exemple, à une séance de cinéma organisée par l’instituteur ou encore à une conférence donnée par le pasteur. Les gens, même les jeunes, lui apparaissent laids et il déplore le manque de conscience de la population. Ses mots sont durs, il parle de «l’apathie générale» (p. 49), d’«Impuissance de l’ ‹ esprit ›, bêtise de l’action: ces deux misères n’auraient-elles pas une origine commune?» (p. 51. Le 20 décembre, de Rougemont note qu’un écrit de Kierkegaard l’éclaire sur cette gêne ressentie en présence des indigènes.
Le philosophe danois parle de vanité ou d’orgueil quand l’admiration obtenue est prépondérante dans l’aide que l’on peut apporter à autrui. Mais de Rougemont de se justifier en écrivant: «C’est peut-être un secret désir, un inconscient désir que j’ai d’être reconnu par eux [les gens] à ma juste valeur. [...] On n’aime pas être tenu pour un feignant ou un rentier, quand on est dans ma situation.» (p. 55) Trois jours plus tard, de Rougemont écrit sur la dune: «Certains jours, on donnerait beaucoup pour une bonne raison de désespérer, pour une bonne et impérieuse raison d’abandonner cette partie mal engagée, ma vie, et de se retrouver neuf, enfantin, ou tout simplement jeune devant un présent ouvert de tous côtés...» (p. 70-71)
En février, de Rougemont semble résigné: en observant les gens travailler, il comprend que des changements opérés dans la division des terres ou dans l’utilisation d’outils mieux adaptés changeraient la condition de vie des indigènes. Mais il pense alors qu’«il faudrait croire fanatiquement à une vérité absolue, qui vaille mieux que la paix et le bonheur, pour oser bouleverser la petite vie de notre île». (p. 81) Le départ de l’île de Ré est fixé au 10 juillet. En effet, une amie met une maison dans le Gard à la disposition du jeune couple.
Et les propos datés du 20 juin sont sans appel et expliquent la raison véritable d’un changement de lieu: «Je feuillette ce journal: voici des semaines qu’il n’y est à peu près plus question des ‹ gens ›. En somme, je ne m’intéresse plus guère à leurs affaires. J’ai pris mon parti de cet équilibre indifférent et cordial qui a fini par s’établir entre nous; et il ne reste que l’ennui de nos conversations toujours pareilles.» (p. 134) Et de Rougemont de conclure: «Il vaut mieux partir quand on en est là. Quand on en est à ne plus voir le voisin, la situation n’est plus humaine, elle ne pose plus de questions utiles.» (p. 135)
2. PAUVRE PROVINCE (SEPTEMBRE 1934 – JUIN 1935)
Dès les premiers jours de son installation dans cette région de France, le Gard, de Rougemont exprime sa désillusion: «Arrivés hier matin, par Nîmes. Déjà je ne sais plus ce que j’attendais, ni ce que j’ai pu rêver de ce pays.» (p. 143) Le couple de Rougemont habite le premier étage d’une magnanerie désaffectée, bâtiment destiné à l’élevage du vers à soie. Et suite à l’industrialisation, les petites entreprises de la région font faillite, les gens vivent dans la pauvreté et la misère et leurs enfants, crasseux, traînent dans les rues.
Le ton du Journal au 20 décembre se fait cassant: «Quand je vois cette place où des retraités tirent leurs savates, quand j’écoute ce qui se dit chez la marchande de journaux, quand je m’informe des raisons de tel parti, de l’idéal de tel individu, et que je trouve partout la confusion, la dispersion, l’indifférence, une veulerie vaniteuse, ou des bonnes volontés exploitées par le plus bavard, je suis tenté d’écrire quelque chose de méchant: que ce pays est à l’image des quelques journaux qu’on y lit. Une autre impression que j’ai eue cet après-midi sur la place, celle d’être devant un film dont la musique vient de se taire.» (p. 185)
Les de Rougemont sortent de moins en moins de chez eux; ils descendent au village de préférence le soir, à la tombée de la nuit. De plus, un voisin proche, Simard le jardinier, se met à dire ouvertement du mal de l’écrivain. Le jeune couple quitte le Gard le 7 juin 1935. Cette dernière ligne éloquente clôt la deuxième partie du Journal: «Après demain, nous partons. Nous fuyons.» (p. 249) La clé de voûte des trois questions auxquelles de Rougemont souhaitait répondre dans ce Journal se laisse entrevoir à la date du 25 février. Le jeune couple souffre de sa relation aux autres qui est tout à la fois trop proche des gens indifférents du voisinage et trop lointaine d’une population locale refermée sur elle-même. De Rougemont reconnaît que son départ de l’île de Ré est également dû à une intégration sociale impossible.
3. L’ÉTÉ PARISIEN (JUILLET 1935 – AOÛT 1935)
Le couple de Rougemont revient à Paris, mais il n’y trouvera plus ses marques; tout lui déplaît: un appartement bruyant dans un bloc locatif, quelques rencontres avec des écrivains admirant les Soviets, la promiscuité des gens dans la rue et le métro. Un nouveau départ s’impose et une petite annonce d’un bien immobilier à louer sert de conclusion au Journal d’un intellectuel en chômage: «Remercier donc, et s’en aller encore. Savoir ce qui compte, et s’y tenir. Je le dis avec d’autant moins d’amertume qu’un espoir vient de m’être donné. Une feuille de papier-machine avec ce poème en prose: à Thivars, 8 kilomètres de Chartres, Petite fermette 3 pièces meublées... » (p. 267) Madame et Monsieur de Rougemont poursuivent l’aventure...
[su_service title="CATHERINE WILLI" icon="icon: keyboard-o"]
Biographie brève de Denis de Rougement
Denis de Rougemont (1906 – 1985) est un écrivain et penseur suisse ayant vécu, dès l’âge adulte, en France et aux États-Unis. Son oeuvre magistrale, L’amour et l’Occident, paraît en 1939. Il est le cofondateur du mouvement personnaliste qui est une réflexion politique, économique et sociale basée sur la personne, à savoir un individucitoyen libre et responsable. Le système d’organisation de la société qu’il prône est le fédéralisme. Partisan d’une union européenne, il devient, en 1950 à Genève, le directeur du Centre européen de la culture. Il fonde en 1963, à Genève toujours, l’Institut d’Études européennes (incorporé par la suite à l’Université) où il sera professeur. Une foi profonde de chrétien sous-tend l’ensemble de ses écrits.
Narcisse Praz, les vies tourmentées d’un heureux mortel
Il a toujours jeté ses pavés dans la mare helvétique, claire en surface, boueuse en profondeur. Et ce n’est pas à 85 ans qu’il va atteindre l’âge d’oraison. Son nouveau combat – ne parlez pas de croisade, grand Dieu! – est de rendre laïque l’État du Valais. Décidément, le rédacteur sans chef de feue La Pilule, continue à se lancer dans les défis les plus improbables. Retour sur sa vie en zigzag et visite à Derborence à ce drôle de zigue.
Il a toujours jeté ses pavés dans la mare helvétique, claire en surface, boueuse en profondeur. Et ce n’est pas à 85 ans qu’il va atteindre l’âge d’oraison. Son nouveau combat – ne parlez pas de croisade, grand Dieu! – est de rendre laïque l’État du Valais. Décidément, le rédacteur sans chef de feue La Pilule, continue à se lancer dans les défis les plus improbables. Retour sur sa vie en zigzag et visite à Derborence à ce drôle de zigue.
Mis en ligne le 28 décembre 2014 à 13:03
[dropcap]I[/dropcap]l a cherché le soleil en changeant de vallée. Narcisse Praz, de sa maison d’Aven, dernier village contheysan avant Derborence, fait face à Nendaz. C’est là qu’il est né en 1929, au village de Beuson. Fils d’un mineur réduit à la pauvreté dès le début de la Mobilisation, par la pingrerie de l’assurance militaire, il a vu sa mère trimer pour quelques sous dans la mine à charbon de Chandoline, près de Sion. Et entendu le curé du village la sermonner parce qu’elle n’avait fait que quatre enfants. «Croissez et multipliez!» Certes, mais le porteur de soutane n’avait pas trouvé le moyen de multiplier les pains. Elle vient de loin, la révolte du petit Valaisan.
Narcisse n’a pas eu le temps de se mirer dans les gouilles de montagnes. Dès neuf ans, il garde les vaches à l’alpage de Novelly pendant les quatre mois d’été. Pour salaire, un demi-fromage et pour couche, la prairie ou l’abri d’un éperon rocheux par temps d’orage. Voilà qui vous forme un caractère de cabochard aussi peu friable que ces pains noirs qu’on taille à la serpe. Et voilà qui vous oblige aussi à fouailler votre imaginaire pour vous raconter des histoires, lorsque les vaches font leur boulot de ruminants sans trop s’approcher des précipices et que l’ennui s’avance à pas de loup.
Narcisse Praz écrit comme il respire et se définit comme graphomane: romans, poèmes, pièces de théâtre — en français et en patois nendard — pamphlets, scénarios, tout y passe. Et ne pas oublier sa fonction hautement perturbatrice: allumeur de brûlots, telle La Pilule et Le Crétin des Alpes. Imagination et colère, voilà l’héritage que lui a légué le berger de neuf ans.
[su_pullquote align="right"]DES TORDUS SUR LES CHAMPS DE NARCISSE[/su_pullquote]
Dès le départ, Praz a secoué la vie qui n’a pas manqué de lui rendre la pareille. En l’écoutant, on éprouve la sensation d’être embarqué dans le grand huit des fêtes foraines. Un jour tout en haut. Un autre tout en bas. Un vrai chaos à la Derborence, sa vie. Mais comme à Derborence, des éboulements, des écroulements surgissent lac et forêt. C’est incroyable le nombre de tordus bien dans leurs droits, de prêtres bien dans leurs vices, de grands dirigeants aux mains aussi blanches que crochues, de faux anars et vrais arnaqueurs qui ont traversé les champs de Narcisse. Des champs de bataille souvent. Au fond, bien au fond, les rares personnes de confiance en affaires figurent principalement chez les contrebandiers et autres fraudeurs qui ont au moins une religion, celle la parole donnée. La seule qui vaille pour l’athée Praz.
Ayant remarqué son envie d’apprendre, les religieux de la Congrégation des Salésiens ont voulu en faire un ecclésiastique en l’envoyant étudier à Fribourg. Pour les pauvres des cantons catholiques, le séminaire constitue alors l’une des rares voies vers le savoir. Il y est resté cinq années, au cours desquelles l’expetit berger a appris, en sus du patois nendard, le français et l’allemand littéraires, le grec ancien, le latin. Il y a aussi subi les agressions pédomaniaques. Plusieurs décennies plus tard, Narcisse Praz évoquera sa douloureuse expérience «chez les talibans salésiens» dans son livre, Gare aux gorilles! (Éditions Libertaires): «Les prêtres catholiques pédophiles? Je connais. Je suis tombé dedans à l’âge de onze ans», écrit-il dès les premières lignes.
[su_pullquote align="right"]LES VOIES DE TRAVERSE DU SEIGNEUR[/su_pullquote]
Mais le Nendard est une confirmation vivante de la théorie de la résilience établie par le magistral Boris Cyrulnik. Après avoir évité la soutane, à seize ans, il prend sa salopette, son pic, sa brouette et sa pioche pour participer comme manoeuvre à la construction du barrage de Cleuson-Dixence. Plus tard, on le retrouve outre-Sarine pour y apprendre les langues vivantes dans une école privée.
Avec la caution de deux parents, il a pu convaincre la Banque Raffaisen de lui prêter 2000 francs, une jolie somme dans les années 1950, afin de payer les cours. Il en sort polyglotte et devient prof de langue au Tessin à 450 francs par mois. Lorsqu’il apprend qu’une fille de son village gagne 200 francs de plus que lui comme ouvrière dans l’horlogerie, Narcisse Praz fonce vers les brumes jurassiennes et tombe dans l’horlogerie, qui va à la fois régler et dérégler une partie de sa vie. Il faudrait écrire tout un livre — que Narcisse s’apprête d’ailleurs à publier — pour évoquer ses heurs et malheurs dans cet univers. On y apprend que la fraude et la contrebande y sont monnaies courantes. Très courantes même. Sous l’image lisse et glamour véhiculée par la publicité horlogère grouillent un arrière-monde, avec poignards dans le dos, dénonciations calomnieuses, magouilles à tous les étages. N’y aurait-il de régulier que l’imperturbable tic-tac?
Notre bouffeur de curés a même assisté en direct à la transaction entre un contrebandier transalpin qui avait pignon sur rue et pognon sur ruse, un Monsignore tout en violet épiscopal et une bonne soeur à l’esprit pratique pour organiser un passage clandestin de montres entre la Suisse et l’Italie. Les voies du Seigneur sont toujours impénétrables, surtout pour la Guardia di Finanza. Au miracle de la multiplication des pains succède celui de la multiplication des montres.
Narcisse parvient tout de même à se frayer un chemin dans cet univers en se mettant à son compte. Et gagne de l’argent. Beaucoup même. Pendant qu’il fonde une famille, court le monde avec ses montres, slalome entre les coups tordus et les déclarations au fisc fédéral, il prend le temps de sacrifier à sa drogue, l’écriture.
En 1954, son premier roman, L’Intrus, lui avait valu un prix et même un contrat pour en faire un film sous les auspices d’une grande compagnie de l’époque, la Gamma. Il était même engagé à Lausanne pour travailler à l’adaptation de son bouquin. Mais la Gamma a sombré dans la faillite par la grâce de «Lola Montès», incarnée à l’écran par Martine Carol, et, surtout, de son réalisateur Max Ophüls qui a englouti 16 millions de francs dans cette mésaventure.
Narcisse a donc dû reprendre, la mort dans l’âme, la route du Jura, pavée de montres. Une fois de plus, les tocantes permettent au scénariste fauché, en pleine gloire, de se refaire une santé financière. Une santé qui deviendra de plus en plus florissante. Question fric, il connaît la musique et sait comment s’en procurer, grâce à un sens du commerce aiguisé. Mais dès qu’il y en a trop, c’est l’ennui qui s’installe. La routine, voilà l’ennemie, bien pire que la mort.
Praz tire un trait sur le Jura pour s’installer à Paris où le Théâtre du Tertre Montmartre a accepté de monter sa pièce Le guet-apens qui deviendra, en traduction parisienne, Clock City. Le tout nouveau Parisien se promet d’ébahir son public en tournant un film qui devait être inclus au sein de la pièce. Mais l’audace ne paie pas toujours. À la répétition générale, le projecteur — que la propriétaire du théâtre avait sauvé de la poussière des accessoires — se met à bouffer la pellicule du film comme un meurt-de-faim. En catastrophe, Narcisse doit remanier sa pièce. Mais celle-ci perd de son sel. Clock City fera tout de même ses trente représentations et obtiendra quelques critiques sympathiques. Mais les planches ne sont guère lucratives, d’autant plus que la famille Praz s’est fait escroquer par l’entrepreneur censé construire leur maison en banlieue.
[su_pullquote align="right"]UNE PILULE QUI FERA DES PETITS[/su_pullquote]
Comme d’habitude, il se saisit de l’horlogerie comme d’une bouée de sauvetage. Le Parisien de Nendaz en est même réduit à faire lui-même le contrebandier. Au moment où Narcisse s’apprête à vider sa voiture des 2000 montres qui y étaient dissimulées, dans un recoin nocturne de la banlieue sud de Paris, des motards de la police foncent sur lui, demandent ce qu’il fait là.
Le contrebandier amateur a juste le temps de jeter son manteau de pluie sur les tocantes clandestines et de dire d’une voix chevrotante qu’il est perdu et cherche un hôtel. Après avoir pris ses papiers d’identité, les flics lui intiment l’ordre de les suivre. Les policiers l’escortent vers un commissariat, puis la prison, sans nul doute. Narcisse est persuadé de vivre au volant ses dernières minutes de liberté. Le convoi s’arrête place de la République. Les policiers le saluent, lui rendent ses papiers en lui désignant les hôtels du voisinage.
Il n’est pas étonnant qu’après de telles aventures, Praz soit victime d’un infarctus qu’il a soigné à domicile, se refusant à perdre son temps à l’hôpital. D’autant plus que trois des employés de sa société parisienne sont en train de le truander.Voilà l’ex-berger au fond du trou, une fois de plus.
Un coup de talon, et il refait surface. Insubmersible, le Narcisse! C’est à Genève qu’il jette l’ancre. Le temps de créer une nouvelle société, la Bourse internationale de la montre (B.I.M.) et de se lancer dans l’une de ses entreprises les plus désespérées — mais qui fut d’autant plus enthousiasmante — la création de La Pilule, hebdomadaire sans pub, sans groupe de presse, sans appuis autre que ceux de ses lecteurs. Mais avec les deniers de Narcisse Praz. La nuit, rédacteur sans chef. Le jour, vendeur de montres.
C’est l’apparition en Suisse romande d’un canard déchaîné, attaquant tous les puissants, cognant sur les militaires, matraquant les flics, vouant les curés et assimilés aux flammes de l’enfer, provoquant la polémique alors que les médias de l’époque dorment du sommeil de l’injuste, dénonçant, moquant, fustigeant, mordant, n’applaudissant qu’avec parcimonie.
Toute une génération de lecteurs et même de futurs journalistes ont ainsi appris l’irrévérence et la soif d’information authentique. Cette Pilule fera des petits en tirant jusqu’à 12 000 exemplaires; elle sort même une exclusivité qui fera le tour du monde, l’implication de la famille du Shah d’Iran dans un trafic de stups. L’empereur fera à l’insolent Narcisse un procès qui sera plus efficace que les plus coûteuses campagnes publicitaires. Mais le rédacteur sans chef et sans peur s’est créé un nombre considérable d’ennemis. Non seulement l’hebdomadaire est attaqué mais aussi la B.I.M. qui le fait vivre. L’aventure aura duré tout de même cinq ans, un record.
Pour payer ses dettes, Narcisse Praz remonte un magasin de montres à prix cassés, rue Voltaire à Genève. Son idée, mûrie dans son mobil-home installé dans un camping à Conches, entre Veyrier et Genève, tourne à plein régime. Le magasin Au Fou! (c’est son nom) ouvrent jusqu’à douze succursales dans toute la Suisse. Les dettes étant payées, le commerçant malgré lui continue cette aventure qui fonctionne selon les principes de l’autogestion. Ni patron ni employés mais seulement des humains gérant leur travail comme ils l’entendent.
Mais le paradis anarchiste est parfois pavé de mauvaises intentions. Trois aigrefins profiteront de cette liberté pour se remplir les poches au détriment de leurs «camarades» et, surtout, de Narcisse. Le ressort moral des montres Au Fou! est cassé. Narcisse quitte Genève pour retourner à Beuson. À 65 ans, il ne peut compter que sur une pension AVS de 1300 francs mensuels. Impossible de vivre en Suisse. Cette fois-ci, ce n’est pas les montres qui le sauvent mais la construction.
Narcisse achète une maisons à bas prix en France, la restaure et la revend avec bénéfice et ainsi de suite durant plusieurs années, jusqu’au retour en Valais à Beuson, puis à Aven. Il pourrait tranquillement peindre ses toiles, pondre ses poèmes, romans et pièces de théâtre en français; celles écrites en patois franco-provençal de Nendaz ont remporté de jolis succès dans les vallées.
[su_pullquote align="right"]LA LAÏCITÉ À L’ASSAUT DU VALAIS[/su_pullquote]
Tranquille, vous avez dit, tranquille? Et quoi encore? En octobre 2010, un enseignant Haut-Valaisan, Valentin Abgottson, est licencié pour avoir décroché du mur de sa salle de classe un crucifix (précision pour les non-Valaisans: cette école est... publique). Narcisse Praz saute sur cette occasion pour lancer un nouveau combat: rendre laïque l’État du Valais... Autant gravir le Cervin en tongs!
Il a donc écrit une initiative en ce sens et trouvé des appuis chez les radicaux — traditionnellement anticléricaux en Valais — et les socialistes ainsi que chez les libres-penseurs. «Mais je veux créer un mouvement citoyen et non politicien», ajoutet- il d’emblée. Parmi les personnalités qui soutiennent l’initiative figurent l’ancienne députée radicale Cilette Cretton, le journaliste (ex-parlementaire valaisan lui aussi) Adolphe Ribordy, la députée Barbara Lanthemann (PS) et le porte-parole du groupe socialiste au Grand Conseil valaisan, Jean-Henri Dumont.
Un comité s’est formé. Sa première tâche a été de transformer le texte buissonnant et foisonnant de Narcisse Praz en une initiative bien ordonnée, comme un jardin à la française. Elle s’inspire de la nouvelle Constitution cantonale genevoise qui proclame la laïcité du canton. Le Comité «Valais laïc» veut changer la constitution du canton en interdisant tout financement des cultes par les deniers de l’État ou des communes, en prohibant les signes religieux sur les édifices publics, en instaurant une «neutralité religieuse absolue». Toutefois, selon le texte proposé, l’État valaisan pourra entretenir des relations avec les communautés religieuses pour leurs activités d’intérêt général.
«Comme il s’agit d’un texte constitutionnel, nous devons récolter 6000 signatures d’ici juin 2015. Pour l’instant nous en avons obtenues un demi-millier. On peut y arriver, mais, ajoute Narcisse Praz, il ne faut pas se le cacher, la tâche est ardue. D’autant plus que la presse locale s’acharne à me présenter comme un anar qu’il faut contenir dans sa marge.» Il en faut plus pour le décourager: «J’ai envoyé, à mes frais, un ‘toutménage’ à 40 000 personnes dans le Valais romand. Et tous les vendredi matin, je prends mon petit présentoir portatif pour faire signer l’initiative sur le marché à Sion.»
Le comité s’active aussi comme autant de diables dans les bénitiers du Vieux Pays. Un comité qui morigène parfois l’octogénaire libertaire: «Ses membres me rappellent à l’ordre lorsque j’exagère dans mes propos antireligieux. Et ils ont raison, la laïcité n’est pas une arme contre les croyants; elle n’a pas d’autre visée que de séparer l’État des religions, afin que l’un et les autres vivent en pleine indépendance réciproque.» Cela n’empêche nullement Narcisse Praz de se revendiquer comme athée tout en se refusant à faire de l’athéisme une nouvelle religion d’État: «Ce serait un non-sens absolu.» Et une hérésie! Sa plus grande victoire dans la vie? «C’est lorsque je me suis accepté comme mortel. Depuis je vis pleinement heureux en goûtant chaque instant.» Et sous Derborence dorée par l’automne, ces instants-là sont divins.
L’insolent matou de la révolution tunisienne
Les artistes de Tunis ont investi l’ancien palais des flics de Ben Ali pour transformer ses murs en lieu de création. Parmi eux, la dessinatrice Nadia Khiari qui a lâché son chat Willis à la barbe des benalistes et des... barbus. Symbole de la Révolution de Jasmin, il n’a pas fini de miauler sous les fenêtres de tous les empêcheurs de vivre en liberté.
Les artistes de Tunis ont investi l’ancien palais des flics de Ben Ali pour transformer ses murs en lieu de création. Parmi eux, la dessinatrice Nadia Khiari qui a lâché son chat Willis à la barbe des benalistes et des... barbus. Symbole de la Révolution de Jasmin, il n’a pas fini de miauler sous les fenêtres de tous les empêcheurs de vivre en liberté.
Mis en ligne le 6 décembre 2014 à 16h57
[dropcap]J[/dropcap]eudi 13 janvier 2011 est une date clé dans l’Histoire de la Tunisie. Tout d’abord, elle célèbre la naissance du chat Willis from Tunis par la grâce, non du Saint-Esprit, mais du crayon de la dessinatrice Nadia Khiari. Ensuite, ce jour a donné l’occasion au dictateur tunisien Ben Ali de prononcer un ultime discours avant de se faire «dégager» par son peuple.
Ulcérée par les propos du tyran qui déblatère au micro, Nadia Khiari crayonne ses pages blanches et Willis from Tunis apparaît.La Révolution tunisienne prend de l’ampleur. Willis from Tunis devient alors le commentateur de cette brûlante actualité sur les réseaux sociaux. Le succès est foudroyant. En une semaine, Nadia et Willis récoltent 900 «amis» sur Facebook. Ils seront bientôt 15 000.
Insolent, narquois, moqueur, pertinent dans son impertinence, griffant là où ça fait mal, feulant contre le clan au pouvoir, léchant les plaies morales d’un peuple qui craint que sa Révolution ne lui soit dérobée par la bande des barbus, Willis from Tunis fait son boulot de chat qui est de donner aux humains le goût de la liberté. Il est désormais l’une des figures les plus évocatrices du printemps tunisien. Lorsque le pouvoir benaliste a été éjecté, Nadia Khiari a réuni ses dessins et les interventions de Willis from Tunis dans un recueil intitulé Chroniques de la Révolution. Les lecteurs se sont rapidement arrachés cet ouvrage, tiré tout d’abord à 5000 exemplaires à compte d’auteur.
[su_pullquote align="right"]RECONNAISSANCE INTERNATIONALE[/su_pullquote]
Depuis, le malicieux talent de la dessinatrice tunisienne a été reconnu, non seulement dans son pays, mais aussi hors de ses frontières. Nadia Khiari a reçu en avril 2012 le Prix Honoré Daumier à Caen (France) ainsi qu’en septembre 2013, le titre de Docteur Honoris Causa à l’Université de Liège. Elle a été couronnée cette année à Forte dei Marmi (Italie) et a représenté la Tunisie au Festival de Cannes 2014 lors de la présentation d’un ouvrage illustré par des dessinateurs-éditorialistes (dont la créatrice de Willis) et intitulé Les dessins de la liberté. Cette initiative était due au dessinateur du Monde Plantu et à l’association Cartooning for peace qu’il préside.
[aesop_image imgwidth="1021px" img="http://lacite.website/main/wp-content/uploads/2015/07/tunisie_matou_3.jpg" offset="-185px" align="left" lightbox="off" captionposition="left"]
Nadia Khiari a souvent résidé en France, notamment à Bordeaux et à Aix-en-Provence où elle a fait ses études. Aujourd’hui, elle enseigne à l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis et tient dans cette capitale, une galerie d’art qui a pour nom «Artyshow», un légume pourtant peu apprécié par les chats. Bien entendu, Willis from Tunis continue à friser ses moustaches dans la presse tunisienne (ainsi qu’à Siné Mensuel) en commentant l’actualité de façon grinçante et griffante.
Après le départ du clan Ben Ali et de ses tortionnaires, Nadia et Willis ont souvent hanté une maison située sur les hauteurs de Tunis. Elle appartenait à des membres des services (sévices?) de sécurité qui ont fui en même temps que le despote. Les artistes tunisiens l’ont aussitôt investie pour la transformer en un lieu de création en liberté.
Cette maison, un photojournaliste français, Arnaud Galy, l’a photographiée sous tous ses angles lors d’un reportage à Tunis. Né en 1965 à Dugny, près de Paris, il est établi en Dordogne et dirige le magazine en ligne consacré à la francophonie, ZigZag (www.zigzag-francophonie.eu), partenaire de La Cité. Arnaud Galy est également à la tête de la plateforme www.agora-francophone.org et de la revue «papier» L’année francophone.
Voici quelques unes des photos qu’il a prises lors de ce reportage à Tunis. Elles révèlent l’art qui vient d’être délivré de ses chaînes. Il est alors en pleine force ascendante. C’est la poésie à sa source même qui jaillit, éclabousse, nettoie, débarrasse des vieilles crasses tenaces. On y entend le rire libérateur. Ce rire qui, parfois, trop rarement, parvient à démolir les murs.
Un monument au-delà de toutes les frontières, malgré tout
À Mostar, l’architecte Bogdan Bogdanovic a créé son cimetière des Partisans. Une oeuvre commandée par Tito mais qui s’est affranchie des codes du réalisme socialiste et du pouvoir politique. Visite dans ce lieu où le surréalisme rend la vie aux pierres mortes.
À Mostar, l’architecte Bogdan Bogdanović a créé son cimetière des Partisans. Une oeuvre commandée par Tito mais qui s’est affranchie des codes du réalisme socialiste et du pouvoir politique. Visite dans ce lieu où le surréalisme rend la vie aux pierres mortes. [dropcap]L[/dropcap]a ville de Mostar est connue pour son Vieux Pont. Il fait désormais figure de symbole de la réconciliation et de la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine, après les conflits de 1992-1995. Au-delà de l’ouvrage d’art, le passant peut entrevoir un passage discret qui mène au cimetière des Partisans. Il fait partie des lieux de mémoire emblématiques élaborés par l’architecte Bogdan Bogdanović, né en 1922 à Belgrade et décédé en 2010 à Vienne.
Cet ensemble monumental, érigé à flanc de colline et de forme inhabituelle pour un cimetière, célèbre le souvenir des partisans antifascistes morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Les ouvriers ont tout d’abord dynamité une partie de la colline pour ensuite entamer un chantier qui a commencé en 1960 pour ne s’achever que cinq ans plus tard. Sur le site, un chemin d’une largeur de quatre mètres environ longe le parc sur un de ses côtés et conduit, par un parcours tout en courbes, vers son point culminant. Plusieurs voies arrivent ainsi des autres côtés du parc, surplombant quelques esplanades qui semblent avoir servi jadis de bassins. Les murs et les sols sont formés de pierre grise, sorte de calcaire taillé en losange, en octogone asymétrique ou sous forme de grands blocs rectangulaires. Conséquence de longues périodes sans entretien (excepté quelques rénovations en 2003), l’ensemble est envahi de ronces et d’arbustes, barbouillé de graffitis et jonché de déchets.
Au détour de ce gigantesque parc surgissent quelques groupes de jeunes ou des joggeurs. La partie surplombante du mémorial, très impressionnante, contient davantage d’éléments décoratifs abstraits et d’ornements inspirés du surréalisme. Sitôt franchies de grandes portes à ciel ouvert, apparaissent divers objets disposés au bout du mémorial. Très discrètes, des pierres sculptées de façon sinueuse sont déposées, accompagnées d’inscriptions à la mémoire des partisans. Plus récemment, des visiteurs ont installé des tissus blancs recouverts d’autres inscriptions en serbo-croate ainsi que des couronnes tressées avec du blé. Il s’agit de la partie funéraire du monument où les corps des partisans sont enterrés. Le parc est appelé acro-necropole par Bogdanović, qui tire son inspiration du terme antique acropole (ville haute) et necropolis (espace funéraire). Le parc possède la particularité de servir autant de lieu de recueillement et de mémorial à la gloire des vainqueurs de la lutte contre le fascisme.
Cette conception du monument est propre à l’idéal socialiste de l’époque et contraste avec une conception plus contemporaine des mémoriaux. En effet, après la monumentalité et la représentation des vainqueurs, les monuments, au travers d’un changement de modèle esthétique, vont peu à peu représenter les victimes, après les guerres des années 1990. Le mémorial de Srebrenica, cimetière dédié aux victimes du génocide de juillet 1995, les pierres commémoratives ou les monuments aux morts qui longent les routes de la Bosnie-Herzégovine en sont les illustrations les plus évocatrices.
L’HÉRITAGE DU SURRÉALISME
Le cheminement et la déambulation, malgré l’ascension qui mène à la partie surplombante, sont plus marqués par la sensation d’horizontalité que par celle de verticalité, propre à l’architecture typique de cette époque. Cette volonté d’horizontalité et d’extension plutôt que d’élévation est la marque d’une «anti-monumentalité » qui s’inscrit dans l’histoire de l’architecture. En plus du sentiment de grandeur, le visiteur éprouve l’impression de se mouvoir dans un espace sinueux et labyrinthique, au sein d’un univers futuriste ou à l’intérieur d’un temple antique.
Ces caractéristiques ne permettent pas de dédier le parc à un style unique et rappellent à la fois les idées du courant surréaliste qui a traversé le XXe siècle et la massivité des sculptures socialistes. Mêlant ces multiples champs d’inspirations, Bogdanović semble avoir ajouté une dimension critique à l’architecture classique du réalisme socialiste par le biais de la fantaisie, de l’extravagance des ornements et des formes abstraites.
À l’époque de la construction du cimetière, pour des raisons principalement politiques, plusieurs mémoriaux et monuments dédiés aux batailles de la Seconde Guerre mondiale et aux sites des camps de concentration étaient commandités par Tito. Le mot d’ordre du régime visait à construire une identité yougoslave unifiée, sous l’égide de la lutte commune contre le fascisme, avec pour slogan «unité et fraternité». Les monuments étaient alors utilisés pour créer une conscience de classe, un élan vers la collectivité et une transmission des idées révolutionnaires. Il s’agissait d’embellir le passé comme gage potentiel d’une mainmise sur le futur.
Le style de Bogdanović, tel qu’on le remarque dans le cimetière des Partisans, met en évidence les relations entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et les pays dits socialistes, formées de moments d’alliances et de désaccords durant la Guerre froide. On peut noter dans ce témoignage de l’histoire de l’art de cet «ancien pays» socialiste, un écart sensible avec les canons artistiques de l’Union soviétique.
Certes, dans le cimetière de Bogdanović, le point de focale est centré sur la mort des partisans. Toutefois, il n’y figure aucune représentation glorifiant travailleurs, paysans ou représentants politiques, contrairement aux codes du réalisme socialiste créés sous Staline. La commande de Tito s’inscrit donc dans la lignée de l’art socialiste par la monumentalité de son architecture, sa volonté de valoriser le passé socialiste et antifasciste, et la glorification, même discrète, des partisans décédés pour leur patrie. Pourtant, l’originalité de cette architecture l’apparente aussi à une tradition moderniste de la sculpture abstraite ou surréaliste, donnant ainsi à l’oeuvre une dimension qui ne dirige pas le visiteur vers une lecture unique.
De 1922 à 1939, la scène artistique de Serbie, spécialement à Belgrade, a connu une forte présence d’artistes — principalement des écrivains et dessinateurs — qui se revendiquaient du surréalisme. Bogdanović, sans pour autant être affilié à ce mouvement, intègre les idées du surréalisme; cela s’explique, dans la majeure partie de ses constructions, par la recherche de formes qui puisaient leurs inspirations dans les constellations solaires, les formes organiques, dans l’ornementation et par son refus de tout réalisme. Ainsi, il n’a jamais représenté de figure humaine.
Dans le surréalisme, la créativité repose sur l’utilisation de formes, auparavant négligées, comme l’association d’idées, le rêve, le jeu de la pensée et l’absence de tout contrôle sur la raison. Le surréalisme représente pour les artistes d’alors un moyen de lutter contre les codes préétablis de l’art qui permettent de le déchiffrer et de le comprendre. L’utilisation spécifique dans son cimetière de formes faisant appel à l’imaginaire et à l’organique, laisse à penser que Bogdanovic a voulu emprunter d’autres chemins que ceux de la figuration, du symbole déchiffrable et du discours esthétique préfabriqué.
LA SCULPTURE COMME LIEU
Au même titre qu’un parc, ce lieu rassemble. Ces aspects rappellent certaines initiatives artistiques comme les sculptures du Land Art aux États-Unis. En effet, durant la même période que Bogdanović, des artistes du Land Art, comme Robert Smithson et la célèbre «Spiral Jetty», ont repensé la sculpture de manière innovante.
Partis d’une volonté de sortir de l’espace du musée et de la galerie, ces artistes intervenaient en pleine nature et construisaient des sculptures formées d’éléments naturels ou de matériaux simples, soumis à l’érosion et à l’écoulement du temps. Un peu comme celles de Bogdanović, ces sculptures à ciel ouvert étaient de taille importante et, de façon encore plus marquée, s’étendaient beaucoup plus qu’elles ne s’élevaient. Les sculptures devenaient aussi des lieux de passage où les héros et la monumentalité verticale avaient disparu. Ce qui restait jusqu’alors dans les marges — la déambulation, l’espace, l’imagination et la nature — se trouvait désormais au centre de la perception.
L’engagement de Bogdanović auprès des partisans dans la résistance contre l’armée allemande en 1941 explique le rôle central qu’il a joué par la suite, en tant qu’architecte, dans l’histoire politique et artistique de son pays. En effet, peu après la guerre, il commence sa longue carrière d’architecte pendant laquelle il réalise, toujours sous la commande de Tito, plus de vingt monuments en hommage aux victimes de la guerre et du fascisme. En 1993, il est contraint de fuir son pays après s’être opposé tant au régime de Milosevic qu’à la montée des nationalismes dans l’ensemble de l’espace balkanique.
Dès les années 1980-1990, la République fédérative socialiste de Yougoslavie a connu la montée de l’ethno-nationalisme, renforcée au moment de la Chute du Mur. Les monuments socialistes ont dès lors souvent été démolis ou détériorés dans le but d’éradiquer cette partie du passé et de créer des nouvelles identités par un retour à des traditions plus anciennes. Le mythe d’un futur utopiste qui avait marqué la période socialiste est remplacé par un mythe ethno-nationaliste du retour vers le passé, au service d’une décennie de conflits.
De manière générale, Bogdanović fut avant tout préoccupé par le contexte yougoslave durant toute la période de l’après-guerre et cela jusqu’à la fin de sa vie. Il adopta une position critique face aux divers conflits liés aux nationalismes et écrit au sujet de ses monuments: «Oui, ils sont archaïques, ils pourraient très bien être des monuments sumériens. Pour éviter les finesses des nationalismes, qui cherchent toujours à savoir si telle forme leur appartient ou non, tout ce que j’ai fait aurait pu être l’oeuvre des origines de la civilisation. Et je pense que c’était la formule de réussite de ces monuments; j’ai toujours évité les spécifications nationales.»
Au sujet des formes que devrait prendre une oeuvre artistique, il existe depuis toujours une polémique entre abstraction et réalisme ainsi qu’entre subjectivité et didactisme. Comme le souligne Bogdanović, l’art n’est pas qu’un instrument esthétique, il relève aussi de la politique. Éviter, contourner les spécificités nationales? N’est-ce pas justement ce dépassement de frontières revendiqué par la pensée surréaliste? Cette tension sur les formes que peut prendre une création artistique pourrait contribuer aujourd’hui à alimenter les initiatives mémorielles et de transmissions du passé. À travers le cimetière des Partisans à Mostar se dessine une tentative de créer un espace qui permette, par les moyens de l’art, de se remémorer le passé, tout en utilisant des formes imaginaires et un montage poétique. Cette démarche offrirait au spectateur sa liberté d’interprétation, grâce à de multiples lectures, et l’inviterait à s’approprier le lieu.
Mais l’abandon partiel du cimetière des Partisans souligne les difficultés que traverse actuellement la Bosnie-Herzégovine. Par le passé, le cimetière célébrait la mémoire des vainqueurs de la lutte contre le fascisme; il évoque, aujourd’hui, l’oubli.
[su_service title="CÉCILE BOSS" icon="icon: keyboard-o"]Assistante au Programme Master de recherche CCC (Critical Curatorial Cybermedia Studies) de la Haute école d’art et de design (HEAD), Genève.[/su_service]
[su_service title="YAN SCHUBERT" icon="icon: camera-retro"]Historien et chercheur associé à la HEAD, Genève[/su_service]
Ces pages achèvent une série d’articles publiés en collaboration avec le projet PIMPA sur la construction de monuments et sur des initiatives mémorielles dans des régions en conflit ou en situation de post-conflit. Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), ce projet est réalisé au Programme master de recherche Critical Curatorial Cybermedia à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.
El-Medina, une histoire suisse
La Cité présente «El-Medina – Entre ici et là-bas», un album de bande dessinée qui sort de la production courante puisqu’il aborde un thème très peu évoqué par le neuvième art, à savoir le parcours en zigzag d’une famille de réfugiés entre le Kosovo et la Suisse. Paru aux Editions Antipodes à Lausanne, il est dû aux talents conjugués de la dessinatrice Gabrielle Tschumi (32 ans) et de la scénariste Elmedina Shureci (26 ans).
La Cité présente El-Medina – Entre ici et là-bas, un album de bande dessinée qui sort de la production courante puisqu’il aborde un thème très peu évoqué par le neuvième art, à savoir le parcours en zigzag d’une famille de réfugiés entre le Kosovo et la Suisse. Paru aux Editions Antipodes à Lausanne, il est dû aux talents conjugués de la dessinatrice Gabrielle Tschumi (32 ans) et de la scénariste Elmedina Shureci (26 ans). L’une et l’autre se lancent pour la première fois dans la BD. [dropcap]E[/dropcap]l-Medina – Entre ici et là-bas... Voilà un album que chaque Suisse devrait lire avant de glisser dans l’urne son bulletin de vote à l’occasion de la énième initiative de l’UDC, le parti de la xénophobie monomaniaque et bégayante. Dans les discours politiciens — politicards serait le terme plus approprié — l’immigration est perçue presqu’uniquement sous forme de chiffres.
Un seul angle de vision, la quantité. L’humain étranger est perçu comme une donnée statistiques à l’égal des tonnes de bananes importées. La vie est absente. Et c’est de propos délibéré qu’elle est éjectée, afin de laisser la place à la propagande hypercalorique et aux caricatures du style mouton noir.
Dans El-Medina, il n’y a pas de moutons noirs mais des humains dans les multiples nuances de gris que nous offre l’existence réelle. Il n’y a ni méchants Suisses, ni gentils réfugiés, ni l’inverse mais seulement des gens qui se débattent au milieu des problèmes personnels et des convulsions géopolitiques. La vie quoi! Qui vous réserve ses coups en vache, ses embellies, ses espoirs déçus et ses désespoirs propices aux rebonds.
Cette histoire est celle qu’Elmedina Shureci a vécue. Née au Kosovo, d’un père albanais et d’une mère albano-serbe, elle suit sa famille en Suisse dès l’âge de 11 ans, au Tessin tout d’abord, puis — après des allers-retours entre le Kosovo et la Suisse ainsi qu’un intermède en Allemagne —, à Lausanne où Elmedina Shureci, devenue Suissesse, continue à résider.
C’est aussi la mise en lumière d’une mère admirable qui lutte contre un cancer, contre les haines communautaires, contre la violence de son mari buveur. Mais qui se bat surtout pour. Pour assurer à Elmedina et à son jeune frère un avenir digne et libre.
Cette histoire est enfin celle de notre pays, formé d’hommes et de femmes qui y ont fait souche, après avoir été rejetés de leur sol natal par les violences politiques, économiques ou religieuses.
Ce qu’Elmedina Shureci a éprouvé, les Huguenots fuyant les dragonnades de Louis XIV, les Italiens du Mezzogiorno quittant une terre sans pain, les Somaliens s’extirpant d’un pays livré à la guerre civile et tant d’autres encore, l’ont ressenti. Le désespoir d’abandonner les siens. La peur au passage des frontières. Les humiliations bureaucratiques du pays d’accueil. La méfiance des voisins de palier. Et aussi, le bonheur, quand tout va bien, d’être accepté et de recevoir ce passeport à croix blanche, rouge sésame vers une vie normale.
Tous ces destins particuliers ont tissé un pays. Le nôtre.
POUSSIN, LE MÉMORIALISTE DES MARAIS D’AMNÉSIE
Son dernier album vient de sortir. Téléportation quantique vers les animaux d’avant l’apparition de la vie. Avec des préfaces de Siné, Sorj Chalandon et Zep.
Son dernier album vient de sortir. Téléportation quantique vers les animaux d’avant l’apparition de la vie. Avec des préfaces de Siné, Sorj Chalandon et Zep. [dropcap]G[/dropcap]râce à Poussin, efforcez-vous de devenir enfin intelligent, comme un enfant. Un enfant d’avant l’école, bien sûr. Un enfant dieu, créateur de l’éternel présent. Un enfant vieux, comme le monde.
Le dessinateur universellement carougeois Gérald Poussin sert de guide, indispensable agent pour mieux vous perdre. Car il faut toujours se méfier des guides qui vous mènent quelque part. Avec eux, la vérité n’est qu’un mensonge parmi d’autres. Préférons le guide qui ne sait pas où aller mais qui s’y rend avec autant de confiance que de détermination. Poussin est une bonne étoile.
Suivons-la, jusqu’à cet album qui vient de sortir aux «Cahiers dessinés». Préfacé par Siné, Sorj Chalandon et Zep, Le catalogue des animaux disparus dans les Marais d’Amnésie dévoile la création d’avant la Création. La création minuscule qui n’avait pas encore fait pousser une majuscule à son C censée hausser son sens.
Le mémorialiste amnésique avertit d’emblée (de crainte, sans doute, qu’il n’oublie cet exorde): La plupart des animaux de ce catalogue sont nés avant qu’il y ait de la vie sur terre. Notez-le, il précise bien, «la plupart», mais non la totalité des animaux. Il en est donc, dans cet opus, qui sont nés APRES l’apparition de la vie sur terre. Et qui donc? Eh bien, c’est vous, gros malin de lecteur!
Vous apprendrez ainsi qu’une masse de pigments de couleurs sur l’étang donnera naissance, au bout de la chaîne évolutive, aux Beatles que Poussin écoute en dessinant. Remarquez son éclectisme, outre les scarabées de Liverpool, il fait courir son crayon avec Debussy, Ravel, les musiques indiennes, Bashung, Manset.
Vous allez devenir familiers de personnages tellement étonnants qu’ils poussent le vice jusqu’à vous ressembler… Si, si! Nous avons tous quelque chose du Bûroûbû, des Hyponponcondriaks qui ont peur d’avoir un zabubon ou une mycoluque à la nuque, de l’inventeur des salles d’attente, des Faignouzares, tellement crevés qu’ils ne peuvent même plus jouer à la bête à deux dos, des moules à bascule (à ne pas confondre avec les moules à gaufre, apanages exclusifs du capitaine Haddock), de Furluflu et Flatatoune, des Knuflus, ces personnages tellement laids que même la vase refusait de communiquer avec eux (il paraît que des spécimens se seraient emparés de la Corée du Nord). Et que dire des Souffreteux qui, vivant les pieds dans l’eau, imploraient leur chaman de faire advenir l’ère du béton? Du Rututu, fuyant devant ses responsabilités paternelles?
Des éponges qui, à l’époque, servaient d’églises? Et mille grâces soient rendues aux Nurfluluches et autres bactéries créatrices! Par elles, nous disposons de ce fleuve épais et nourricier qui a pour nom, pétrole, dispensateur des biens si précieux que sont les bouchons sur l’autoroute les dimanches de ski, les votations multiples sur la traversée de la Rade et la jolie ronde des sacs en plastique au milieu des océans.
Ce Catalogue des animaux disparus dans les Marais d’Amnésie est d’autant plus un événement que cela faisait depuis 2006 et sa Prise de bec que Poussin ne nous avait plus régalé d’un album.
Il faut dire qu’entretemps, l’artiste n’est pas resté à paresser dans les paradis fiscaux plein de glands apportés par un oiseau esclave. Il a créé des peintures murales, notamment à Carouge, à la Gare du Flon, à l’hôpital de Sion, et même au Service des passeports à Onex. Si un porteur de casquette vous cherche des crosses à la frontière, présentez-lui un dessin de Poussin, au lieu de vous tirer des flûtes. C’est magique pour être propulsé aux Violons.
Surtout, il poursuit son oeuvre picturale. Gérald Poussin se trouve actuellement au mitan d’une série inspirée par les sentiers de l’Inde et les rivières du Tessin. A moins que ce ne soit l’inverse. Avec lui, on ne sait jamais... Mais on apprend toujours.
L’art aux prises avec l’impossible mémoire ex-yougoslave
Milica Tomic et Aleksandra Domanovic témoignent de façon fort différente l’une de l’autre, de la complexité «monumentale» à représenter le passé, même récent.
Milica Tomic et Aleksandra Domanovic témoignent de façon fort différente l’une de l’autre, de la complexité «monumentale» à représenter le passé, même récent. [dropcap]M[/dropcap]aints artistes se sont confrontés aux conséquences des guerres en Yougoslavie, notamment Milica Tomic et Aleksandra Domanovic. Une génération les sépare; leur expérience singulière du conflit contribue à façonner des points de vues différents sur les questions mémorielles. Milica Tomic, née en 1960 à Belgrade (actuellement en Serbie) est ébranlée dans sa pratique de la sculpture par la violence du conflit.
Elle commence son oeuvre par un travail de performance et de vidéo sur la construction de l’identité. En 2002, la municipalité de Belgrade lance un concours pour ériger un «monument dédié aux guerres sur le territoire de l’ex-Yougoslavie». L’artiste participe alors à un groupe de discussion. La succession de concours lancés sans succès et la difficulté à nommer le projet alimente les controverses au sein du groupe et témoigne de l’impossibilité de l’opération. Les débats conflictuels finissent par diviser l’entité.
De cet écueil émerge un nouveau collectif qui choisit de prolonger le dialogue par une série de débats publics et d’actions participatives. Grupa Spomenik (Groupe Monument) réunit aussi bien des artistes que des théoriciens et s’entoure d’étudiants, de philosophes, d’anthropologues, de psychanalystes et de théoriciens en sciences politiques. À l’occasion de divers projets, le groupe investit le lieu d’exposition pour le transformer en forum de discussion, en centre de documentation et, depuis 2008, en lieu d’édition d’un journal que les membres définissent comme un «monument distributif», favorisant la prise de parole autour du génocide en Bosnie-Herzégovine.
En 2009, Milica Tomic initie un deuxième groupe de travail intitulé Four Faces of Omarska (Les quatre visages d’Omarska), à nouveau composé d’un grand éventail de chercheurs en sciences sociales et humaines. Le groupe se propose de comprendre et de contribuer à transformer les expériences des personnes dont les vies ont été bouleversées par ce qui s’est passé à Omarska.
Cette ville, actuellement située non loin de Prijedor, dans la Republika Srpska, entité serbe de Bosnie-Herzégovine, fut le lieu d’implantation d’un camp de concentration où furent principalement détenues des populations bosniaques et croates, à partir de 1992. Situé actuellement sur un site minier appartenant à ArcelorMittal, le lieu du camp est pratiquement inaccessible aux familles des victimes et aux commémorations. Four Faces of Omarska a lancé des actions afin de susciter une prise de conscience quant à l’absence de reconnaissance des crimes commis dans le camp auprès des autorités locales et des propriétaires de la mine. Le groupe est allé jusqu’à revendiquer la tour ArcelorMittal du parc olympique de Londres, dessinée par l’artiste indien Anish Kapoor, comme un «monument en exil» pour les victimes du camp d’Omarska, d’où provient le métal utilisé pour la tour.
MOMENTS DÉCONNECTÉS DE L’HISTOIRE
Aleksandra Domanovic, née en 1981 à Novi Sad (actuellement en Serbie) s’intéresse, elle, aux périodes connexes aux conflits, une manière pour elle de commenter les conséquences des guerres et de refléter une certaine histoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Sa pratique artistique explore la circulation et la réception des images, en particulier quand ces dernières changent de sens selon les contextes et les circonstances historiques.
D’abord basée sur l’observation des nouveaux médias, en révélant, notamment, le sens géopolitique des noms de domaines, elle développe depuis quelques années une analyse des images et des discours de l’avant et de l’après-guerre, avec des incursions semi-autobiographiques. Elle révèle par exemple l’obsolescence du nom de domaine de la Yougoslavie, .yu, en l’utilisant pour sa valeur homophonique dans le titre anglais d’une exposition à la Kunsthalle de Bâle en 2012 From yu to me. Dans un essai vidéo, elle étudie l’émergence dans les républiques d’ex-Yougoslavie d’une typologie de sculpture publique issue de la culture populaire occidentale et intitule le phénomène Turbo Sculpture, titre également de la vidéo. En empruntant le suffixe turbo, utilisé dans Turbo-folk pour définir le style hybride de musique balkanique, Aleksandra Domanovic observe les monuments déconnectés de l’histoire récente et traumatique du lieu et représentant des personnages de fiction comme Rocky Balboa ou des acteurs comme Johnny Depp ou Bruce Lee.
Son intérêt porte également sur les monuments du régime socialiste endommagés par les guerres et abandonnés par les nouveaux pouvoirs publics. Elle réalise des répliques de certaines formes issues des mémoriaux de l’un des architectes incontournables de la Yougoslavie, Bogdan Bogdanovic. Son style singulier entre art décoratif et modernité représente l’indépendance de la Yougoslavie de Tito face au vocabulaire architectural des deux blocs antagonistes de la Guerre froide, l’est et l’ouest. Afin de réfléchir à la position de cette alternative yougoslave, Aleksandra Domanovic réalise ces répliques en tadelakt, un enduit typique du Maghreb, rappelant ainsi le lien oublié entre le Maroc et la république socialiste au sein du mouvement des pays non-alignés
SENTIMENTS AMBIVALENTS DE NOSTALGIE
Le portrait du général Tito, omniprésent dans l’enfance de l’artiste, est détourné selon la ressemblance qu’Aleksandra Domanovic lui trouvait avec sa maîtresse d’école. Apparaissant ainsi sous des traits féminins, le portrait semble osciller entre figure autoritaire et maternelle, reflétant ainsi la complexité du rapport des ex-yougoslaves à cette figure historique prépondérante. Chacune des oeuvres de l’artiste intervient comme un symbole de l’ambivalence du sentiment de nostalgie de la période précédant les violences. Elles évoquent également le vide, dans l’époque contemporaine, d’initiatives valables des pouvoirs en place.
Bien que très diverses, les approches de ces deux artistes apportent un regard critique sur l’utilisation, voire l’instrumentalisation de l’art public par le politique, en particulier dans son rapport problématique à la complexité des mémoires, qu’elles soient personnelles ou collectives. Chacune à sa manière, Milica Tomic et Aleksandra Domanovic contribue au débat, à la création de discours et de savoir, en évitant soigneusement le jeu de la commande publique et de l’éventuelle récupération par le pouvoir politique.
[su_service title="DENIS PERNET" icon="icon: keyboard-o"]Commissaire d’exposition, chercheur associé PIMPA[/su_service]
Cet article est publié en collaboration avec le projet PIMPA sur la construction de monuments et sur des initiatives mémorielles dans des régions en conflit ou en situation de post-conflit.
Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), ce projet est réalisé au Programme master de recherche Critical Curatorial Cybermedia à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.